lundi, 23 mai 2022
Confrontation dans l'Arctique

Confrontation dans l'Arctique
par le comité de rédaction de Katehon
Source: https://www.ideeazione.com/confronto-nellartico/
L'opération militaire spéciale en Ukraine a entraîné l'imposition de nombreuses sanctions par l'Occident. L'Arctique a également souffert de ces événements. Les activités du Conseil de l'Arctique ont été suspendues et de nombreux projets sont désormais en danger.
Conseil de l'Arctique
Le Conseil de l'Arctique existe depuis 1996. Elle comprend huit États : Danemark, Islande, Canada, Norvège, Russie, Etats-Unis, Finlande et Suède. Le pays qui préside le conseil change tous les deux ans. Les États prennent cette position à tour de rôle. En 2021, la présidence du Conseil de l'Arctique est passé à la Russie.
Les questions prioritaires de l'organisation sont les suivantes : assurer un développement socio-économique durable de l'Arctique, mettre en œuvre des programmes d'étude et de protection de l'environnement, préserver la biodiversité de la région et adapter la vie en fonction du changement climatique.

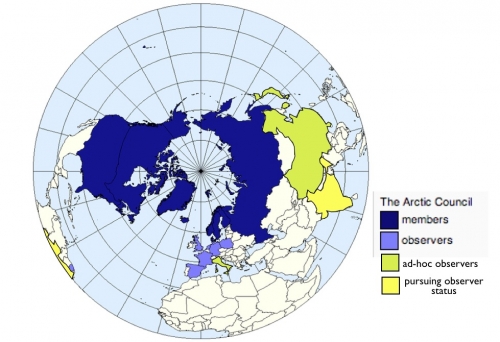
L'opération militaire spéciale en Ukraine a entraîné des changements dans les activités du Conseil de l'Arctique.
En mars 2022, sept États membres de l'organisation ont annoncé leur décision de suspendre les travaux du conseil. Des mesures similaires ont été prises suite aux actions de la Fédération de Russie sur le territoire de l'Ukraine.
Les initiateurs du "bloc" de coopération ont noté que le Conseil de l'Arctique a toujours suivi les principes de "souveraineté et d'intégrité territoriale". La Russie, selon eux, ne remplit pas ces conditions. Compte tenu de la violation de ces dispositions, les représentants des États arctiques ont refusé d'assister aux réunions du conseil en Russie.
Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a condamné cette décision. Le général Nikolai Korchunov, ambassadeur du ministère russe des Affaires étrangères et haut responsable du Conseil de l'Arctique russe, a déclaré que le "blocus temporaire" entraînerait des risques et des défis en matière de sécurité dans la région. Il a noté que dans cette situation, il est important de préserver les activités de projet de l'organisation.
Korchunov a attiré l'attention sur le fait que le Conseil de l'Arctique a toujours été une plateforme de dialogue dépolitisé. Les questions de sécurité militaire ne sont pas incluses dans le mandat de l'organisation.
"Les documents fondateurs et stratégiques du Conseil expriment clairement la nécessité de préserver l'Arctique en tant que territoire de paix, de stabilité et de coopération constructive. Et à cet égard, il est important de protéger ce format unique d'interaction de l'introduction de questions extrarégionales afin qu'il ne devienne pas leur otage", a commenté le diplomate.
La volonté de l'Occident d'empêcher la Russie de mener des activités de projet dans le monde atteint la limite de l'absurde. Au cours des 25 dernières années, l'Arctique a été une zone de paix et de dialogue. Pour de nombreux analystes, l'interaction des pays de cette région semblait plus que prometteuse.
Les membres du conseil parlent de l'importance de suivre les principes de base de l'organisation. En même temps, ils oublient l'essentiel. Le but de la collaboration dans l'Arctique n'est pas de résoudre les différends politiques. En outre, la stabilité et la coopération constructive énoncées dans les documents de l'organisation ne peuvent être atteintes dans une lutte constante pour la "loyauté" des opinions politiques.
Voix de l'Amérique
Les problèmes dans les relations entre la Russie et l'Occident dans l'espace arctique ont commencé il y a longtemps. En 2019, le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton a annoncé son intention d'augmenter la flotte de navires brise-glace dans la région. Les navires ont été mis en service toute l'année pour contrer la Russie et la Chine dans l'Arctique.

Contrer la "présence militaire russe croissante" est devenu un domaine d'intérêt clé pour l'Amérique. Les États sont à la traîne derrière la Russie en ce qui concerne le développement de l'Arctique. Bien sûr, cette situation ne leur convient pas.
En février 2022, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Mikhail Popov, a annoncé la volonté des États-Unis de contester les droits légaux de la Russie dans l'Arctique. Washington prévoit d'obtenir un accès sans entrave aux ressources régionales et à la route de la mer du Nord. Selon M. Popov, ces objectifs américains seront atteints en déployant des destroyers américains équipés d'armes à missiles guidés dans la mer de Barents.
En mars, la secrétaire de l'armée américaine, Christine Wormuth, a déclaré lors d'une vidéoconférence sur la sécurité que le gouvernement américain travaillait activement au renforcement des capacités militaires dans l'Arctique. Elle a noté que ce territoire est d'une importance stratégique. En outre, des exercices avec les alliés peuvent être menés ici.
Les événements ci-dessus suggèrent que les États-Unis sont déterminés à dépasser la Russie et à se débarrasser de sa présence dans la région. Ce sont probablement les Américains qui ont pris l'initiative de suspendre les activités du Conseil de l'Arctique. Dans les conditions d'une opération militaire spéciale, c'est même pratique. Maintenant, la Russie est confrontée à la quasi-totalité du monde. Des sanctions contre l'État russe sont imposées par de nombreux pays. Il était difficile de trouver un prétexte plus efficace pour résister aux activités de la Fédération de Russie.
La position de la Russie
Yury Averyanov, premier secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de la Russie, a déclaré en 2021 que l'Occident transforme de plus en plus "les questions environnementales en un outil de pression, de discrimination et de concurrence déloyale". Il a noté que les écologistes nous rappellent régulièrement la conservation des écosystèmes vulnérables de l'Arctique, qui sont situés juste à côté des installations stratégiques de la Russie.
Après le rejet des sept pays participant au Conseil de l'Arctique dans les négociations avec la Russie, le discours du président russe Vladimir Poutine a suivi. Le chef d'État a commenté la situation actuelle et a insisté pour que la mise en œuvre des projets dans l'Arctique ne soit pas retardée. Le chef d'État russe a également déclaré que le pays est prêt à coopérer dans ce domaine.
Dans le cadre de l'endiguement de la Russie dans la région, M. Poutine considère qu'il est particulièrement important de prêter attention au développement de projets sociaux, car de nombreux Russes vivent et travaillent dans les territoires arctiques.
Il est important de noter que la région arctique est importante pour la Fédération de Russie en termes stratégiques et économiques. Tout d'abord, cela est dû à la longueur du littoral qui borde l'Arctique.
Les experts du Bureau du projet de développement de l'Arctique affirment que la dépendance de la technologie à l'égard de l'économie occidentale a considérablement diminué au cours des huit dernières années. La crise ukrainienne, malgré les longues listes de sanctions contre la Russie, a contribué au développement de cette zone.
La position des libéraux russes et des représentants de la sixième colonne, qui estiment que sans l'aide d'autres États, la Russie ne sera pas en mesure de développer l'Arctique, est révélatrice de la rupture avec l'Occident.
Oleg Barabanov, professeur au département des relations internationales de la faculté d'économie mondiale et de politique mondiale de l'école supérieure d'économie de l'université nationale de recherche, directeur du programme du Valdai Club, a partagé ses hypothèses sur cette situation. Il estime que l'opération militaire spéciale en Ukraine et les sanctions qui en découlent auront un impact négatif sur le développement de l'Arctique. Selon lui, dans les conditions créées par l'Occident, la Russie devra développer son industrie nationale de manière indépendante. Par conséquent, le financement sera distribué différemment. Ces tendances peuvent entraîner une diminution de l'intérêt pour l'Arctique, car les projets dans la région ne constituent pas la principale priorité financière.
Le directeur de programme du club Valdai, Timofey Bordachev, estime que si des difficultés surviennent dans ce domaine, elles seront dues, avant tout, à l'insuffisance des capacités technologiques de la Russie. La solution pour sortir de cette situation sera d'attirer des partenaires alternatifs. La Chine peut aider dans ce domaine.
Mise en œuvre du projet
La Fédération de Russie met en œuvre de nombreux projets dans l'Arctique, malgré la confrontation avec l'Occident. Par exemple, le concours international "Arctic 2022" a débuté le 26 avril. Les participants présenteront les développements scientifiques, techniques et innovants visant à développer l'Arctique et le plateau continental. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 5 août, les résultats seront résumés et les lauréats seront récompensés en septembre à Saint-Pétersbourg.
Une conférence sur la garantie d'un environnement urbain confortable, intitulée "L'Arctique est un territoire de développement", se tiendra également à la fin du mois de mai. L'événement aura lieu à Yakutsk. Des représentants du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, du ministère de la Fédération de Russie pour le développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, de la Société pour le développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, des chefs des régions de la zone arctique russe et des experts de premier plan y participeront.

Le thème principal de la prochaine conférence est de fournir un environnement urbain confortable pour améliorer le mode de vie et le bien-être de la population arctique.
Il est désormais beaucoup plus difficile pour la Russie de réaliser des projets avec la participation de partenaires internationaux. Les sanctions ont mis en péril une vaste coopération scientifique internationale avec la participation de scientifiques du monde entier, axée sur l'une des régions les plus sensibles aux effets négatifs du changement climatique.
L'expédition en Arctique a été organisée l'année dernière en coopération avec l'Institut polaire suisse. Soixante-dix scientifiques du monde entier sont montés à bord du brise-glace russe. De précieux échantillons de sol et de végétation ont été collectés pendant les travaux.
Dans le cadre de l'opération militaire en Ukraine, il y a eu un problème de livraison de matériel à l'étranger. À la fin de l'expédition, tous les échantillons collectés se trouvaient en Russie. Aujourd'hui, les scientifiques étrangers s'inquiètent de ne pas pouvoir interpréter les résultats de l'étude, qui sont cruciaux pour comprendre les conséquences du dégel rapide du permafrost arctique.
Selon Reuters, en raison de la situation actuelle en Ukraine, de nombreux projets impliquant des institutions scientifiques russes et occidentales ont été affectés et un certain nombre d'expéditions de recherche ont été reportées.
Alors, qu'est-ce qui est le plus important : la résolution des différends politiques ou le succès des activités conjointes dans l'Arctique ? Apparemment, pour l'Occident, la réponse est évidente. Seule la recherche dans le domaine de la fonte des glaciers et de l'amélioration de l'écosystème de la zone arctique est importante pour l'ensemble de la communauté mondiale. Obtenir des résultats positifs dans les plus brefs délais n'est possible qu'en écartant les différences et en unissant les forces.
L'opération militaire spéciale en Ukraine a donné à l'Occident une raison de rejeter la coopération avec la Russie dans l'Arctique. Bien que la Fédération de Russie continue d'investir dans le développement de la région, le régime de sanctions a menacé certains grands projets.
Il est évident que l'Occident continuera à essayer de "neutraliser" la Russie dans l'Arctique et d'y accroître son pouvoir. Toutefois, cela demandera beaucoup plus d'efforts que le "gel" du Conseil de l'Arctique et du régime de sanctions.
23 mai 2022
19:45 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, arctique, océan glacial arctique, russie, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La Russie souhaite que le transit par voies d'eau entre la mer Caspienne et la mer d'Azov reste ouvert toute l'année

La Russie souhaite que le transit par voies d'eau entre la mer Caspienne et la mer d'Azov reste ouvert toute l'année
Par Paul Goble
Source : http://moderntokyotimes.com/russia-seeks-to-keep-water-transit-between-caspian-and-azov-seas-open-year-round/
Publication : Eurasia Daily Monitor
La Fondation Jamestown
À l'heure actuelle, Moscou ne peut déplacer des navires, y compris les navires de la Flottille Caspienne, entre la mer Caspienne et la mer d'Azov que pendant environ huit mois de l'année en raison des faibles niveaux d'eau dans le canal Volga-Don. Cependant, en raison du désir du Kremlin de réintégrer et de dominer les anciennes républiques soviétiques au sud de la Russie, y compris l'Ukraine, et de pouvoir utiliser les navires de sa Flottille Caspienne non seulement contre l'Ukraine mais aussi en mer Noire et en Méditerranée, Moscou a maintenant annoncé des plans pour un effort majeur d'élargissement et d'approfondissement du canal. Ces améliorations permettraient aux navires de transiter par le canal Volga-Don 365 jours par an. Les responsables affirment que le projet de 10 milliards de dollars sera achevé en 2030. Et certains d'entre eux suggèrent que les entreprises chinoises joueront un rôle majeur dans cet effort, étant donné que les entreprises russes ne peuvent actuellement pas obtenir de soutien occidental et ne disposent pas de la capacité nationale pour mener à bien une entreprise aussi gigantesque.
Deux gestes importants, bien que largement négligés, ont été faits dans cette direction depuis que le président Vladimir Poutine a lancé l'opération à grande échelle de la Russie en Ukraine le 24 février. D'une part, les responsables russes ont annoncé il y a plusieurs semaines qu'ils poursuivraient les plans annoncés précédemment d'élargir et d'approfondir le canal Volga-Don pour permettre l'utilisation de la voie navigable toute l'année (Rossiyskaya Gazeta, 16 avril 2021 ; Casp-geo.ru, 21 avril 2021 et 6 mai 2022). Cela représente un retard par rapport aux plans antérieurs qui prévoyaient de terminer les travaux d'ici 2028. Pourtant, le fait que Moscou persévère, même dans un contexte de guerre et de renforcement des sanctions occidentales, souligne l'importance du trafic fluvial pour la Russie sur le plan économique, géopolitique et militaire (Casp-geo.ru, 27 septembre 2021). En outre, l'initiative semble marquer la fin de toute possibilité pour la Russie de construire un nouveau canal, encore plus coûteux, à travers le Caucase du Nord, comme beaucoup le réclamaient depuis longtemps dans cette région (voir EDM, 25 juin 2007 et 1er octobre 2010).

D'autre part, des représentants du groupe chinois CCCC Dredging Group sont venus en Russie à l'approche de cette décision pour discuter avec les gestionnaires d'Astrakhan du canal Volga-Don de la possibilité pour les entreprises chinoises de prendre part aux opérations de dragage pour élargir et approfondir cette voie navigable (Rosmorport.ru, 11 mars). Les responsables russes auraient été réceptifs. Et maintenant qu'il a été décidé de s'attaquer aux limitations du canal - une décision probablement motivée par des considérations de sécurité autant qu'économiques - il semble que la Chine deviendra un acteur majeur dans cet effort. Une telle coopération permettra à la Russie d'utiliser le canal non seulement pour promouvoir un rôle pour elle-même dans le commerce est-ouest de la Chine, mais aussi à des fins militaires et de sécurité. Dans ce dernier cas, même si le projet ne sera pas achevé avant un minimum de huit ans, toute amélioration du canal aidera en fin de compte la Russie à poursuivre sa rude campagne de pression contre l'Ukraine (voir EDM, 31 mai 2018, 27 novembre 2018, 13 avril 2021).
Les tâches auxquelles les entreprises russes et maintenant chinoises sont confrontées pour remettre en état le canal Volga-Don vieux de 70 ans sont énormes. Une grande partie de ses 101 kilomètres de long se remplit de limon, ce qui réduit continuellement la taille et le nombre de navires qui peuvent l'emprunter ; le canal est classé comme ayant une profondeur de 3,5 mètres tout au long de son parcours, mais à de nombreux endroits, la profondeur est bien inférieure à cela. Si quelque 6000 navires et péniches ont transité par lui l'année dernière, la plupart étaient de petite taille, et leur passage était ralenti par le grand nombre d'écluses qu'ils devaient franchir. Ces limitations de taille et de temps ont été particulièrement problématiques lorsque Moscou a voulu déplacer sa flottille caspienne pour faire pression sur l'Ukraine. Beaucoup des plus grands navires de cette flotte sont tout simplement trop grands pour effectuer le passage, ce qui les a laissés embouteillés dans la mer Caspienne (voir EDM, 26 mars 2019). En outre, le fait que le canal soit fermé au moins trois mois par an à cause de la glace signifie que la Russie devra construire ou acheter un grand nombre de nouveaux brise-glace pour qu'il reste ouvert. À son tour, cela limite sa capacité à déployer de tels navires dans la région arctique et l'Extrême-Orient russe, où les brise-glace sont encore plus nécessaires.
Maintenant que la Chine s'est impliquée, éliminant les obstacles posés par le manque d'investissements occidentaux, la reconstruction du canal Volga-Don devrait se poursuivre, bien que très probablement à un rythme plus lent que celui annoncé par Moscou. Néanmoins, si cet effort réussit, même en partie, la voie navigable intérieure sera en mesure d'acheminer le trafic de conteneurs à un coût bien inférieur à celui des chemins de fer de la région. Cela porterait atteinte aux projets ferroviaires soutenus par l'Occident et la Chine dans la région (voir EDM, 19, 20, 2022) et rappellerait que même en ce siècle, le trafic fluvial joue un rôle géo-économique et géopolitique important (voir Jamestown.org, 25 septembre 2020). En outre, non seulement il stimulera le trafic économique dans le sud, mais il permettra à la Russie d'atteindre deux objectifs. Premièrement, elle ouvrira une voie pour que la flottille de la Caspienne quitte cette mer et complète la marine russe, durement éprouvée, dans la mer d'Azov et la mer Noire. Et deuxièmement, il permettra l'intégration du trafic fluvial et des canaux dans le sud de la Russie dans les plans plus larges, souvent rejetés, de Moscou visant à utiliser ses fleuves et ses canaux au nord et à l'ouest pour projeter l'influence russe (voir EDM, 18 février 2020 et 13 mai 2020).
La Fondation Jamestown permet aimablement au Modern Tokyo Times de publier ses articles très estimés. Veuillez suivre et consulter le site Web de la Jamestown Foundation à l'adresse http://www.jamestown.org.
https://twitter.com/Jamestown - Tweets La Fondation Jamestown
16:54 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, actualité, politique internationale, don, volga, canal don-volga, mer d'azov, mer caspienne, mer noire, russie, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 mai 2022
Les tensions du vingtième siècle derrière le conflit Russie-Ukraine

Les tensions du vingtième siècle derrière le conflit Russie-Ukraine
Le rôle des États-Unis, le choc entre l'Ours et la Baleine tandis que l'Europe reste une "belle endormie"
par Giuseppe Del Ninno
Source: https://www.barbadillo.it/104453-le-tensioni-novecentesche-dietro-il-conflitto-russia-ucraina/
Le différend dans la mer d'Azov
La guerre en Ukraine a fait remonter à la surface des mouvements souterrains ataviques, mais elle a aussi confirmé des tendances récentes; de plus, elle a fait exploser des contradictions qui couvaient déjà dans nos sociétés, par exemple en remaniant les distinctions entre la droite et la gauche, au point que les lecteurs de "Avvenire" et de "La Verità" se sont retrouvés sur des positions opposées à l'envoi d'armes en Ukraine, et donc dans le camp opposé à celui occupé par les lecteurs de "Il Giornale", "Corriere" et "Repubblica". Parmi les motions ataviques, il faut surtout compter l'opposition dynamique entre Terre et Mer, déjà théorisée par Carl Schmitt, qui l'a identifiée dans le conflit entre Rome et Carthage, sa première manifestation dans l'histoire ; or, les événements guerriers qui se déroulent à deux heures de vol de chez nous en représentent une variante typique.
Ce n'est qu'avec l'avènement de l'arme nucléaire et l'extension à la planète entière du scénario sur lequel s'affrontent les nouveaux sujets en lutte pour le Pouvoir que s'est imposée la notion de "guerre par procuration", où les véritables protagonistes - l'un, les Etats-Unis, la baleine symbolique dans la métaphore de Carl Schmitt, l'autre le binôme russo-chinois, souvent dépeint comme un ours - choisissent des représentants théâtraux et tragiques de leurs intérêts respectifs, pour déclencher des conflits qui les impliquent le moins possible.
C'est un scénario que nous avons vu mis en scène depuis la guerre de Corée, avec les États-Unis directement engagés contre cette puissance régionale, mais en réalité contre la République populaire de Chine, comme ce fut également le cas au Vietnam. Dans la suite de l'histoire de ce vingtième siècle que l'on croyait "court", mais qui a étiré ses excroissances malignes jusqu'au vingt-et-unième, la superpuissance américaine a toujours été présente, soit à la première personne, soit comme leader de coalitions, sous le signe de cette "alliance atlantique" qui, par son nom même, souligne son appartenance à la catégorie "mer" : avant l'Ukraine, nous en avons eu un avant-goût en Syrie.

Dès lors, l'opposition réactivée entre cet ours et cette baleine, qui une fois de plus - après Belgrade et le Kosovo, autres exemples récents - a choisi l'Europe comme lieu de cette conflictualité représentative, atavique et tragique, ne doit pas surprendre. À nos yeux, ce sont donc moins les causes occasionnelles du conflit - que l'on veut de manière simpliste faire remonter et réduire à l'invasion russe de l'Ukraine - qui comptent que ces funestes tendances souterraines que nous avons mentionnées. Avec un minimum de prévoyance et de mémoire historique, le conflit, avec son cortège sanglant de mort et de dévastation, aurait pu être évité.
Quant au rôle évanescent de l'Europe, dans son pâle avatar qu'est l"Union européenne", nous sommes toujours dans le déjà vu: le chimérique "empire de 400 millions d'hommes" rêvé par des légions de politiciens et de penseurs d'orientations les plus diverses, de De Gaulle à Schumann en passant par Jean Thiriart, a ressemblé dès son origine à l'empire byzantin en déclin, destiné à être avalé par la jeune puissance islamique, dans ses diverses configurations impériales. Il n'est pas nécessaire d'en dire trop sur son asservissement à l'OTAN, le bras militaire de l'Hégémonie atlantique: même dans notre propre pays en lambeaux, après l'unanimité initiale pour défendre le pays envahi, des réserves et des distinctions sont émises, presque de tous les côtés de l'échiquier politique, et des questions sont posées sur les intérêts réels des acteurs en jeu. En effet, les Etats-Unis ne cachent pas leur intention fondamentale, qui ne consiste pas tant en un changement de régime qu'en l'usure de la puissance russe jusqu'à son déclassement économique, militaire et politique, jeu, qui plus est, qui se jouerait sur un théâtre éloigné de leur territoire; tandis qu'en Europe - notamment dans certaines de ses composantes comme l'Allemagne et l'Italie, qui dépendent de l'ours russe sur le plan de l'énergie - l'idée d'un éventuel élargissement et prolongement du conflit ne répond à aucune stratégie géopolitique cohérente et rationnelle.
Et à propos de l'Italie, il est à peine utile de noter l'inversion accessoire du rapport Gouvernement-Parlement, ce dernier étant appelé uniquement et de plus en plus rarement à ratifier les choix de l'Exécutif. Ce n'est que lorsqu'il s'est agi d'éviter la dissolution des Chambres - et le résultat défavorable probable d'élections anticipées pour les détenteurs du pouvoir depuis des décennies - que la nature de notre pays en tant que république parlementaire a été invoquée, avec l'assentiment "alimentaire" de nombreux députés et sénateurs, craignant de perdre prématurément leurs salaires et indemnités.
Il y a ensuite un aspect de cette guerre qui, s'il ne s'agissait pas d'un événement tragique, prêterait à sourire, à savoir la connotation "légaliste" de chaque initiative: la Russie de Poutine - et non le peuple russe, s'empresse-t-on de préciser - doit être punie pour avoir violé le droit international avec son "opération spéciale". D'ailleurs, l'une des conséquences de ce conflit se répercute sur l'utilisation des mots: ce n'est pas la guerre, mais précisément une "opération spéciale", et ce n'est pas la reddition du bataillon Azov, mais l'évacuation; ou bien on utilise des périphrases, pour ne pas définir comme "co-belligérants" ou "alliés" ceux qui fournissent des armes à l'une des parties en conflit. Mais quand la politique du pouvoir a-t-elle jamais adhéré aux règles du droit international? La diplomatie du XIXe siècle appelait déjà les traités "chiffon de papier"...
La guerre entre la Russie et l'Ukraine
Et maintenant, il suffirait de rappeler qu'aucune des guerres après 45 n'a été déclarée selon ces règles; sans parler de l'action de l'"intelligence" adverse et de l'organisation des différents "coups d'État": ces arguments suffiraient à démasquer "avec quelles larmes et avec quel sang" s'écrivent chaque politique impériale, chaque relation conflictuelle entre États. Ne parlons pas de la prétention de qualifier de "génocide" les massacres inévitables de tout conflit et d'invoquer les tribunaux internationaux pour frapper les perdants (mais on se garde bien d'appeler la République populaire de Chine à la barre, ne serait-ce que pour établir une responsabilité, dont les contours commencent à se dessiner, à l'égard de cette pandémie dans laquelle nous nous débattons encore). Malheureusement, nous avons vu des génocides au sens strict du terme, et ils n'avaient rien à voir avec ce qui se passe entre Lviv et Kharkiv, entre Kiev et Odessa : il suffit de penser au massacre des Amérindiens, à la persécution des Arméniens et, surtout, à l'Holocauste, pour comprendre ce que signifie le mot "génocide".
Parmi les dégénérescences de la culture "occidentale", en bref, il y a l'intention louable d'encadrer le conflit récurrent entre Léviathan et Béhémoth dans les catégories du droit, pour tenter de l'exorciser; mais le Mythe et la Technologie, qui donnent corps et âme à la Politique, ne se laissent pas gouverner par l'Économie et l'Éthique (en fait, en ce qui concerne ces dernières, les vainqueurs se posent toujours en gardiens et protecteurs de la Morale Unique). Et bien sûr, le corollaire du Droit - ou son incontournable contrepartie - est la Démocratie, que l'Hégémonie atlantique voudrait imposer au Globe entier, avec le fracs de ses bombes et l succession des coups d'Etat qu'elle organise ; une catégorie de la Pensée grecque transplantée outre-mer et exquisément européenne, qui s'est affinée au cours des millénaires et qu'elle voudrait maintenant imposer à des portions de la planète comme un corps étranger à ces cultures disparates. Dans le conflit russo-ukrainien, il y a aussi le recouvrement hypocrite des intérêts géopolitiques par des arguments de principe vertueux. Malheureusement, si notre Europe est la Belle au bois dormant du conte de fées, il n'y a pas de prince charmant à l'horizon prêt à la réveiller avec son baiser salvateur.
Giuseppe Del Ninno
10:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, russie, ukraine, affaires européennes, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 mai 2022
Préparatifs pour un nouveau monde : à propos de la "transformation structurelle" de l'économie russe

Préparatifs pour un nouveau monde : à propos de la "transformation structurelle" de l'économie russe
par Alessandro Visalli
Source : https://www.ariannaeditrice.it/articoli/preparativi-di-un-nuovo-mondo-circa-la-trasformazione-strutturale-dell-economia-russa
Giovanni Arrighi décrit le revirement des années 1980, dont les porte-drapeaux étaient Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, qui a re-discipliné les travailleurs occidentaux (dont le revenu réel stagne depuis lors [1]) et a été l'effet d'une longue chaîne de causes et de conséquences dont le point central est la décolonisation, dans le contexte de la lutte hégémonique entre l'Est et l'Ouest. La crise des profits et de la compétitivité des biens occidentaux, déclenchée par la modification des termes de l'échange, notamment de certains produits clés (principalement l'énergie), a ensuite entraîné un déséquilibre fondamental de la balance des paiements et de la fiscalité. Ce déséquilibre a été aggravé par les politiques de compensation, visant à sauver le grand capital tout en essayant de préserver la paix sociale, qui se sont accumulées tout au long des années 1960 et 1970, pour finalement atteindre un point de rupture. Puis, avec la dévaluation du dollar (et de la livre sterling) en 1969-73 et la rupture de la parité avec l'or en 1971, un jeu de passe-droit mutuel entre alliés s'est mis en place. Un jeu pour savoir qui finirait par payer pour la crise. C'était notre tour.
Pour éviter la destruction du capital, ils se sont réfugiés dans leur "quartier général", c'est-à-dire les marchés financiers, en essayant de multiplier leurs profits sans passer par la production. Mais, comme l'écrit Arrighi dans Adam Smith à Pékin, de cette façon, en fin de compte, "les États-Unis sont passés du rôle de principale source de liquidités et d'investissements directs étrangers du monde qu'ils avaient joué pendant les années 1950 et 1960, à celui de principale nation débitrice et de puits de liquidités qu'ils n'ont pas abandonné depuis les années 1980" [2]. Ils ont ainsi obtenu les résultats de la fin du millénaire : la défaite de l'URSS et la disciplination du Sud. Les marges de production ont été recréées par la destruction et l'incorporation subalterne de l'industrie du bloc soviétique, qui était en concurrence sur les marchés du Sud ; puis par la récession et l'élargissement des chaînes de production pour occuper l'espace qui s'était ouvert ; enfin, ces événements ont liquidé l'État providence et reconstitué l'armée de réserve industrielle ; les crises financières et de la dette qui se sont répétées tout au long des années 1980 et 1990 ont créé l'espace pour imposer l'ouverture des marchés au capital spéculatif et industriel [3]. Certains ont appelé ce modèle, qui se creuse constamment sous ses propres fondations, la "Grande Modération" [4].
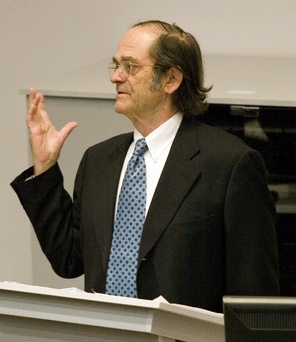
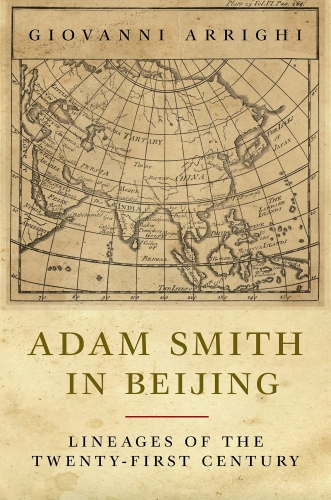
Ce qui s'est passé dans ce tournant des années, et qui a finalement produit le bouleversement des années 1980-1990, a révolutionné l'ensemble de la société. La direction et la qualité de la consommation ont changé, passant d'un arrangement qui était tiré par la consommation de masse à un arrangement tiré par la consommation "distinctive". L'hégémonie de la classe sociale "aisée", qui exhibe sa consommation en en faisant un élément de son prestige, de sa légitimité à diriger et de sa propre qualité morale, a pris le relais de la précédente semi-hégémonie "populaire". Le procédé a trouvé ses chantres et ses détracteurs [5], mais il était pratiquement irrésistible. Il s'agissait d'une nouvelle Belle Époque basée sur un mécanisme qui, à la base, était sous-tendu par une anticipation continue de l'avenir, c'est-à-dire par une expansion constante des structures financières et donc de la dette, et qui, selon Arrighi, aurait pu conduire à long terme à un "nouvel effondrement systémique" (et en fait beaucoup plus proche, puisque Adam Smith à Pékin est sorti de presse en 2007). En bref, un modèle a été affirmé dans lequel la réduction de la concurrence dominait grâce à l'extension des relations client-fournisseur "captives", fondées sur l'association de monopoles et de monopoles, et l'interconnexion internationale pour échapper aux régimes réglementaires ou les arbitrer [6]. Il s'agit du modèle Walmart des années 1990, sur la base duquel, généralisé, le modèle de la "gig economy" [7] et d'"Amazon" [8] s'imposera dans le nouveau millénaire. Et un renversement complet de la façon dont la société est régulée.
Tout cela touche à sa fin et reste désormais à l'état de fantôme.
Mais, bien sûr, ce qui se passera dans les mois et surtout les années à venir ne peut être que conjecturé. Pour développer ces conjectures, commençons par une interprétation: l'accumulation de capital, dont dépend très étroitement la stabilité politique (à la fois "en haut", en tant que consentement des classes dirigeantes, et "en bas", en tant qu'accès aux ressources des classes subalternes via le travail) dans notre système, est étroitement liée à l'exploitation des dissemblances que le système cultive. Ou, pour le dire autrement, le mouvement du capitalisme génère toujours une dialectique spatiale qui est liée de manière interne à la lutte des classes. Le jeu consiste à toujours chercher de nouveaux débouchés exploitables pour les surplus de capital et de travail qui sont continuellement générés, sans les redistribuer. Pour que les nouveaux débouchés donnent lieu au processus complet d'exploitation du capital (investissement-production-réalisation), une certaine stabilité et, en même temps, un certain contrôle de la part de l'investisseur doivent être présents au moins jusqu'à l'achèvement du cycle de production-réalisation. Lorsque le capital investi traque les opportunités d'investissement en dehors de sa propre zone de contrôle, il doit d'abord l'étendre d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que sont déterminées les formes de dépendance, même réciproques (en fait, toujours réciproques).
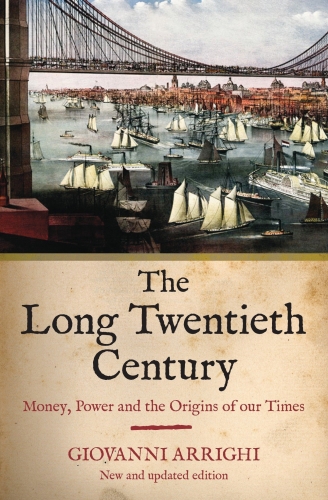
Si l'on se place du point de vue des processus dits de "développement" (c'est-à-dire de la croissance des dotations matérielles et immatérielles, de leur capacité à travailler ensemble et à générer une plus grande efficacité totale des facteurs de production [9]), il faut reconnaître que ceux-ci ne sont pas auto-équilibrés et qu'ils ne dépendent pas essentiellement du simple fait des investissements ou de la disponibilité des technologies [10]. Au contraire, lorsque les investissements sont déséquilibrés par rapport aux caractéristiques de la situation locale, ils provoquent plus souvent la fragilité et la dépendance, notamment lorsqu'ils sont proportionnés aux marchés étrangers ou contrôlés par des centres de pouvoir étrangers [11]. La dynamique d'investissement entraîne souvent une concentration des ressources dans quelques localités émergentes et des "effets de reflux" (positifs, en termes de revenus, ou négatifs, en termes d'épuisement) depuis celles d'origine. Généralement selon une dynamique causale circulaire et cumulative.
L'instabilité potentielle que ces dynamiques complexes génèrent, déterminée par la fluidité du capital (une caractéristique intrinsèque du capital et historiquement entravée par le pouvoir étatique), est tenue en échec par divers mécanismes d'absorption et d'utilisation des surplus et, surtout, par l'organisation internationale et la hiérarchie des nations. C'est-à-dire par un réseau complexe de relations d'exploitation, également créé par le contrôle du capital excédentaire, de son emploi et de sa rémunération. La création et l'exploitation des écarts sont donc une caractéristique inéluctable du capitalisme [12]. Des écarts qui peuvent certes être lus comme caractéristiques d'une stratification fonctionnelle interne aux différents pays, mais aussi de l'exploitation d'un territoire sur un autre.
Ce qu'il faut faire, par conséquent, pour dominer l'instabilité intrinsèque du capitalisme, c'est, du côté des puissances qui entendent dominer leur propre destin, de projeter leur capital, leur technologie et leurs normes, ainsi que leur main-d'œuvre à tous les niveaux (en particulier au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des cadres), dans des zones contrôlables, dans lesquelles il existe des lacunes et des ressources à mettre "au travail" afin de créer des formes de développement dépendant. Des formes de développement, c'est-à-dire capables de consolider les économies subalternes qui sont empêchées par la domination politique d'activer des mécanismes causaux cumulatifs qui pourraient un jour revenir en tant que concurrents (lorsque cela échoue, par exemple les États-Unis par rapport à la domination britannique, ou l'Allemagne et le Japon par rapport à la domination américaine, il y a une transition hégémonique ou son risque). Un développement dans lequel les bénéfices, en d'autres termes, sont appropriés et transférés (également grâce à des termes de l'échange appropriés [13], plus ou moins imposés) et empêchés de se transformer en capital local.
C'est la géopolitique du capitalisme.
C'est donc l'enjeu du Grand Jeu Triangulaire qui se joue entre les Etats-Unis (mais aussi sa fidèle vassale l'Europe), la Russie et la Chine. La troisième a longtemps été cultivée comme une zone d'investissement pour les surplus de production occidentaux, principalement américains, et les capitaux à la recherche de rendement. Mais la Russie est également un terrain de chasse depuis les années 1990. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme l'Occident l'aurait souhaité, car le circuit de l'exploitation et du contrôle, c'est-à-dire le cercle de la dépendance, ne s'est jamais fermé complètement. Les économies russe et chinoise ne sont pas devenues subalternes, et les quelques agents qui ont transmis le contrôle par le biais de leur propre relation avec l'Occident ("entrepreneurs" ou "oligarques", comme on les appelle habituellement) ont, ces dernières années, été ramenés sous le contrôle de la logique étatique, souvent par des moyens peu glorieux. C'est en cela que réside, à y regarder de plus près, l'accusation de "totalitarisme" portée par les libéraux (un régime qui ne laisse pas les entrepreneurs libres est toujours "totalitaire", pas un régime qui asservit les citoyens mais dans lequel le capital circule librement et fait ce qu'il veut, le "paradoxe de l'Arabie saoudite" trouve ici son sens rationnel). Comme c'est souvent le cas, une formule ne semble irrationnelle ou contradictoire que parce qu'elle laisse ses hypothèses implicites, et la formule libérale a pour hypothèse indéfectible que c'est le capital, et pour lui son propriétaire, qui est "libre".
Face à cette faute inexcusable se déplace toute la machine de destruction de l'Occident. La plus formidable que l'humanité ait jamais vue. Une destruction idéologique, morale, culturelle et, bien sûr, matérielle. L'objectif est simple et nécessaire, il s'agit de forcer l'économie des pays déraisonnablement "fermés" à laisser le contrôle interne des investissements être complètement abandonné, à ce que les termes de l'échange soient choisis "par les marchés" (c'est-à-dire que les matières premières soient vendues au prix choisi par l'acheteur et dans la devise qu'il préfère). C'est tout. Bien sûr aussi que les meilleures ressources intellectuelles continuent d'aller dans les universités occidentales, de travailler pour les entreprises occidentales, et que les plus simples et les plus abondantes émigrent au service. Pour cela, il est également nécessaire de briser l'esprit, de montrer qu'ils doivent être heureux d'apprendre du phare de l'humanité comment être dans le monde. Heureux et admiratif d'apprendre la démocratie, la justice, le bien et la vraie vie auprès des maîtres.

C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi, à maintes reprises, le Kremlin nous avertit qu'un monde sans la Russie ne vaudra pas la peine d'exister et que, s'ils y sont contraints, ils le détruiront. C'est certainement emphatique, mais ce que l'Occident collectif veut, c'est effectivement leur mort. La mort en tant que nation et en tant que civilisation, et l'occupation en tant que zone économique, la servitude pour ses habitants. Il ne peut y avoir de souveraineté sans indépendance économique et, d'autre part, il ne peut y avoir de processus d'accumulation stable sans contrôle des espaces inégaux.
Ce qui se passe aux confins de la Russie est donc le siège nécessaire, du point de vue américain, pour contrôler le grand espace russe : le menacer et le forcer à s'ouvrir, lui imposer le choix des clients et des destinations de ses produits (et donc le prix) ; restreindre et dominer sa monnaie et ses entrepreneurs ; enfin, le plonger dans une crise économique, sociale et politique. L'éliminer en tant que grande puissance.
La même chose arrivera, arrive déjà, à la Chine.
Nous savons comment la Russie a répondu militairement à ce défi existentiel, certainement de manière cynique et peut-être imprudente. La façon dont elle a réagi au niveau de la lutte monétaire (une grande partie du défi), nous l'avons également vu dans l'extension des accords "goods-to-ruble" jusqu'à présent réussis [14]. À long terme, cette contre-offensive a le potentiel d'acculer le dollar et, avec lui, la domination américaine.
Mais à moyen terme, l'économie russe a un problème de rétrécissement des débouchés du commerce extérieur. Cela touche un pays apparemment sain, constamment en excédent commercial (avec 45 milliards d'exportations historiques et 24 milliards d'importations), avec des investissements étrangers positifs (à hauteur de 12 milliards) et très peu de dette extérieure (0,4 milliard), un PIB de 1,4 trillion, un taux d'emploi de 71% et un chômage de 4%. Mais c'est aussi un pays aux différences géographiques énormes, gigantesque et avec des zones très pauvres, un revenu moyen par habitant très bas et une population de 145 millions de personnes, donc fortement dépeuplée dans la partie asiatique, dans laquelle ne vit que 23% de la population bien qu'elle soit la plus grande zone.
Comme nous l'avons vu [15], la Banque centrale russe a déclaré que le pays devra passer par une phase de changements structurels majeurs afin de réduire davantage la dépendance vis-à-vis de l'Occident et de permettre la déconnexion. Dans un article récent d'Anastasia Bashkatova [16], la transformation structurelle que la Banque centrale appelle de ses vœux est décrite comme le passage d'un modèle axé sur les exportations (celui de la "Grande Modération" des trente dernières années) à un modèle dans lequel la demande intérieure stabilise le pays. Il s'agit évidemment d'une tâche énorme pour laquelle il faudra des années. Il faudra : restructurer le marché du travail ; changer les secteurs de pointe ; mettre en œuvre ce que l'on a appelé une "double circulation" en Chine. La Banque centrale a prévenu que cela devra impliquer une forte redistribution entre les industries et les professions, ainsi qu'entre les zones économiques géographiques. De nombreux employés de haut niveau des multinationales étrangères perdront leur emploi et devront se délocaliser, tandis qu'il y aura vraisemblablement plus de travail aux niveaux moins sophistiqués. Malgré cela, pour que l'économie se restructure, la masse salariale totale devra augmenter afin de faire croître la demande intérieure.
Le modèle néo-libéral fonctionne exactement à l'inverse. Elle maintient la demande intérieure comprimée, afin de protéger les profits industriels, et recherche la capacité de dépense nécessaire pour assurer la réalisation des biens d'équipement à l'étranger dans une lutte à somme nulle impitoyable. C'est là que réside sa "liberté".
Le pari russe est donc de pouvoir se rabattre sur le modèle inverse, évidemment avec la Chine et de nombreux partenaires. Un modèle qui stabilise son cycle d'appréciation et de reproduction du capital en s'appuyant essentiellement sur le marché intérieur, des salaires élevés et stables, une classe moyenne en hausse. Évidemment, cela inclut un certain contrôle des flux de capitaux et une réticence à être contrôlé de l'extérieur. C'est là que la tradition du pays vient à la rescousse, à savoir la capacité cultivée à l'époque soviétique d'assurer un "large filtrage des projets, en tenant compte des nouvelles circonstances", afin de garantir en fin de compte une augmentation de la productivité totale des facteurs, l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies et le développement du capital humain.
Pour le directeur du Centre de mécanique sociale, Mikhail Churakov, il est donc nécessaire de créer l'infrastructure de base, d'assurer la participation, de combler le fossé entre la métropole et les zones rurales intérieures, de garantir un système de commande et de contrôle efficace et de soutenir l'innovation scientifique.
En bref, retour à la programmation économique, sinon à la planification.
Notes:
[1] - Voir, par exemple, le billet " Lawrence Mishel, 'The mismatch between productivity growth and median incomes' ", Tempofertile, 23 novembre 2013 ; " Conflits distributifs et travail : passé et avenir ", Tempofertile, 21 septembre 2015 ; " Mc Kinsey & Company, 'Poorer than Parents ? Des revenus plats ou en baisse dans les économies avancées", Tempofertile, 20 juillet 2016."
[2] - Giovanni Arrighi, "Adam Smith à Pékin", Feltrinelli, 2007, p. 165.
[3] - Ce résumé se réfère à ce qui est écrit dans Alessandro Visalli, "Dépendance", Meltemi 2020, pp. 394 et s. Un résumé dans ce billet, "Dépendance", Tempofertile, 4 novembre 2020.
[4] - Voir le billet " Les compromis sociaux, la 'Grande Modération' ", Tempofertile, 8 mai 2015.
[5] - L'un des plus importants est Pier Paolo Pasolini, dont il a écrit "Scritti corsari", Garzanti, Milan 1975, et "Lettere luterane", Garzanti, Milan 1976, mais aussi C. Lasch, "La ribellione delle élite", Feltrinelli, Milan 1995.
[6] - Pour une lecture très intéressante qui fait usage de ce concept, voir O. Romano, "La libertà verticale. Come affrontare il declino di un modello sociale", Meltemi, Milan 2019.
[7] - Voir l'article "Gig Economy ou Sharing Economy ? Della generalizzazione del Modello piattaforma ", Tempofertile, 16 février 2016 ; " Benedetto Vecchi, 'Il capitalismo delle piattaforme' ", Tempofertile, 20 janvier 2018.
[8] - Voir ce billet, "Amazon et son monopole", Tempofertile, 22 octobre 2017.
[9] - C'est-à-dire, en paraphrasant la définition succincte de Hirschman, au problème de savoir comment une chose ne conduit pas à une autre (par exemple, un investissement dans une centrale électrique et un port ne conduit pas au développement industriel et donc à une augmentation du niveau de vie général).
[10] - Pour une hypothèse contraire, voir R. Solow, Technical Change and the Aggregate Production Function, dans "Review of Economics and Statistics", vol. 39, no. 3, 1957, pp. 312-320. Selon son analyse initiale, à long terme, la croissance ne dépend pas des machines, mais de la technologie. En calculant la croissance par travailleur aux États-Unis, Solow a estimé que pas moins de sept huitièmes dépendaient de la technologie. L'accent mis sur la productivité du travail, dont on déduit la dotation en biens et services par habitant et que l'on fait coïncider avec la croissance, permet de réaliser que la simple croissance du nombre de machines par travailleur est sujette à des rendements décroissants (je ne peux pas mettre la main sur plus d'une machine à la fois). Il s'ensuit, dans les résultats proposés, que les revenus des usines et des machines constituent une part mineure du PIB (environ un tiers), un fait qui se vérifie à peu près des années 1950 aux années 1980. En raison des rendements décroissants, la simple augmentation des machines n'était pas le chemin de la croissance (c'est la "surprise" de Solow), et donc l'épargne ne soutient pas la croissance. Ce qui l'est, c'est le progrès technique. C'est simplement parce que l'évolution technologique permet d'atteindre un niveau de production plus élevé avec la même quantité de travail. La recherche de directions causales simples, modélisées mathématiquement, l'une des spécialités de Solow, l'a conduit, même dans son influent ouvrage ultérieur, à conclure que le progrès technique avait lieu pour des raisons non économiques, puisqu'il dépendait de l'avancement des connaissances scientifiques (voir R. Solow, Growth Theory : An Exposition, Oxford University Press, 1987).
[11] - Par exemple, selon le point de vue de Myrdal, fondé en partie sur d'importantes recherches de terrain sur la discrimination dans le sud des États-Unis (voir G. Myrdal, Il valore nella teoria sociale, Einaudi, 1966 (éd. or. 1958), contrairement aux modèles optimistes de l'économie (par exemple les conséquences de celui de Solow), le jeu des forces du marché laissé à lui-même conduit à la croissance continue des inégalités. Comme il l'écrit : "Si les choses étaient laissées au libre jeu des forces du marché sans intervention de la politique économique, la production industrielle, le commerce, la banque, l'assurance, le transport maritime, presque toutes ces activités économiques qui, dans une économie en développement, tendent à produire une rémunération supérieure à la moyenne - et en outre la science, l'art, la littérature, l'éducation, la haute culture en général - seraient concentrées dans certaines localités et régions, laissant le reste du pays plus ou moins stagnant. Myrdal, Théorie économique et pays sous-développés, Feltrinelli 1959 (éd. ou. 1957).
[12] - Voir aussi le billet, "Immanuel Wallerstein, 'Après le libéralisme'", Tempofertile 11 mai 2022.
[13] - Les "termes de l'échange" sont définis comme le rapport entre l'indice des prix à l'exportation d'un pays et son indice des prix à l'importation. Du point de vue du pays dans son ensemble, il représente la quantité d'exportations nécessaire pour obtenir une unité d'importations. Ainsi, le prix entre deux biens (ou d'un bien et d'un autre par rapport à une unité de mesure commune, par exemple une monnaie acceptée au niveau international comme le dollar) est relatif aux relations de pouvoir qui sont déterminées sur le "marché" et qui dépendent de nombreux facteurs, pas tous économiques. Par exemple, si un pays a un excédent de vin, s'il s'est spécialisé uniquement dans la production pour l'exportation, par exemple de Porto, et que le seul grand marché "libre" sur lequel il peut vendre son produit est la Grande-Bretagne, il devra accepter le prix déterminé par les grossistes anglo-saxons, qui ont le monopole de l'accès au marché, même s'il est un peu plus élevé que son prix de production, l'alternative étant de remplir ses entrepôts et de ne pas avoir l'argent pour acheter, au prix à nouveau déterminé par les commerçants étrangers, en tant que détenteurs d'un monopsone (soutenu par des traités et, le cas échéant, des canonnières), et à la limite de leur capacité de dépense. L'effet est qu'un pays ayant une souveraineté très limitée (l'ayant perdue sur les champs de bataille) s'appauvrit progressivement. Tout cela disparaît dans des formules simplifiées, dans la puissance des mathématiques, et dans les mots ailés de David Ricardo. L'hypothèse, fondamentale pour la discipline de l'économie internationale, selon laquelle le "libre-échange" est toujours mutuellement bénéfique, est, selon les mots de Keen, "une erreur basée sur un fantasme". Cette théorie ignore directement la réalité, connue de tous, selon laquelle lorsque la concurrence étrangère réduit la rentabilité d'une industrie donnée, le capital qui y est employé ne peut pas être magiquement "transformé" en une quantité égale de capital employé dans une autre industrie. Au lieu de cela, il se met normalement à rouiller. En bref, ce petit apologue moral de Ricardo est comme la plupart des théories économiques conventionnelles : "net, plausible et faux". C'est, comme l'écrit Keane, "le produit de la pensée de salon de personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans les usines que leurs théories économiques ont transformées en tas de rouille."
[14] - Voir "Qui a tué le cerf ? A propos de la guerre entre l'argent et les matières premières", Tempofertile 25 avril 2022.
[15] - Voir "A propos du rapport de la Banque de Russie à la Douma : déconnexions et fin du système-monde occidental", Tempofertile, 22 avril 2022.
[16] - Anastasia Bashkatova, " La Russie aura sa propre voie économique, mais avec des rebondissements chinois " (У России будет свой экономический путь, но с китайскими поворотами, Nezavisimaya Gazeta), 12 mai 2022.
13:00 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, chine, états-unis, économie, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Contre-sens irlandais

Contre-sens irlandais
par Georges FELTIN-TRACOL
Le jeudi 5 mai 2022, en même temps que les élections locales en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, les électeurs renouvelaient les 90 sièges de l’Assemblée d’Irlande du Nord. Cette institution constitue un rouage essentiel dans la pacification des esprits après trente ans de conflit (1968 - 1998). Au cours de ces trois décennies d’agitations et d’oppression de la communauté catholique, l’Ulster devint un terrain fertile d’application des stratégies militaires de maintien de l’ordre.
Les troubles cessèrent avec les « Accords du Vendredi Saint » signés le 10 avril 1998 à l’initiative du Premier ministre britannique, le travailliste Anthony Blair. Aidé de son homologue de la République d’Irlande, il força les protestants loyalistes et les républicains catholiques à se partager le pouvoir. L’Assemblée d’Irlande du Nord investit, approuve les actes et contrôle un gouvernement territorial bicéphale. Représentant chacun leur communauté confessionnelle, le Premier ministre et le vice-Premier ministre disposent des mêmes prérogatives. Depuis un quart de siècle, un protestant détient la première fonction et un catholique la seconde. En 2006, l’Accord de Saint-Andrews provoqua une séisme politique : les ennemis jurés du DUP (Parti unioniste démocratique) et du Sinn Féin (« Nous mêmes ») décidèrent de coopérer. Cette parité confessionnelle procède d’abord des accords de 1998, puis ensuite du mode de scrutin qui combine la proportionnelle et le scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le « système de Hare » impose le scrutin à vote unique transférable. Les électeurs classent selon leur préférence tous les candidats. Ceux qui recueillent le moins de suffrages sont écartés et leurs votes sont attribués aux autres candidats. Certes, bien plus long, le dépouillement est fastidieux. Il donne cependant une chambre assez représentative.

Il est probable que le prochain Premier ministre d’Irlande du Nord soit une catholique, à savoir la vice-présidente du Sinn Féin Michelle O’Neill. Une grande première ! En effet, avec 29 %, soit un point de plus, le Sinn Féin obtient 27 sièges. Le DUP n’en remporte que 25, ne fait que 21,4 % et perd 6,7 points. Une partie non négligeable de son électorat a privilégié la TUV (Voix unioniste traditionnelle) qui passe en cinq ans de 20 523 votes à 65 788, soit 7,6 % et un gain de cinq points. La TUV n’a toutefois qu’un seul élu. Les formations modérées, parrains des accords du Vendredi Saint conclus sous l’égide de l’Union pseudo-européenne, reculent encore. Avec neuf sièges, le Parti unioniste d’Ulster obtient 11,1 % et perd près de deux points. Le Parti social-démocrate et travailliste maintient ses 8 sièges malgré une régression de 2,9 points (9 %). Mouvement populiste d’extrême gauche, « Le peuple avant le profit », réunit 1,15 % et garde son unique siège. En revanche, l’Alliance qui rejette le critère structurant conflictuel entre catholiques et protestants réalise 13,5 %, soit 4,5 points de plus et remporte 17 sièges. Ce succès traduit la lassitude des nouvelles générations qui n’adhèrent plus aux clivages religieux. Il s’explique aussi par l’apparition d’Irlandais d’origine immigrée souvent musulmans. Ces deux données sont à prendre en considération pour les décennies à venir.
Il ne faut pas se réjouir de cette élection. Longtemps vitrine politique de l’IRA (Armée républicaine irlandaise), le Sinn Féin agit tant au Nord qu’au Sud de l’île. Vainqueur en Ulster, il compte déjà quatre sénateurs et 37 députés dans la République d’Irlande dont il incarne l’opposition officielle à la coalition ministérielle centriste. Né en 1970, à l’occasion de dissensions au sein des groupes paramilitaires républicains, l’actuel Sinn Féin n’est pas l’héritier direct de son homonyme du début du XXe siècle.
Très tôt, ce mouvement s’inscrit dans la gauche radicale. Son seul député européen siège aux côtés des élus grecs de Syriza, espagnols de Podemos et de La France Insoumise dans le groupe de la Gauche unitaire européenne – Gauche nordique verte. Le Sinn Féin a dénoncé les régimes militaires d’Amérique du Sud, critiqué l’apartheid en Afrique du Sud et soutenu la cause palestinienne. Lors de la crise des sans-papiers en 2015 – 2016, ses militants établissaient un parallèle spécieux avec l’exode déclenché par la Grande Famine de 1845 – 1851.

La présidente eurosceptique du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ne cache pas par ailleurs son progressisme foncier. Elle promeut l’inclusivité, le multiculturalisme, le sociétalisme et le gendérisme sans oublier l’avortement, le féminisme et l’homoconjugalité. Le supposé nationalisme du Sinn Féin relève du nationalisme civique contractualiste, négateur des appartenances identitaires charnelles effectives… Il faut par conséquent le considérer comme l’avant-garde du « national-cosmopolitisme ». De leur côté, par leur proximité historique et symbolique avec la franc-maçonnerie et le biblisme politique vétéro-testamentaire, sous la bannière de Dieu, du Royaume Uni et de la Couronne, les unionistes défendent les Afrikaners et l’État d’Israël. Ils s’enferment dans un passéisme muséal. Leur conservatisme moral et sociétal n’a pas empêché la légalisation du « mariage » homosexuel en Ulster. Force est de constater que ces deux camps rivaux nuisent au destin civilisationnel de l’Europe impériale.
Sauf coup de théâtre, l’Irlande et l’Ulster ne se réunifieront pas dans les prochaines années. Grâce au Brexit, la Verte Erin forme déjà au quotidien un seul ensemble douanier puisque la frontière « euro-britannique » passe en mer d’Irlande. Cette réalité enrage les unionistes favorables à l’établissement d’une véritable frontière entre les deux territoires irlandais au risque possible de relancer les troubles au Nord. Cette question sera le principal sujet de discussion entre le Sinn Féin et le DUP. Pas sûr que les négociations aboutissent. Un blocage institutionnel se profile donc à l’horizon...
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 33, mise en ligne le 17 mai 2022 sur Radio Méridien Zéro.
11:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique, ulster, irlande, irlande du nord, royaume-uni, sinn fein, europe, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 18 mai 2022
La russophilie et la russophobie comme facteurs géopolitiques en Europe de l'Est

La russophilie et la russophobie comme facteurs géopolitiques en Europe de l'Est
par le comité de rédaction de Katehon
Source: https://www.ideeazione.com/russofilia-e-russofobia-come-fattori-geopolitici-nelleuropa-orientale/
Le rôle clé dans la position des pays est joué par la présence ou l'absence d'élites souveraines au pouvoir.
L'opération militaire spéciale (SVO, abréviation russe) menée par la Russie en Ukraine dure depuis trois mois et est loin d'être terminée. Cette longue campagne n'aurait pas été possible sans l'assistance militaire sans précédent de l'OTAN au régime ukrainien. Les pays d'Europe de l'Est limitrophes de l'Ukraine jouent un rôle clé à cet égard. D'une part, c'est par le territoire de ces États que passent les livraisons d'équipements militaires. Ils fournissent également de vieilles armes soviétiques, avec lesquelles l'armée ukrainienne a l'habitude de travailler. D'autre part, ce sont ces pays qui accueillent la plus grande part des réfugiés ukrainiens. Ils supportent les principaux coûts et risques d'une confrontation avec la Russie.
Dans cette optique, le facteur idéologique acquiert une importance particulière. La russophobie ancrée dans la psychologie nationale ou, au contraire, une attitude traditionnellement amicale ou neutre envers la Russie peuvent être des facteurs influençant la stabilité dans un pays donné. À cet égard, les pays d'Europe de l'Est ne sont pas homogènes.
Slovaquie
En avril, les autorités slovaques ont livré à l'Ukraine leur système unique de défense aérienne S-300. La livraison du complexe a eu lieu en secret. L'opposition s'est fortement opposée à ce geste. Elle a accusé les autorités slovaques d'entraîner le pays dans le conflit et de réduire ainsi la capacité de défense du pays. Les États-Unis ont promis d'envoyer des systèmes de défense aérienne Patriot à la Slovaquie. Toutefois, ils seront contrôlés par du personnel militaire non slovaque, ce qui prive la Slovaquie du contrôle de son espace aérien, dé-souverainisant de la sorte ce petit pays.

L'ancien premier ministre slovaque et leader du parti Smer-SD, Robert Fico (photo), affirme que "le transfert des S-300 pour la défense aérienne à l'Ukraine est un acte de guerre aux conséquences imprévisibles pour la Slovaquie".
Malgré les protestations, le Premier ministre slovaque Eduard Heger est allé plus loin et, le 12 avril, a proposé de fournir des avions MiG-29 slovaques à l'Ukraine. L'armée de l'air slovaque possède une douzaine de ces appareils. Auparavant, même la Pologne n'osait pas prendre une telle mesure, craignant les attaques russes sur son territoire. Dans le même temps, malgré la propagande anti-russe, un tiers des Slovaques soutiennent l'opération militaire spéciale russe en Ukraine.
Le 4 mai, la Slovaquie a également annoncé qu'elle était prête à réparer les équipements militaires ukrainiens endommagés. Ainsi, la république, où les sentiments pro-russes, a-t-on noté, étaient les plus prononcés parmi tous les pays d'Europe centrale avant l'opération militaire spéciale, est la plus intensément impliquée dans les hostilités parmi tous les pays du flanc oriental de l'OTAN. La raison en est que ce pays est le moins "sujet" de sa propre histoire. En 2018, la Slovaquie a connu sa "révolution colorée", les manifestations "anti-corruption" fomentées par l'Occident ont conduit à la démission de Robert Fico, puis à la perte de la majorité parlementaire par le parti Smer-SD. Le gouvernement slovaque peut être contraint de faire ce que même la Pologne n'ose ouvertement pas faire. Cette politique s'accompagne de répressions : ils tentent de priver Robert Fico de son mandat de député et l'arrêtent pour avoir divulgué des informations sur les violations fiscales de ses adversaires (les informations auraient été obtenues illégalement). Auparavant, un autre leader de l'opposition, le chef du parti populiste de droite Notre Slovaquie, Marian Kotleba, a été privé de son mandat parlementaire sur la base d'accusations forgées de toutes pièces.
Pologne
Le 30 mars, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que la Pologne "établissait des normes d'un certain type" sur ce que l'on appelait auparavant la russophobie. Varsovie se sent comme un nouveau centre de l'Europe qui, sur la vague du sentiment anti-russe, tente de démontrer son leadership. D'une part, cela s'applique à la France et à l'Allemagne. D'autre part, la Hongrie. Le vice-premier ministre du gouvernement polonais et véritable leader du parti au pouvoir Droit et Justice, Jaroslaw Kaczynski, a déclaré que la Pologne "ne peut plus coopérer" avec la Hongrie tant que celle-ci ne change pas de cap.
Nous parlons de la coopération entre la Hongrie et la Russie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban tente de bloquer toute tentative d'imposer des sanctions européennes sur le gaz et le pétrole russes, car elles "tueraient la Hongrie". La Hongrie est également le seul pays européen à réclamer une enquête objective et indépendante sur la tragédie de Bucha. D'autres ont déjà accusé la Russie de tout.
"Lorsque le Premier ministre Orban dit qu'il ne peut pas voir ce qui s'est exactement passé à Bucha, on devrait lui conseiller de consulter un ophtalmologue", a poursuivi le chef du parti Droit et Justice au pouvoir.
Malgré la tentative de la Pologne de jouer les premiers violons dans le concert russophobe des puissances occidentales, cela n'a pas amélioré ses relations avec Bruxelles. Les dirigeants conservateurs de la Pologne sont depuis longtemps en conflit prolongé avec les dirigeants de l'UE. Pour cette raison, l'UE a suspendu l'allocation de fonds à la Pologne.

Le 4 mai, le président polonais Andrzej Duda (photo) a déclaré dans une interview au Wall Street Journal que pour lui "la présence de troupes américaines dans notre région" est une garantie contre "l'expansion de la politique impériale russe". Il a souligné qu'il serait "très heureux si ces troupes restaient ici de façon permanente".
Hongrie
La décision de Viktor Orban de payer le gaz russe en roubles pourrait entraîner l'isolement de la Hongrie, a menacé le ministre allemand de l'économie Robert Habeck.
Selon lui, les actions du Premier ministre hongrois contredisent la décision du G7 de payer l'énergie russe dans les devises stipulées dans les contrats: dollars et euros. Ainsi, l'UE commence déjà à mettre en œuvre sa politique d'isolement, qui a été clairement évoquée en prévision de la victoire électorale d'Orban.
La position de la Hongrie a été critiquée par d'autres pays de l'OTAN et de l'UE pendant les mois de l'opération militaire spéciale. Les dirigeants ukrainiens ont accusé Budapest de planifier la saisie de territoires ukrainiens (sans noter l'existence de tels plans en Pologne). En conséquence, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est retrouvé sur le site Myrotvoretz dans la liste des ennemis de l'Ukraine.
Dans l'UE, la Hongrie s'oppose fermement aux plans visant à imposer un embargo pétrolier à la Russie, même avec une prolongation pour la Hongrie et la Slovaquie jusqu'à la fin de 2023. Parmi les pays d'Europe centrale et orientale, la Hongrie adhère à la position la plus indépendante, ce qui complique la construction d'un front commun anti-russe.
Roumanie
En Roumanie, le pompage de la société par la propagande anti-russe a conduit à une attaque terroriste contre l'ambassade de Russie le 6 avril, lorsqu'un citoyen local faisant l'objet d'une enquête pour pédophilie s'est déclaré ukrainien et a foncé sur les grilles de l'ambassade de Russie à Bucarest, après quoi il s'est immolé avec sa voiture.
La Roumanie, en cas d'escalade du conflit en Transnistrie, pourrait prendre le contrôle de la République de Moldavie, selon des sources médiatiques russes. Le sud de la Bessarabie - une partie de la région ukrainienne d'Odessa, séparée du principal territoire ukrainien par une barrière naturelle - l'estuaire du Dnestr - revêt également une importance stratégique pour la Roumanie.
La Roumanie, comme la Pologne, joue un rôle clé dans l'approvisionnement de l'Ukraine en carburant et en armes occidentales. La présence des troupes américaines dans le pays augmente. Dans le même temps, la Roumanie intensifie sa coopération avec l'Ukraine pour envoyer des marchandises via la Moldavie. Par conséquent, la Roumanie devient d'une importance capitale dans la fourniture d'armes au sud de l'Ukraine et à la région d'Odessa et dans l'exportation de produits ukrainiens.

Bulgarie
En Bulgarie, des manifestations ont eu lieu tout au long du mois d'avril contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Les manifestations étaient organisées par le parti parlementaire "Vazrazhdane" ("Renaissance"). Le président Rumen Radev (photo) s'est opposé à la fourniture d'une assistance militaire à l'Ukraine. La décision de Gazprom de suspendre les ventes de gaz à la Bulgarie a heurté les positions des russophiles bulgares. Cependant, cette situation a été causée par le refus du gouvernement du pays lui-même d'acheter du gaz en roubles.
Le 4 mai, le parlement bulgare (à l'exception des députés de Renaissance) a voté en faveur de la fourniture d'une assistance humanitaire et militaro-technique à l'Ukraine. Kiev souhaiterait réparer ses équipements militaires en Bulgarie et exporter des céréales via le port de Varna (les ports roumains sont déjà pleinement utilisés par l'Ukraine). Le président Radev a critiqué la décision du parlement, déclarant qu'"il y a un danger d'entraîner la Bulgarie dans ce conflit". Selon le chef de l'État, "le conflit ne sera pas court, il s'intensifiera et nécessitera des solutions raisonnables, et le terme même d'"assistance militaro-technique" est plutôt vague et risqué".
Il convient de noter qu'en Bulgarie, le niveau de soutien à la Russie au cours des derniers mois (février à mai) a chuté de 32% à 25%. En même temps, il faut tenir compte du fait que dans le contexte de la propagande hystérique anti-russe et de la réticence de nombreux Bulgares à parler aux sociologues de leur véritable état d'esprit, par peur de la répression et de l'ostracisme, dans le contexte du discours anti-russe dominant dans les médias, 25% est un chiffre substantiel. Dans cette situation, au moins un quart de la population déclare ouvertement son désaccord avec le récit anti-russe.
Grèce
En Grèce, tout comme en Bulgarie, des manifestations contre la fourniture d'armes à l'Ukraine ont eu lieu début avril. Cependant, aujourd'hui, les principaux arguments des manifestants sont la critique de l'augmentation des prix de l'énergie associée à l'adhésion de la Grèce aux sanctions anti-russes.
En général, les facteurs de russophilie ou de russophobie ne jouent pas un rôle particulier en Grèce. Les principales forces anti-guerre du pays sont la gauche. La détérioration de la vie des gens ordinaires est un facteur clé pour contrer l'implication dans le conflit. En général, dans les pays de l'OTAN d'Europe de l'Est, le facteur russophilie et russophobie joue un rôle en Slovaquie et en Bulgarie, où les forces pro-russes étaient auparavant au moins un peu évidentes. C'est dans ces pays que se pose aujourd'hui la question de la stabilité politique et d'éventuelles élections anticipées en raison de problèmes politiques internes, mais un facteur externe agit comme un catalyseur : le conflit en Ukraine et la perspective d'être entraîné dans une guerre avec la Russie.
Dans les États baltes, en Pologne et en Roumanie, la situation est plus stable. Toutefois, d'une manière générale, la pression de Washington, Londres et Bruxelles est si forte que l'opposition des forces pro-russes en Bulgarie et en Slovaquie risque d'être brisée. Le rôle clé dans la position des pays, comme le montre l'exemple de la Hongrie, est joué par la présence ou l'absence d'élites souveraines au pouvoir. Dans le premier cas, même l'expérience historique relativement négative des relations avec la Russie ne fait pas obstacle à une évaluation sobre de la situation. Au contraire, dans les pays totalement dépendants de l'Occident et dotés d'élites faibles, aucune expérience historique positive ne joue un rôle particulier ; de plus, il est possible en peu de temps de "raviver" la conscience de la majorité de la société par une exposition médiatique intense.
16 mai 2022
18:57 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, europe, pologne, slovaquie, hongrie, roumanie, bulgarie, grèce, peco, europe centrale, europe orientale, ukraine, affaires européennes, politique internationale, russophilie, russophobie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'ingérence américaine et la haine historique de la Russie
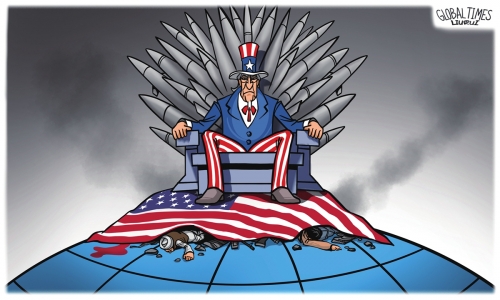
L'ingérence américaine et la haine historique de la Russie
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2022/05/05/amerikkalaismietteita-ja-historiallista-venaja-vihaa/
Le réalisateur Oliver Stone se demande sur Facebook "si les États-Unis préparent le terrain pour une explosion nucléaire de faible puissance quelque part dans le Donbass qui tuerait des milliers d'Ukrainiens".
Une opération sous faux drapeau aussi choquante est possible, car les médias occidentaux, attelés à la guerre de l'information, ont déjà entraîné de nombreuses personnes à n'imaginer que le pire de la Russie. Le bouc émissaire a déjà été choisi à l'avance, Poutine, que l'on a traité de fou, sans tenir compte de qui pourrait réellement mener une attaque aussi tragique.
"Il faudrait probablement quelques jours pour découvrir la vérité, mais la vérité n'a pas d'importance", dit Stone. Les perceptions sont, le cinéaste le sait, et admet que les États-Unis "mènent une guerre des images avec une grande habileté et une force éprouvée", saturant les chaînes CNN et Fox et les pays satellites de Washington en Europe et en Asie d'une manière que même Stone n'a jamais vue auparavant.
Une frappe nucléaire choquante nous rapprocherait un peu plus du désir des États-Unis de renverser le régime russe actuel et de le remplacer par un régime fantoche pro-occidental dirigé par un "nouvel Eltsine". Plus important encore, cela isolerait également la Chine de la Russie.
Comme je l'ai déjà affirmé, la Chine est la prochaine cible de l'Occident si la Russie tombe. C'est le scénario de rêve des fauteurs de guerre néo-conservateurs américains, conçu pour créer ce qu'ils considèrent comme une version améliorée et actualisée de "l'ordre international fondé sur des règles".
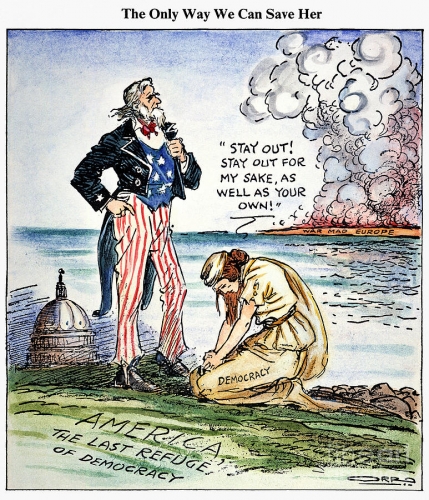
La superpuissance anti-russe en cours nous dit tout ce que nous devons savoir sur les objectifs et les ambitions hégémoniques des néoconservateurs. Les "kaganistes" (du nom du belliciste Robert Kagan) agissant au nom de Biden ont clairement fait savoir qu'ils mènent une guerre contre la Russie, avec la crise ukrainienne comme mandataire, dans le but d'épuiser la Russie et d'éliminer Poutine.
Un événement sous faux drapeau n'est pas le seul moyen de déclencher une guerre majeure. L'expansion de l'OTAN en Finlande et en Suède en est une autre, a observé Paul Craig Roberts. Il affirme que "Washington ne se contente pas de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils demandent l'adhésion à l'OTAN, mais qu'il soudoie également des fonctionnaires suédois et finlandais pour qu'ils le fassent."
Considérons un instant cet élargissement de l'OTAN. L'une des raisons de l'intervention de la Russie en Ukraine est le refus obstiné de Washington et de l'OTAN de prendre au sérieux les préoccupations de la Russie en matière de sécurité. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN constitue une ligne rouge pour la Russie, alors pourquoi l'a-t-on favorisée? Alors que l'intervention occidentale en Ukraine menace de faire dérailler le conflit, pourquoi verser de l'huile sur le feu en faisant entrer la Finlande et la Suède dans l'OTAN?
Pour l'instant, la Scandinavie et la Baltique sont dénucléarisées. L'adhésion de la Finlande à l'alliance militaire amènerait "plus d'OTAN" à la frontière russe et le Kremlin a déclaré qu'une telle évolution était inacceptable. "En accumulant les provocations, Washington et l'OTAN intensifient un conflit qui est délibérément créé", critique M. Roberts.
L'auteur américain estime qu'il est "irresponsable pour la Finlande et la Suède de déstabiliser davantage la situation en rejoignant l'OTAN". Même l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, de l'aile libérale du régime, a clairement indiqué que "l'adhésion à l'OTAN signifierait la fin des États baltes dénucléarisés".

Le renforcement de la présence de l'OTAN aux frontières de la Russie crée un déséquilibre que la Russie devra corriger d'une manière ou d'une autre. "Comment est-il possible que les gouvernements finlandais et suédois croient que l'adhésion à l'OTAN renforcera la sécurité alors que le résultat est que des armes nucléaires sont dirigées contre eux?" demande Roberts avec étonnement.
La Finlande et la Suède ne risquent pas d'être attaquées par la Russie si elles restent en dehors de l'OTAN. Personne de sensé ne verrait dans l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN autre chose qu'une démarche imprudente qui accroîtra l'instabilité sécuritaire dans la région.
La Finlande, comme la Suisse, a bénéficié de sa neutralité passée, mais il semble maintenant que les longues années du président Sauli Niinistö à promouvoir les intérêts occidentaux commencent à porter des fruits et des fruits radioactifs. La Finlande officielle semble prête à devenir la ligne de front de l'OTAN-Occident contre la Russie.
Mais revenons aux néo-conservateurs américains qui se déchaînent maintenant dans l'administration Biden. Au cœur des fantasmes de suprématie des néo-conservateurs américains semble se trouver une idéologie extrémiste expansionniste.
L'empire mondial américain s'étend vers la Russie et la Chine, car l'élite dirigeante de l'Occident ne tolère aucun rival et veut dominer seule la planète entière et ses ressources. Pour atteindre cet objectif, le cartel des banques centrales et ses sbires, les "kaganistes" de l'administration Biden, sont prêts à détruire l'Europe en même temps.
Selon une conversation ayant fait l'objet d'une fuite anonyme du département d'État américain, la vétérane de la déstabilisation de l'Ukraine, la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques Victoria Nuland, déteste les Russes plus que les Européens.
Il n'y a rien de nouveau en soi. Les Juifs influents d'origine est-européenne vivant en Amérique, qui, dans les années 1960, sont passés de la gauche trotskiste anti-stalinienne aux deux camps, le démocrate et le républicain, ont un profond ressentiment historique à l'égard des Russes et des Européens.
Il est donc plutôt désagréable de voir les mêmes Européens que ces néocons méprisent soutenir avec enthousiasme une guerre hybride contre la Russie qui, en cas de succès, détruirait également l'Europe.
Même la Finlande, qui est territorialement plus grande que ne l'est son poids réel, est impliquée dans ce projet délirant des anciens trotskistes, et le sorcier occidental toujours prêt Petteri Orpo du Parti de la coalition a déjà laissé entendre que "la Finlande, en tant que membre de l'alliance de défense de l'OTAN, ne devrait pas refuser catégoriquement d'accueillir des armes nucléaires sur son territoire".
Malgré ce que les médias du pouvoir local essaient de nous dire, la Russie a très longtemps fait confiance à la raison, à la négociation et à la bonne volonté dans sa politique, même si le Kremlin n'a reçu aucune réponse à sa diplomatie de la part de l'Occident.
Même l'opération militaire limitée en Ukraine n'a pas réussi à convaincre l'Occident d'abandonner sa politique de provocation. "Il semble que Washington poursuivra ses provocations jusqu'à ce que la limite fatale soit franchie", estime également M. Roberts.
18:36 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, finlande, suède, mer baltique, états-unis, bellicisme, bellicisme américain, néoconservateurs, kaganistes, politique internationale, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La Finlande, la Suède et le jeu à somme nulle de l'Occident

La Finlande, la Suède et le jeu à somme nulle de l'Occident
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2022/05/16/suomi-ruotsi-ja-lannen-nollasummapeli/
"Il y a une ironie triste et plutôt pathétique dans l'adhésion attendue de la Finlande et de la Suède à l'OTAN", écrit l'auteur, journaliste et politologue britannique Anatol Lieven.
Pendant la guerre froide, l'Union soviétique était une superpuissance militaire qui occupait une grande partie de l'Europe centrale. Avec les troupes russes stationnées au cœur de l'Allemagne, le communisme soviétique semblait, pour un temps du moins, être une menace et une contre-force pour la démocratie capitaliste occidentale.
Malgré cette époque politiquement difficile, "la Finlande et la Suède sont néanmoins restées officiellement neutres au cours de ces décennies", rappelle Lieven.
Dans le cas de la Finlande, la neutralité était une condition du traité avec Moscou qui a mis fin à la guerre entre les deux pays. La Suède, en revanche, a joué ses cartes pour être "sous le parapluie de la sécurité américaine sans avoir à apporter la moindre contribution ou à prendre le moindre risque pour elle".
Les avantages psychologiques pour l'Ouest étaient également importants. Lieven affirme que "la Suède bénéficiait de la protection des États-Unis et était en même temps libre d'afficher sa prétendue supériorité morale sur l'Amérique impérialiste et raciste lorsque l'occasion se présentait".
Après la fin de la guerre froide, la Russie a reculé de mille kilomètres vers l'est, tandis que l'OTAN et l'Union européenne n'ont fait qu'étendre leur territoire. Au cours de ces années, la Russie ne s'est pas révélée être une menace concrète pour ses voisins du nord.
Pendant et après la guerre froide, Moscou n'a jamais menacé Helsinki. L'Union soviétique a respecté les termes de son traité avec la Finlande. Elle a même décidé de se retirer de la base militaire de Porkkala, qui, selon le traité, aurait pu y rester pendant encore quarante ans.
Il n'y avait aucune raison de penser que la Russie allait changer cette politique et attaquer la Finlande. Dans le cas de l'Ukraine, la situation était complètement différente et les raisons de l'opération de Moscou sont évidentes si l'on est capable d'examiner l'histoire récente de la région et le rôle de l'Occident dans une perspective de realpolitik.
Comme le souligne également Lieven, "depuis le début de l'expansion de l'OTAN dans les années 1990, tant les responsables russes qu'un certain nombre d'experts occidentaux - dont trois anciens ambassadeurs américains à Moscou et l'actuel directeur de la CIA - ont averti que l'entrée de l'Ukraine dans une alliance anti-russe conduirait probablement à la guerre".
Pourquoi les membres européens de l'OTAN sont-ils si désireux d'une nouvelle confrontation avec la Russie ? Selon Lieven, l'une des raisons est que la situation actuelle donne aux pays de l'euro une excuse pour éviter d'envoyer des troupes en dehors de l'Europe (comme en Afrique de l'Ouest), où l'implication dans des conflits locaux "créerait de réelles menaces pour la sécurité intérieure de l'Europe et de la Scandinavie sous la forme d'extrémisme islamiste et d'immigration massive".
La Finlande a immédiatement rejoint les rangs des fournisseurs d'armes dans la nouvelle phase du conflit ukrainien. L'info-guerre dans les médias grand public s'est également intensifiée, et pas un jour ne s'est écoulé sans que Poutine et la Russie ne fassent les gros titres sous un jour extrêmement négatif. La Finlande officielle a choisi sa voie sans consulter le public et les journaux du soir annoncent à grand renfort de publicité "comment la Finlande entre fièrement dans l'OTAN dès sa porte d'entrée". La décision de la Finlande suscite également la suspicion dans le monde entier.
"En rejoignant l'OTAN, la Finlande jette à la poubelle la mince chance qu'elle avait de pouvoir encore agir comme médiateur entre la Russie et l'Occident, non seulement pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais aussi pour promouvoir une réconciliation plus large à un moment donné dans le futur. Au lieu de cela, la Finlande achève la dernière partie d'une nouvelle frontière de la guerre froide qui existera probablement même après l'administration russe actuelle", conclut Lieven.
L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN peut également être considérée comme "un moment symbolique où les pays d'Europe dans leur ensemble ont abandonné le rêve d'assumer la responsabilité de leur propre continent et se sont soumis à une dépendance totale vis-à-vis de Washington".
Cette dépendance sera couverte par des "pleurnicheries et des grognements européens impuissants" lorsqu'"un nouveau président à la Trump" prendra la tête de la Maison Blanche et rejettera la moindre courtoisie et consultation de ses "partenaires transatlantiques".
Depuis la fin de la guerre froide, la politique des États-Unis et de l'OTAN envers la Russie est un sinistre jeu à somme nulle. Washington a pris l'initiative et les pays européens ont suivi. La Finlande rejoint maintenant cet "entourage boiteux et titubant". Lieven ne croit pas que "les bonnes relations de la Finlande avec la Russie" seront rétablies, quel que soit le régime au pouvoir à Moscou.
D'autre part, l'expulsion complète de la Russie des structures européennes - qui est depuis longtemps un objectif ouvert des États-Unis et de l'OTAN - pourrait, à long terme, rendre la Russie complètement dépendante de la Chine sur le plan stratégique et amener la superpuissance asiatique jusqu'aux frontières orientales de l'Europe.
Un tel résultat serait "une récompense ironique mais méritée pour la stupidité stratégique de l'Europe", déclare Lieven.
Aperçu de la Realpolitik
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2022/05/13/reaalipoliittinen-tilannekatsaus/
Comme tout le monde le sait déjà, le gouvernement finlandais a décidé de demander l'adhésion à l'OTAN. Le théâtre politique a culminé hier, jour de la Finlande, avec l'annonce par le Président et le Premier ministre de leurs positions prévisibles.
Le passage à l'OTAN est prévu depuis longtemps, pas vraiment en raison d'un quelconque "changement de la situation sécuritaire", mais en raison d'une tentative désespérée des États-Unis de conserver au moins une partie de leur ancienne domination.
Toutefois, le dernier revirement n'est pas aussi spectaculaire que certains l'imaginent. Je ne crois pas non plus que la Russie prendra des contre-mesures très fortes, comme une frappe militaire ou quelque chose de similaire. Bien sûr, tant les fanatiques de l'OTAN que les amis de la Russie s'attendent à une certaine réaction.
Quoi qu'il en soit, le Kremlin est conscient que les politiciens finlandais sont depuis longtemps préparés par des organisations occidentales. En tant que pays, nous faisons déjà partie, non seulement de la malheureuse Union européenne, mais aussi de la sphère d'influence plus large, dirigée par les États-Unis. Cela continuera tant que le groupe d'intérêt anglo-américain existera.
Les professionnels et amateurs de la politique de sécurité occidentalisée de la Finlande n'ont pas de chance avec ce dernier pari. Certains d'entre eux souhaitent que la Finlande rejoigne l'OTAN depuis des décennies. J'ai moi-même une opinion négative de l'alliance militaire, mais ces dernières années, j'ai commencé à me laisser aller à un certain nihilisme politique de temps en temps.
Quelle est l'importance de ces mouvements de politique étrangère et de sécurité, après tout ? Les années de la pandémie ont révélé que, malgré leurs différends, les représentants de la classe possédante (les "mondialistes" des grands cercles capitalistes) et les acteurs clés des différents États semblent avoir une compréhension mutuelle de l'orientation de l'ordre mondial.
La restructuration économique, politique et sociale à grande échelle des sociétés se poursuit et, que le monde devienne "bipolaire" ou "multipolaire", les mêmes mesures technocratiques sont prises dans le monde entier, en Occident comme en Russie, en Chine et ailleurs.
Oui, tout cela semble plutôt déprimant. Il ne fait aucun doute que la classe capitaliste mondiale observe ce spectacle en constante évolution depuis ses bureaux et ses manoirs, en riant. La spirale du profit du complexe militaro-industriel (ainsi que de l'industrie pharmaceutique) se poursuit, sans grande résistance collective. L'Eurovision et le hockey sur glace sont au programme, et l'été est sur le point de commencer.
Une fois le brouillard de la guerre levé, les nouvelles identités numériques seront prêtes à être utilisées, et les vaccinations pour le fameux virus deviendront un rituel annuel. Nous sommes déjà en train de passer d'États-nations largement délabrés à la bruyante "gouvernance mondiale" dont rêvent depuis des décennies certains "philanthropes", investisseurs, membres de la royauté, banquiers centraux et technocrates.
Reste à savoir si ce nouvel ordre mondial se présentera sous la forme de "superpuissances" ou de "blocs" - un triomphe à la Pyrrhus de la démocratie des neiges et du libéralisme anglo-américain, un rêve socialiste en caractères chinois, ou simplement une technocratie mondiale érigée par une classe de milliardaires.
13:17 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : neutralité, suède, finlande, mer baltique, europe, affaires européennes, politique internationale, otan, atlantisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Neutralité en échange d'un parapluie de l'OTAN

Neutralité en échange d'un parapluie de l'OTAN
Yana Zubchuk
Source: https://www.geopolitika.ru/article/neytralitet-v-obmen-na-zontik-nato
L'opération militaire spéciale en Ukraine a entraîné un effet de peur en Europe. Les anciens neutres - Finlande, Suède, Autriche et Suisse - évaluent la pertinence de leur politique traditionnelle de non-alignement.
Le fait que la Finlande et la Suède parlent d'adhérer à l'OTAN, en particulier, a littéralement détruit des années de tradition et de conviction qu'elles favorisaient en assurant au mieux la paix en Europe et en ne rejoignant pas ouvertement l'alliance occidentale. Les deux pays, s'ils étaient unis, pourraient apporter une puissance de feu considérable pour défendre l'Europe du Nord contre toute invasion - la Finlande avec son infanterie légendaire et la Suède avec son importante marine en mer Baltique.
Avec les membres fondateurs de l'OTAN, la Norvège et le Danemark, et les partenaires relativement récents que sont la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie (2004), ces pays forment, selon les analystes occidentaux, un pilier solide et fiable de l'Europe du Nord. Il n'est pas surprenant que les trois États baltes fassent activement pression pour l'annexion à l'OTAN la plus rapide possible de leurs deux voisins scandinaves, car la peur de la Russie parmi les trois États ne fait que croître de manière exponentielle année après année.
Qualifier l'Autriche et la Suisse de neutres était, du moins depuis la fin de la guerre froide, quelque peu trompeur. Les deux pays sont de solides démocraties occidentales, comme leurs voisins, et comptent sur la protection de l'OTAN ainsi que sur leurs propres forces armées pour leur politique de sécurité.
Les forces armées suisses sont certes plus fortes que celles de l'Autriche, qui a supprimé le militarisme, comme l'Allemagne, après les expériences désastreuses des deux guerres mondiales. Cependant, l'exemple de l'Ukraine a conduit à la prise de conscience, ou même au coup de pouce, pour croire que les deux républiques alpines avaient des lacunes dans leur force militaire et que si elles espéraient être protégées par l'OTAN, elles devaient jouer du côté occidental des barricades plutôt que d'attendre leur heure dans la politique de neutralité. L'Occident attend désormais de ces républiques qu'elles contribuent davantage à la sécurité européenne.

L'Autriche, bien sûr, est un État membre de l'UE et devrait participer pleinement aux futurs arrangements en matière de politique de sécurité. Cependant, dans cette situation, beaucoup ont été surpris par la position de la Suisse, traditionnellement neutre, et son acceptation totale des sanctions de l'UE contre la Fédération de Russie. Le véritable test de la conformité suisse sera le fait que tous les flux de combustibles fossiles de la Russie vers l'Europe feront l'objet de sanctions, étant donné que la majeure partie des négociants concernés résident en Suisse.
C'est ce qu'a déclaré récemment Stefan Holenstein, président de l'une des plus grandes associations de soldats de Suisse, à propos de la relation de la Suisse avec l'OTAN. Cela peut sembler frivole, mais M. Holenstein était sérieux : son avis, motivé par l'Opération de la Russie en Ukraine, était que la Suisse devait coopérer plus étroitement avec le bloc de l'OTAN, sans pour autant en faire partie.
Il s'agit d'une proposition innovante pour un pays situé au cœur de l'Europe, qui n'est pas membre de l'OTAN ou de l'Union européenne, qui n'a rejoint les Nations unies qu'en 2002 et qui, à part l'envoi de quelques officiers, n'a jamais participé à des exercices militaires complets impliquant les pays de l'OTAN environnants, estimant que la politique stricte de neutralité militaire inscrite dans la constitution suisse l'interdit. En raison de l'opération militaire spéciale en Ukraine, M. Holenstein souhaite que la Suisse fasse enfin partie de la structure sécuritaire et militaire européenne et qu'elle en assume une certaine responsabilité.
Soudain, les politiciens et les médias suisses s'enflamment sur la question de la neutralité. La semaine dernière, Damien Cottier, membre libéral du Parlement suisse, a déclaré que les Suisses ont trop longtemps pensé que le fait d'être entouré de pays de l'OTAN signifie automatiquement qu'ils seront eux aussi protégés. Ceci, a-t-il écrit dans Le Temps, est "une dangereuse chimère". Notre pays ne peut pas être un passager clandestin lorsqu'il s'agit de la sécurité européenne".
Le monde a déjà vu la Finlande et la Suède - deux pays de l'UE qui, comme la Suisse, ont une longue tradition de neutralité militaire - commencer à envisager sérieusement de demander leur adhésion à l'OTAN, et pourraient en vérité l'accepter d'un jour à l'autre. Un changement notable s'opère également au Danemark, un allié de l'OTAN dont le gouvernement espère désormais inverser la politique actuelle du pays qui consiste à rejeter les projets de défense de l'Union européenne dès le référendum de juin prochain.

Ces pays scandinaves sont soudainement arrivés à la conclusion que "deux polices d'assurance-vie valent mieux qu'une", a déclaré un expert en sécurité sous couvert d'anonymat. La Suisse est géographiquement plus éloignée de la Russie que les pays nordiques. Mais elle aussi ressent le besoin de s'engager plus fermement dans un système occidental de garanties mutuelles de sécurité.
Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont l'équilibre stratégique du pouvoir en Europe est en train de changer. La neutralité militaire héritée de l'Europe du 20ème siècle semble devenir rapidement une chose du passé. Bien que lorsque des guerres ont été menées, par exemple en Afghanistan, ces pays ont été les premiers à crier leur neutralité, alors qu'est-ce qui a changé ?
L'adhésion à l'OTAN reste profondément impopulaire parmi les Suisses ; seuls 33 % d'entre eux approuvent l'adhésion de l'État au bloc militaro-politique. Mais le soutien de l'opinion publique en faveur d'une coopération plus étroite avec l'Alliance atlantique a augmenté ces dernières semaines, et certains Suisses veulent se rapprocher de l'OTAN autant que la constitution de leur pays le permet. "La guerre en Ukraine est une onde de choc pour nous", a déclaré Jean-Marc Rickli, responsable des risques mondiaux et émergents au Centre de politique de sécurité de Genève, qui a rédigé sa thèse de doctorat sur les États européens neutres après la guerre froide.
La Suisse n'est pas disposée à aller aussi loin que la Suède et la Finlande, non seulement parce que la neutralité est inscrite dans la constitution suisse, mais aussi parce que la neutralité est un élément important de la perception que la Suisse a d'elle-même, qui ne lui permet pas de conclure une quelconque alliance militaire, mais bien sûr avec une clause de protection mutuelle "au cas où".
Dans des pays comme la France et l'Allemagne, la langue, la religion et une histoire commune ont façonné l'identité nationale. Mais la Suisse compte quatre langues nationales, plusieurs religions et une structure de gouvernance très décentralisée (Ses cantons ont des jours fériés, des forces de l'ordre, des politiques de santé et d'éducation publique différents). Là-bas, l'identité nationale est façonnée par le fédéralisme, la neutralité et la démocratie directe. "En d'autres termes," dit Rickli, "l'identité suisse est une identité politique. Rejoindre une organisation internationale détruirait cela."
Le plus grand parti du pays, l'Union démocratique du centre (UDC), parti nationaliste qualifié d'extrême droite, a déjà fait connaître sa position selon laquelle toute flexibilité sur le principe de neutralité mettrait en danger la souveraineté nationale. Pour l'UDC, la Suisse a franchi cette ligne lorsqu'elle a décidé de se joindre aux autres pays occidentaux dans les sanctions contre la Russie.
Cependant, plusieurs politiciens de centre-gauche et de centre-droit ont défendu les sanctions, arguant que puisque la Russie avait violé le droit international, en partie énoncé à Genève, la Suisse devait condamner la Russie. Certains ont également déclaré que la Suisse pourrait et devrait faire beaucoup plus avec l'OTAN qu'elle ne le fait actuellement.
La Suisse a rejoint le programme de Partenariat pour la paix de l'OTAN pour les non-membres en 1996, après la fin de la guerre froide. Le pays a fourni des formations et même plusieurs hélicoptères pour les missions internationales de maintien de la paix. Elle échange également des données sur la circulation aérienne avec les alliés de l'OTAN afin de prévenir les attaques terroristes depuis les airs et participe au Centre de cyberdéfense de l'OTAN en Estonie. Mais c'est à peu près tout. "Jusqu'à présent, l'interopérabilité à ce niveau tactique était la limite de ce que la Suisse pouvait faire", a déclaré Rickli. "Mais rendre possible l'interopérabilité d'unités entières avec les troupes de l'OTAN n'a jamais été à l'ordre du jour. Maintenant, on en discute soudainement."
Cette discussion a été lancée par le leader libéral de centre-droit Thierry Burckart dans un article publié dans le Neue Zürcher Zeitung le 7 avril. Selon M. Burckart, l'invasion de l'Ukraine par la Russie prouve que la politique de sécurité de la Suisse est "dans une impasse". Après tout, la Russie a classé tout l'Occident comme un ennemi ; la Suisse a été la cible de cyberattaques russes, tout comme des pays européens non neutres ; et les missiles russes pourraient facilement toucher la Suisse.
Le budget de la défense de la Suisse, qui représente actuellement un peu moins de 1 % du PIB du pays, sera augmenté, comme ailleurs en Europe. Berne vient également de commander des avions de combat F-35 de fabrication américaine. M. Burckart souhaite lier davantage d'achats à des équipements de l'OTAN afin que la Suisse puisse plus facilement effectuer des exercices militaires avec les alliés de l'OTAN et même venir en aide aux pays voisins. C'est cette incompatibilité opérationnelle que Burckart veut éliminer. Dans la région alpine, comme l'a déclaré un diplomate au magazine Foreign Policy, "vous ne pouvez pas créer un vide".
À la mi-avril, un sondage complet a montré qu'une majorité de Suisses soutient le plan de rapprochement de Burckart avec l'OTAN, y compris les exercices militaires conjoints : 56 % des Suisses souhaitent collaborer plus étroitement avec l'OTAN sous diverses formes, comme l'ont fait la Suède et la Finlande.
"Les relations entre la Suisse et l'OTAN ont oscillé entre convergence et divergence au cours des dernières décennies", a déclaré Henrik Larsen, chercheur principal au Centre d'études de sécurité de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Dans un document de recherche, il a écrit que dans un monde sûr et pacifique - surtout dans les années 1990 - les deux avaient tendance à converger. Toutefois, lorsque le monde devient de plus en plus complexe, la Suisse et l'OTAN ont moins de raisons de coopérer, comme lorsque l'OTAN s'est recentrée sur la défense collective après la réunification de la Crimée avec la Russie en 2014.
Aujourd'hui, avec l'OTAN qui renforce sa défense territoriale sur son flanc oriental, la Suisse n'a pas grand-chose à offrir, et la divergence en matière de défense et de sécurité ne fait donc que s'accroître.
Dans le passé, lorsque les Suisses pensaient à leur sécurité, ils avaient à l'esprit la sécurité de leur petit pays. Aujourd'hui, ils la voient de plus en plus dans un contexte européen plus large. Jusqu'à présent, on n'en parle que dans les cercles politiques, diplomatiques et militaires. La question de savoir si la Suisse commencera effectivement à coopérer avec l'OTAN sur le plan opérationnel sera probablement tranchée par un référendum. Si elle est approuvée, le processus pourrait prendre deux ans. Néanmoins, le fait que cette discussion ait lieu est déjà révolutionnaire selon les normes suisses.
Andorre a également oublié sa position de neutralité. Andorre a déjà réussi à imposer des sanctions économiques à des individus et des entreprises de Russie et de Biélorussie. Ces sanctions sont conformes aux mesures de l'Union européenne.
Comme l'a expliqué le ministre des Finances d'Andorre, Eric Jauver, les restrictions viseront à empêcher l'afflux massif de capitaux russes et biélorusses dans le but de contourner l'interdiction de l'UE "de ne pas utiliser Andorre comme plate-forme financière pour le mouvement de leurs actifs ou investissements".
Ainsi, le statut de "neutralité" des pays est depuis longtemps remis en question ; ils maintiennent la neutralité quand cela les arrange, et pourtant ils continuent à coopérer avec l'OTAN, même s'il s'agit d'un bloc militaire. La question se pose alors de savoir comment il est possible d'adhérer à la politique de neutralité et, en même temps, de s'engager de plus en plus dans la coopération avec l'Alliance de l'Atlantique Nord. Il convient de se rappeler que l'on doit examiner les actions et la situation non seulement de jure, mais aussi de facto, et l'on peut alors considérer que tous les pays ne sont pas aussi neutres qu'ils le disent habituellement.
13:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : neutralité, otan, suisse, autriche, finlande, suède, europe, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 15 mai 2022
Le triomphe du nationalisme nord-irlandais balkanise le Royaume-Uni alors que Johnson subit une raclée électorale

Le triomphe du nationalisme nord-irlandais balkanise le Royaume-Uni alors que Johnson subit une raclée électorale
Par Alfredo Jalife Rahme
Source: https://noticiasholisticas.com.ar/triunfo-del-nacionalismo-norirlandes-balcaniza-la-gran-bretana-global-mientras-johnson-sufre-paliza-en-elecciones-por-alfredo-jalife-rahme/
Paradoxes de la démondialisation : les dirigeants de la Grande-Bretagne (GB) et des Etats-Unis subissent une profonde répudiation sur le plan intérieur, alors qu'ils encouragent la guerre en Ukraine contre la Russie, au risque de déclencher un échange de tirs nucléaires entre les deux blocs.
La "première guerre mondiale hybride" (https://bit.ly/3KVXzZS) est en train de se dérouler - comme en conviennent l'économiste Sergei Glaziyev, proche du Kremlin, et le géopoliticien brésilien Pepe Escobar - car en Ukraine, plusieurs guerres sont menées en une seule et, surtout, les États-Unis mènent ouvertement une "guerre par procuration" contre la Russie et la Chine, puisqu'en affaiblissant Moscou, la profondeur stratégique de Pékin est diminuée.
La "guerre de propagande" qui proclame le "triomphe (sic)" du président ukrainien Zelenski, comédien de profession, sur la Russie - qui n'existe que dans les hallucinations morbides de Twitter et de Televisa avec son partenaire américain Univision - a déjà des effets délétères sur la politique intérieure britannique: effondrement de la livre sterling, défaite électorale cuisante du premier ministre conservateur Boris Johnson, hausse des taux d'intérêt, inflation, crises énergétique et alimentaire, etc.
Scénario similaire pour son allié de guerre Joe Biden - qui affiche aujourd'hui un taux de rejet de 57 %, selon le sondage de Rasmusen (https://bit.ly/3P9JgUN) - dont le front intérieur s'effondre à six mois des élections cruciales de mi-mandat qui laissent présager un tsunami trumpiste dû à l'inflation, à la crise incoercible de l'immigration, à la criminalité et à une gestion épouvantable de la santé.
Le premier ministre Johnson a subi une raclée lors des élections locales du 5 mai: "il a perdu près de 500 sièges et le contrôle de 11 conseils", les travaillistes ayant récupéré 139 sièges, selon la BBC (https://bbc.in/3PdWcJe).
Au-delà de la débâcle de Johnson, le triomphe du parti nationaliste nord-irlandais Sinn Fein - le bras politique de l'Armée républicaine irlandaise (IRA) - en faveur de son indépendance du Royaume-Uni (RU) - qui est la somme de l'Irlande du Nord et de la "GB globale". La Grande-Bretagne qui, à son tour, est l'ensemble formé par l'Angleterre/l'Écosse/le Pays de Galles -, a perdu la majorité des sièges favorables à l'Union au Parlement de l'Ulster pour la première fois en 101 ans.

Le "libéral unioniste", qui opère sur Twitter sous le nom de @SrIberist, commente : "Victoire historique pour le Sinn Fein en Irlande du Nord. La réunification de l'Irlande est une question de temps. Elle sera suivie de l'indépendance de l'Écosse et de son adhésion en tant que 28e État à l'UE. Il est intéressant de penser à ce que sera l'avenir du Royaume-Uni pour l'Angleterre et le Pays de Galles" (https://bit.ly/39cX6p3).
Il est très paradoxal que la matrice autrefois financiarisée de la mondialisation néolibérale reste éviscérée en son sein: tant par la victoire du nationalisme du Sinn Fein en Ulster, partie du Royaume-Uni/"Global GB", qu'aux États-Unis par le Trumpisme.
L'Ukraine est-elle la dernière guerre de la mondialisation ? D'où feront-ils fonctionner la machinerie financière de la mondialisation sans leurs opérateurs centraux qui sont désormais au bord de la balkanisation ?
Le premier ministre écossais pro-indépendance Nicola Sturgeon (https://bit.ly/3wkt6zb) a félicité le Sinn Fein pour "un résultat véritablement historique", alors que les sécessions de l'Irlande du Nord et de l'Écosse se nourrissent mutuellement de leur volonté d'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni/de la "GB globale".
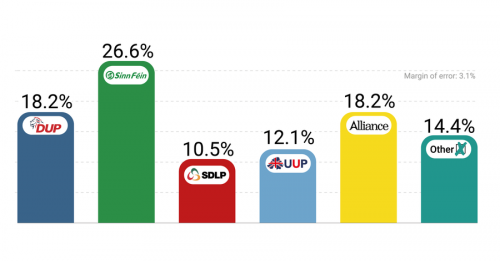
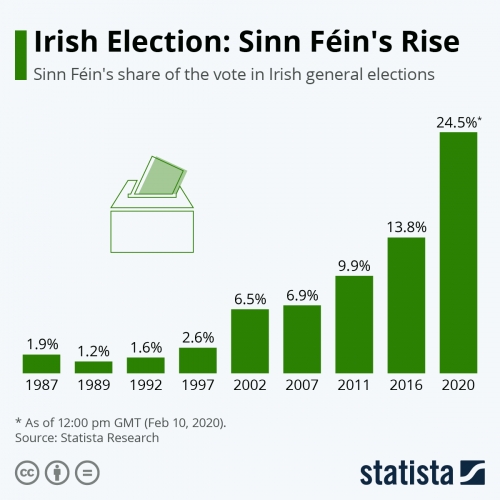
Plutôt que la sécession attendue, plus tôt que tard, de l'Irlande du Nord pour rejoindre ses frères dans une Irlande désormais indépendante, réunie, et à majorité catholique, la véritable nouvelle est le triomphe souverainiste/nationaliste au sein même du modèle "Global GB" qui est devenu le mantra du ministère britannique des Affaires étrangères après son Brexit (https://bit.ly/3KYs0ytx),
Le monde s'est écroulé autour du "héros de l'Ukraine" Johnson, qui doit encore payer pour le péché politique capital de son Partygate - les bacchanales du premier ministre britannique dans des bureaux publics, en pleine réclusion forcée https://bbc.in/3M4eE5f) - alors que les plaques tectoniques de la monarchie néolibérale de la "GB globale" se sont fracturées avec les balkanisations non improbables, entraînée par les électeurs de l'Écosse et de l'Irlande du Nord.
Moralité : le nationalisme souverain est l'antidote à la mondialisation néolibérale (https://bit.ly/38krIVp).
Pour suivre le Prof. Alfredo Jalife Rahme:
https://alfredojalife.com
Facebook : AlfredoJalife
Vk : alfredojalifeoficial
Télégramme : https://t.me/AJalife
https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber
Tiktok : ZM8KnkKQn/
Podcast : 3uqpT1y
13:38 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, royaume-uni, irlande, irlande du nord, ulster, politique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les intérêts cachés de la guerre de l'Occident contre la Russie

Les intérêts cachés de la guerre de l'Occident contre la Russie
par Luciano Lago
Source: https://www.ideeazione.com/gli-interessi-celati-della-guerra-delloccidente-alla-russia/
La guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine, avec l'implication indirecte (pour le moment) de l'OTAN, aurait dû faire apparaître clairement quels sont les intérêts cachés derrière ce conflit sanglant.
Les États-Unis et leur bulldog britannique, les deux sangsues au cœur de l'OTAN, sont ses centres de commandement, de contrôle et de coordination financière, ceux qui sont les plus intéressés à épuiser la Russie et l'Europe dans un conflit prolongé dont Washington et Londres peuvent tirer profit afin de maintenir un contrôle hégémonique sur le vieux continent en empêchant la soudure d'un axe eurasien entre la Russie et l'Europe.
Prolonger la guerre sert les intérêts de ceux qui l'ont instiguée et promue : les élites du pouvoir anglo-saxon.
Parmi les autres objectifs des Anglo-Saxons, à ne pas négliger, figure celui de la perturbation des lignes d'approvisionnement mondiales qui, dans les plans des centres de commandement, devrait isoler la Russie et également créer des difficultés pour la Chine, dont la puissance industrielle, technologique et militaire est de plus en plus considérée comme la menace existentielle pour les Etats-Unis.
Régler ses comptes avec la Russie et ensuite tourner son attention vers la Chine, telle est la stratégie pas si secrète de Washington qu'ils ont bien comprise à Pékin.
La stratégie américaine, mise en œuvre depuis de nombreuses années, est la même que celle théorisée par les stratèges de la Maison Blanche, qui envisageait d'encercler la Russie avec une ceinture d'États hostiles à travers laquelle il s'agirait de déstabiliser et d'attaquer le cœur de la Russie. Cette stratégie prévoyait, dans un premier temps, la mise en scène de révolutions colorées, telles que celles déclenchées en Géorgie, dans les Balkans et en Ukraine, puis un changement de régime dans les pays les plus fragiles, où il existe des tensions et des fractures potentielles dues à la présence de minorités russes, pour ensuite déboucher sur de véritables guerres civiles et la déstabilisation de ces pays. L'Ukraine a été la plus grosse "morsure" et un cas d'école où une telle stratégie a été mise en œuvre et a partiellement réussi.
Seule l'intervention opportune de Poutine en 2014 pour rendre la Crimée à la Fédération de Russie par référendum populaire a empêché le plein succès du coup d'État de Maidan. La déstabilisation s'est ensuite poursuivie avec l'intervention massive des Occidentaux pour soutenir l'armée de Kiev dans ses activités contre les séparatistes russophiles du Donbass.
Cependant, le plan de nettoyage ethnique et d'ukraïnisation de ces territoires a finalement été stoppé par l'intervention militaire de la Russie qui a débuté en février de cette année.
L'instrument principal de l'hégémonie militaire américaine, l'OTAN, travaille maintenant à plein régime pour soutenir l'Ukraine dans sa tentative de ralentir et d'arrêter l'offensive russe et, à cette fin, a déployé non seulement une cargaison massive d'armes létales mais aussi la présence de plusieurs milliers d'instructeurs militaires, de conseillers et de mercenaires de l'OTAN dont la tâche est d'appuyer les forces ukrainiennes et de prolonger le conflit autant que possible. Hillary Clinton elle-même l'avait explicitement déclaré quelques semaines avant l'intervention russe : "nous devons créer un nouvel Afghanistan, comme celui qui a mis l'URSS en crise en 1980", cette fois au milieu de l'Europe. Un objectif confirmé par les déclarations ultérieures du président Biden et de son secrétaire à la défense Austin.
Il devient donc clair qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre la Russie et l'Ukraine mais entre la Russie et l'OTAN où cette dernière est de plus en plus impliquée.
Un défi que Washington a lancé pour sa suprématie en Europe dès qu'il a utilisé l'Ukraine comme plateforme contre la Russie depuis 2014 et depuis les précédentes tentatives de révolutions colorées menées par la CIA.
Cependant, quelqu'un à Washington a fait un mauvais calcul et l'offensive russe menace de mettre à mal les plans de Washington sur l'Ukraine, avec la perspective d'un conflit qui ouvre la boîte de Pandore de ce qui représente la stratégie destructrice des Anglo-Saxons en Europe. Une sirène d'alarme pour les peuples d'Europe asservis aux intérêts impériaux de Washington qui cherche à empêcher à tout prix un axe eurasien entre l'Allemagne et la Russie, l'Europe devant elle-même subir les pires conséquences de ce conflit.
L'aveuglement des gouvernements européens et leur mauvaise foi dans la poursuite d'intérêts extérieurs contraires et opposés à ceux des peuples européens sont rendus évidents et retentissants par ce conflit.
En Russie aussi, les effets de ce conflit commencent à se faire sentir en interne, mais d'une manière inattendue par rapport aux attentes de l'Occident.
Comme cela s'est produit plus d'une fois dans l'histoire de la Russie, la guerre a mis en évidence la nécessité d'un changement radical et immédiat. dans la société russe.
La décision de passer à l'offensive en Ukraine le 24 février, selon divers analystes russes, a déclenché une véritable avalanche de demandes de changement, certaines instances en suscitant d'autres, l'une entraînant l'autre. Ce qui a commencé comme une révolution d'en haut, comme une opération spéciale, mènera inévitablement à ce à quoi mène toute révolution : l'implication des larges masses dans la vie du pays.
En substance, il s'agit d'une purification de l'âme du peuple russe qui est lavée des incrustations idéologiques issues des influences occidentales, celles du libéralisme et du consumérisme exacerbé.
La survie de la Russie et le développement du pays eurasien face aux sanctions et à la confrontation militaire nécessitent une combinaison de volonté étatique et d'un environnement économique décentralisé actif, d'autant plus que les sanctions ont porté un coup sévère aux anciens capitaines d'entreprise, les cinquièmes colonnes pro-occidentales que l'on appelle les oligarques.
La Russie n'est pas encore habituée à son nouveau rôle : celui d'un foyer de changement dans le système d'ordre mondial. On peut dire qu'il y a encore de la méfiance pour ce nouveau rôle. Cependant, pour le monde russe ce n'est pas la première fois dans l'histoire à soulever une révolte globale, cela s'était déjà produit en 1917 mais dans une direction différente. On peut dire que le passé révolutionnaire avec tous ses attributs est ancré dans la mémoire génétique du peuple russe. Cependant, le contenu de la révolution actuelle n'a évidemment rien en commun avec l'idéologie communiste.
Avant tout, c'est une révolution de libération du peuple. En Ukraine, les troupes russes libèrent leurs frères slaves de l'oppression d'une idéologie nationaliste qui leur est étrangère. À l'intérieur de la Russie, la tâche consiste à se libérer de la dépendance extérieure dans l'économie, de l'influence des agents pro-occidentaux, professionnels et volontaires.
De plus, dans l'actualité de l'action du groupe dirigeant russe, il y a aujourd'hui la défense du pays contre ces idées contre nature qui sont au cœur du dernier totalitarisme occidental, un retour aux valeurs qui assurent le développement de la société et non l'effondrement du tissu social : l'amour de la patrie, la famille traditionnelle, les enfants, le travail, la liberté de pensée. Et dans ce sens, on peut parler d'une révolution conservatrice.
Si les forces de cette révolution l'emportent, ce sera un énorme signal qui aura également son effet en Europe et sera le véritable moteur du changement.
12 mai 2022
11:27 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, europe, russie, otan, occident, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 mai 2022
L'Europe peut-elle exister sans la Russie ?
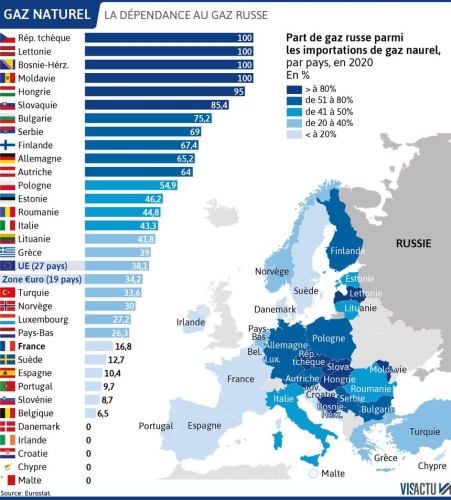
L'Europe peut-elle exister sans la Russie?
par Michel Pinton
Source: https://www.ideeazione.com/puo-leuropa-esistere-senza-la-russia/
La question qui constitue le titre de cet article a été posée aux participants d'un séminaire que j'ai eu l'honneur d'organiser il y a trente ans. C'était en 1994. La Russie luttait pour émerger des ruines de l'empire soviétique. Sa longue captivité l'avait épuisé. Enfin libre, elle n'avait qu'une seule aspiration : retrouver sa force et être à nouveau elle-même. J'entends par là non seulement retrouver la prospérité matérielle que les bolcheviks avaient dilapidée, mais aussi reconstruire ses relations sociales détruites, son ordre politique effondré, sa culture déformée et son identité perdue.
À l'époque, j'étais membre du Parlement européen. Il me semblait essentiel de comprendre ce qu'était la nouvelle Russie, quelle voie elle empruntait et comment l'Europe occidentale pouvait travailler avec elle. J'ai eu l'idée de conduire une délégation de députés à Moscou pour discuter de ces questions avec nos homologues de la Douma fédérale. J'en ai parlé à Philippe Seguin, alors président de l'Assemblée nationale française, et il a immédiatement accepté mon projet. Les parlementaires russes ont répondu à notre demande en nous invitant à venir immédiatement. D'un commun accord, nous avons décidé d'élargir nos délégations respectives à des experts dans les domaines de l'économie, de la défense, de la culture et de la religion, afin que leurs réflexions éclairent nos discussions.
Seguin et moi n'étions pas seulement poussés par la curiosité envers cette nation alors indécise. Nous nous considérions comme les héritiers d'une école de pensée française selon laquelle l'Europe est une, de l'Atlantique à l'Oural, non seulement sur le plan géographique, mais aussi en termes de culture et d'histoire. Nous étions également convaincus que ni la paix, ni le développement économique, ni l'avancement des idées ne pouvaient être établis sur notre continent si ses nations se déchiraient les unes les autres, voire s'ignoraient. Nous avons voulu poursuivre la politique d'entente et de coopération initiée par Charles de Gaulle de 1958 à 1968 et brièvement reprise en 1989 par François Mitterrand dans sa proposition de "grande confédération européenne".
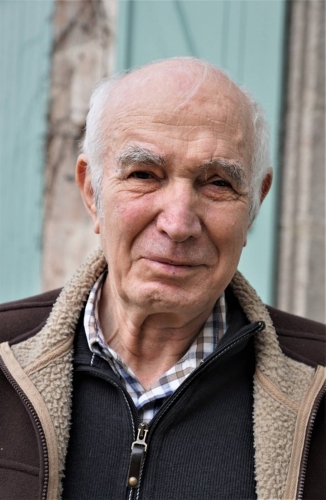
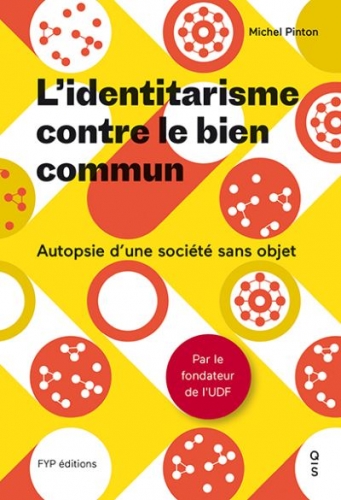
L'OTAN : un obstacle à nos projets
Nous savions qu'il y avait un obstacle à notre projet : il s'appelait OTAN. De Gaulle, le premier, n'avait cessé de dénoncer ce "système par lequel Washington tient la défense et par conséquent la politique et même le territoire de ses alliés européens". Il affirmait qu'il n'y aurait jamais de "véritable Europe européenne" tant que ses nations occidentales ne se seraient pas libérées de la "lourde tutelle" exercée par le Nouveau Monde sur l'Ancien. Il avait donné l'exemple en "libérant la France de l'intégration sous commandement américain". Les autres gouvernements n'ont pas osé le suivre. Mais la chute de l'empire soviétique en 1990, et la dissolution du Pacte de Varsovie, semblaient justifier la politique gaulliste: il était évident pour nous que l'OTAN, ayant perdu sa raison d'être, devait disparaître. Il n'y avait plus aucun obstacle à une entente étroite entre tous les peuples d'Europe. Seguin, en homme d'État visionnaire, pourrait envisager "une organisation spécifique de la sécurité en Europe" sous la forme "d'un Conseil européen de sécurité dans lequel quatre ou cinq des grandes puissances, dont la Russie et la France, auraient un droit de veto".
C'est avec ces idées que je me suis rendu à Moscou. Seguin a été retenu à Paris par une contrainte inattendue de la session parlementaire française. Notre séminaire a duré trois jours. L'élite russe est venue avec autant d'enthousiasme que les représentants de l'Europe occidentale. De nos échanges, j'ai tiré une leçon principale : nos interlocuteurs sont obsédés par deux questions fondamentales pour l'avenir de leur nation: qui est russe? Comment assurer la sécurité de la Russie?
La première question découle des frontières arbitraires que Staline avait imposées au peuple russe au sein de l'ancienne Union soviétique. La seconde était la réapparition des souvenirs tragiques des invasions passées. Certains pensaient que les réponses se trouvaient dans le commerce avec l'Europe occidentale, dont les nations avaient appris à négocier leurs limites et à travailler ensemble fraternellement pour le bien de tous. Et puis il y en avait d'autres qui, rejetant l'idée d'une vocation européenne de la Russie, considéraient qu'elle avait son propre destin, qu'ils appelaient "eurasien". Naturellement, c'est le premier groupe que nous avons encouragé. C'est à ce groupe que nous avons apporté nos propositions. Il était dominant à l'époque.
En relisant le compte rendu de ce séminaire trente ans plus tard, mon cœur se serre en redécouvrant l'avertissement que nous avait donné un éminent universitaire, alors membre du Conseil présidentiel : "Si l'Occident ne montre aucune volonté de comprendre la Russie, si Moscou n'acquiert pas ce à quoi elle aspire - un système de sécurité européen efficace - si l'Europe ne sort pas de son isolement, alors la Russie deviendra inévitablement une puissance révisionniste". Elle ne se contentera pas du statu quo et cherchera activement à déstabiliser le continent".
En 2022, c'est exactement ce qu'elle fait. Pourquoi notre génération d'Européens a-t-elle échoué si lamentablement dans l'œuvre d'unification qui semblait à portée de main en 1994 ?
Nous avons tendance à rejeter la faute sur un seul homme : Poutine, "un dictateur brutal et froid, un menteur invétéré, nostalgique d'un empire disparu", que nous devons combattre, voire éliminer, afin que la démocratie, le précieux trésor de l'Occident, puisse également prévaloir à l'Est et y établir la paix. C'est à cette tâche, sous l'égide de l'OTAN, que nous appelle le président américain Joe Biden. Son explication a l'avantage d'être simple, mais elle est trop intéressée pour être acceptée sans examen. Ceux qui ne sont pas dominés par les émotions de l'actualité n'ont aucune difficulté à comprendre que le problème de l'Europe est beaucoup plus complexe et profond.
L'histoire de notre continent au cours des trente dernières années peut se résumer à un éloignement progressif de l'Est de l'Ouest. Dans l'ancien empire soviétique, la principale préoccupation était, et est toujours, de reconstruire des nations qui renoueront avec leur passé et vivront en toute sécurité pour être à nouveau elles-mêmes. Pour la Russie, cela signifie réunir tous les peuples qui revendiquent la patrie, établir des relations stables et de confiance avec les nations sœurs du Belarus, de l'Ukraine et du Kazakhstan, et construire un système de sécurité européen qui la protège des dangers extérieurs.
L'obsession européenne
Les dirigeants d'Europe occidentale ont eu une préoccupation très différente. Depuis la chute du mur de Berlin, ils ont consacré leur attention, leur énergie et leur confiance à ce qu'ils ont appelé "l'Union européenne". Le traité de Maastricht, la construction de la monnaie unique, la "constitution" de Lisbonne - voilà ce sur quoi ils ont travaillé presque à plein temps. Alors qu'à l'Est, ils s'efforçaient de rattraper le temps perdu dans l'histoire nationale, à l'Ouest, les élites se sont laissées emporter par une mystique irrésistible, celle du dépassement des nations et de l'organisation rationnelle de l'espace commun. Le problème de la sécurité ne se pose plus à l'Ouest, puisque tous les différends entre les États membres doivent être réglés par des instances supranationales. La paix dans l'"Union" semblait être définitivement établie. En bref, l'Occident pensait avoir dépassé l'idée de nation et construit un système stable de fin heureuse de l'histoire. La Russie était confrontée à des questions brûlantes sur l'idée de nation et avait un sentiment croissant de rendez-vous déchirants avec l'histoire. Dans ces conditions, l'Est et l'Ouest n'avaient pas grand-chose à échanger, à l'exception du pétrole et des machines-outils, dont le niveau est trop bas pour atténuer leurs futures divergences.
En conséquence, l'OTAN est devenue une pomme de discorde encore plus grave qu'à l'époque des deux blocs. En Europe occidentale, l'organisation militaire dirigée par Washington est considérée comme une garantie bénigne contre les éventuels retournements de l'histoire. Elle permet à ses peuples membres de profiter des "dividendes de la paix" du monde extérieur sans s'en préoccuper, tout comme l'Union le fait pour sa paix intérieure. En Russie, l'OTAN apparaît comme une menace mortelle. C'est l'instrument d'une puissance qui a montré à de nombreuses reprises depuis la chute du mur de Berlin sa volonté d'hégémonie mondiale et de domination sur l'Europe. L'inclusion de la Pologne, des trois États baltes et de la Roumanie, tous si proches de la Russie, dans les territoires couverts par la suprématie américaine a été applaudie en Occident. À Moscou, elle a suscité l'inquiétude et la colère.

L'échec de la France
Et la France ? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé d'empêcher la division progressive de notre continent ? Parce que sa classe dirigeante a toujours choisi d'accorder la priorité absolue à la mystique de l'"Union européenne". En conséquence logique, elle s'est laissée entraîner dans son complément naturel, l'OTAN. Jacques Chirac a participé, à contrecœur bien sûr, mais explicitement, à l'expédition décidée par Washington contre la Serbie. Sarkozy a pris le parti de rapprocher notre pays du système dominé par les Américains. Hollande et Macron nous ont liés toujours plus étroitement à l'organisation dont la tête est de l'autre côté de l'Atlantique. En nous liant toujours plus étroitement à l'OTAN, nos présidents ont perdu une grande partie du crédit international dont jouissait la France lorsqu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait.
Un sursaut de conscience les a parfois amenés à rejeter la tutelle américaine et à reprendre la mission que de Gaulle avait commencée. Chirac a refusé de participer à l'agression de Bush contre l'Irak, Sarkozy s'est entendu à lui seul avec Moscou sur les termes d'un armistice en Géorgie, Hollande a négocié les accords de Minsk pour mettre fin aux combats en Ukraine, ils ont tous accompli des actes dignes de notre vocation européenne. Ils ont même réussi à engager l'Allemagne. Mais hélas, leurs efforts ont été improvisés, partiels et de courte durée.
C'est à cause de cette série de divergences que l'Europe a été une fois de plus coupée en deux. La malheureuse Ukraine, située sur la ligne de fracture du continent, est la première à en payer le prix en sang, larmes et destruction. La Russie le revendique au nom de l'histoire. L'Union européenne s'indigne au nom des valeurs démocratiques qui, selon elle, mettent fin à l'histoire. L'Amérique profite de ce différend insoluble pour avancer discrètement ses pions et rendre l'issue de la guerre encore plus compliquée.
Voilà où se trouve l'Europe un tiers de siècle après sa réunification : un abîme de malentendus la divise ; une guerre cruelle la déchire ; un nouveau rideau de fer, imposé cette fois par l'Occident, commence à séparer son espace ; la course aux armements a repris ; et, plus encore que la chute vertigineuse des échanges économiques, c'est la fin des échanges culturels qui menace chacune de ses deux faces. Le grand Européen Jean-Paul II avait coutume de dire que notre continent ne pouvait respirer qu'avec ses deux poumons. Aujourd'hui, en Occident comme en Orient, nous sommes condamnés à ne respirer qu'avec un seul. C'est un mauvais présage pour les deux moitiés. Mais les vrais Européens doivent refuser de se décourager. Même s'ils sont peu entendus aujourd'hui, ce sont eux et eux seuls qui peuvent ramener la paix sur notre continent et lui rendre sa prospérité et sa grandeur.
10 mai 2022
11:28 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, europe, russie, affaires européennes, politique internationale, otan, atlantisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Une rose des vents hégémonique et décadente
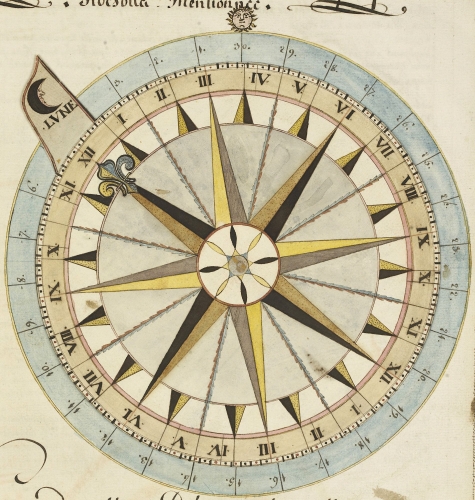
Une rose des vents hégémonique et décadente
par Georges Feltin-Tracol
Parmi les nombreuses hétérotélies qui découlent de l’« opération militaire spéciale » russe en Ukraine, destinée entre autres à empêcher l’ancrage de ce pays dans l’orbite euro-atlantique, la plus flagrante serait le renoncement par la Suède et la Finlande de leur neutralité historique afin de rejoindre au plus tôt l’Alliance Atlantique et son bras armé, l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord).
Signé le 4 avril 1949, le traité de Washington réunit douze États des deux rives septentrionales de l’Atlantique dont le Portugal de Salazar et l’Islande qui présente la particularité de ne pas disposer d’armée. Ce pacte fonde l’Alliance Atlantique en opposition frontale à l’Union Soviétique et au bloc de l’Est. La guerre de Corée en 1950 l’incite à se doter d’une composante militaire : l’OTAN.
La fin de la Guerre froide qui s’étend du 9 novembre 1989 (chute du mur de Berlin) au 25 décembre 1991 (éclatement imprévu de l’URSS) aurait pu – et aurait dû – provoquer la dissolution de l’OTAN. Son pendant soviétisé, le Pacte de Varsovie, a bien disparu dès 1991. Or la structure atlantiste va survivre à ce grand tournant de l’histoire. Elle va contribuer à l’hégémonie des États-Unis d’Amérique en Europe et à renforcer la domination occidentale matérialiste – eudémoniste sur les cinq continents. Aujourd’hui, l’organisation occidentaliste comprend trente membres dont les plus récents datent de 2009 (Albanie et Croatie), de 2017 (Monténégro) et de 2020 (Macédoine du Nord). L’arrivée prochaine de la Suède et de la Finlande sonnera le glas de toute « Europe – puissance » indépendante. À l’exception de l’Irlande, de Malte, de Chypre, de l’Autriche, de la Suède et de la Finlande, tous les États de la soi-disant Union européenne sont plus ou moins intégrés dans l’OTAN. La neutralité affichée d’États européens tels que la Suisse n’a jamais empêché une intense coopération discrète. Dans la perspective d’une invasion soviétique, l’état-major otanien avait très tôt mis en place des unités clandestines de guérilla connues sous le nom de code de Stay Behind et, en Italie, de Gladio. L’Autriche, la Suède et même la Suisse ont bénéficié de ce soutien implicite. Aucun État européen n’est de nos jours étranger à l’atlantisme institutionnel.

Dans la décennie 1990, certains milieux républicains conservateurs, souvent marginaux, tablent sur un ralliement rapide de la Russie à la sphère occidentale. L’arrivée de l’ancien ennemi aurait bouleversé la donne géopolitique et diplomatique pour tout le début du XXIe siècle, car, une fois dans l’OTAN, la Russie aurait incité les anciennes républiques soviétiques, y compris l’Ukraine et la Géorgie, à l’y rejoindre. L’extension de l’alliance militaire atlantique de Vancouver à Vladivostok via Moscou aurait toutefois été vue par l’Iran et la Chine comme une menace frontalière existentielle. Incapables de dépasser leurs préjugés russophobes, les cénacles néo-conservateurs, démocrates et républicains, rejetèrent cette éventualité et ratèrent leur rendez-vous avec le kairos. Au contraire, l’agression russe contre l’Ukraine concrétise leur lubie géostratégique. Dans les années 2000, l’OTAN participa à l’invasion et à l’occupation de l’Afghanistan et de l’Irak.
Aucune autre entente multinationale ne présente un tel écho planétaire qui correspond aux visées d’un Occident-monde totalitaire. L’OTAN a ainsi noué d’intenses contacts avec divers pays non-européens dans une série de contrats appelés « Plans d’action individuel de partenariat » (Serbie, Ukraine, Géorgie, Arménie, Kazakhstan), « Partenariat pour la paix » (Irlande, Suisse, Autriche), « Dialogue méditerranéen » (Israël, Jordanie, Égypte, Maghreb dont l’Algérie) », « Initiative de coopération d’Istanbul » (Koweït, Émirats arabes unis, Qatar) et « Partenariat global » (Colombie, Irak, Pakistan, Mongolie, Corée du Sud, Japon, Nouvelle-Zélande). Quant à l’Australie, considérée comme un « allié majeur », elle posa en 2014 sa candidature à l’Alliance Atlantique.
Le bloc euro-atlantique constitue un grand espace qu’ordonnent et dominent les États-Unis d’Amérique. C’est un Commonwealth ultra-libéral de ploutocraties d’apparence démocratique qui sert aussi de vaste marché au complexe militaro-industriel étatsunien. Sans vouloir empiéter sur les analyses judicieuses de l’émission de Radio Méridien Zéro versée dans les questions militaires, « Ça se défend », le Rafale français, l’Eurofighter Typhoon anglo-germano-hispano-italien et le JAS 39 Gripen suédois ne peuvent pas rivaliser avec le F-35 étatsunien à la réputation (au choix) de fer à repasser volant ou de corbillard aérien. Les industries d’armement européens, en particulier françaises et suédoises, connaîtront dans les prochaines années le sort peu enviable d’Alstom racheté par General Electric grâce à une prise d’otage légale outre-Atlantique (l’affaire Frédéric Pierucci, par exemple).

À côté de son action patiente de pillage systématique du savoir-faire européen, l’OTAN, l’Alliance Atlantique et leur complice, l’Union dite européenne, attisent le nouveau chaos mondial. L’OTAN n’a jamais défendu l’Occident boréen. Elle représente plutôt l’avant-garde de la révolution sociétaliste cosmopolite. Ses instances dirigeantes souscrivent à toutes les pathologies de la modernité tardive liquide. Le 19 mars 2021, le siège bruxellois de l’OTAN tenait une conférence interne consacrée à la dimension LGBTQ+ sur le lieu de travail. La rose des vents se trouvait pour l’occasion associée au fameux drapeau arc-en-ciel… Le communiqué de presse officiel de l’entité atlantiste affirmait qu’elle « est attachée à la diversité. Toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion, la nationalité, le handicap ou l’âge y est strictement interdite. Elle a également fait œuvre de pionnière en étant la toute première organisation au monde à reconnaître le mariage entre personnes du même sexe, offrant à ces couples les mêmes avantages qu’aux conjoints hétérosexuels, à une époque où le mariage homosexuel n’était reconnu que dans un seul pays, les Pays-Bas ». Jamais l’OTAN n’est intervenue dans la crise des migrants en 2015. Elle ne s’est jamais déployée pour protéger et stabiliser le flanc Sud de la Méditerranée. L’idéologie multiculturaliste, la pensée « woke » et l’« inclusivisme » sont devenus avec l’ultra-libéralisme sécuritaire les mamelles conceptuelles de l’atlantisme 2.0.
On ne peut que constater toute la nocivité de cette organisation qu’Emmanuel Macron estimait avec erreur le 7 novembre 2019 en « mort cérébrale ». La mort cérébrale, c’est en fait ce qui attend les peuples albo-européens s’ils ne décident pas de se lever contre cette folle emprise mortifère civilisationnelle.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 32, mise en ligne, le 10 mai 2022, sur Radio Méridien Zéro.
10:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otan, atlantisme, occidentalisme, europe, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 13 mai 2022
La nécessité d'un véritable nouveau Bretton Woods

La nécessité d'un véritable nouveau Bretton Woods
par Mario Lettieri et Paolo Raimondi
Source : https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-necessita-di-una-vera-nuova-bretton-woods
La guerre en Ukraine, avec ses drames, où la désinformation et la guerre psychologique sont prépondérantes, tend à masquer le véritable affrontement géopolitique et géoéconomique mondial, profond, qui se déroule depuis des années.
Qui aura le rôle hégémonique sur l'économie, la monnaie, la finance, et pas seulement la sécurité du monde? La prétention des Etats-Unis à être la seule puissance capable, à elle seule, de déterminer les processus économiques et stratégiques et de gérer les relations internationales est objectivement mise à mal face aux nouvelles réalités émergentes.
La question la plus troublante est la suivante : la nouvelle hégémonie sera-t-elle établie par le vainqueur d'une guerre mondiale, comme par le passé, ou y aura-t-il une confrontation rationnelle et constructive entre tous les acteurs habitant notre planète ?
À cet égard, il est important de noter que depuis quelque temps déjà, même aux États-Unis, on se demande s'il faut organiser un nouveau Bretton Woods. En 1944, un accord pour un nouveau système monétaire international, centré sur le dollar, a été conclu pour donner de la stabilité aux relations économiques internationales et pour aider au développement et à la reconstruction d'après-guerre. L'accord de Bretton Woods, cependant, a été conclu par les vainqueurs de la guerre, sans l'Union soviétique, laissant de côté tous les grands pays du soi-disant tiers-monde, en particulier l'Inde et la Chine.

Janet Yellen (photo), secrétaire au Trésor américain et ancienne présidente de la Fed, en a également parlé récemment dans un discours prononcé devant l'Atlantic Council. Elle a décrit un nouvel ordre commercial, toujours dirigé par les États-Unis, dans lequel les autres pays "ne seront pas autorisés à utiliser leur avantage commercial dans les matières premières, les technologies et les produits clés pour perturber notre économie ou exercer une influence géopolitique indésirable". Il est clair que cette préoccupation concerne la Chine, ainsi que la Russie. Le nouvel ordre se concentrera sur l'accès sécurisé aux matières premières stratégiques telles que le pétrole, le gaz, les métaux, les matériaux rares et les denrées alimentaires.
La garantie d'un approvisionnement sûr sera plus importante que son prix d'achat. Afin de sécuriser les réserves de matières premières, les pays industrialisés, y compris l'Italie et l'UE, auront, en conséquence, des problèmes de pénurie de capitaux, et donc davantage de dettes. Ce scénario est plus géopolitique qu'économique.
Bien que le dollar reste la principale monnaie dans les affaires économiques mondiales, il a perdu depuis longtemps son rôle et sa crédibilité de monnaie de confiance, de garantie et de certitude.
Selon la Fed, le dollar est encore utilisé dans divers secteurs pour environ 70%, l'euro pour 30% et le yuan chinois pour seulement 3%. Cet indice ne tient toutefois pas compte de l'utilisation croissante du troc et des monnaies nationales dans les transactions commerciales et financières des pays du Brics et d'autres économies émergentes. Par exemple, bien avant le conflit actuel, l'utilisation du dollar pour les paiements des exportations russes vers les autres pays du Brics avait chuté de 95% en 2013 à moins de 10% en 2020.
La dévalorisation internationale du dollar est très évidente dans la composition des réserves monétaires mondiales, à tel point qu'elle est passée de 71% à 59% au cours des deux dernières décennies. Dans les réserves monétaires de plusieurs banques centrales, la valeur de l'or dépasse celle des dollars. Il n'est donc pas surprenant que ce renversement ait déjà eu lieu en 2020 en Russie.
Il ne faut pas oublier que les sanctions économiques majeures prises à l'encontre de la Russie pour l'invasion de l'Ukraine, y compris le gel de ses réserves de change et la suspension du système SWIFT dans les paiements internationaux, ont effectivement fait du dollar une "arme militaire" dont les conséquences mondiales seront de plus en plus visibles au fil du temps.
Par conséquent, un nouveau Bretton Woods ne peut être une réplique du précédent, un accord entre les seuls "amis" de l'Amérique, il devra impliquer la Chine, l'Inde, les pays émergents du Sud et même la Russie. Dans un tel accord, l'Union européenne devrait avoir un rôle central de médiation et de proposition, qu'elle aurait déjà dû jouer naturellement dans cette phase délicate de la guerre en Ukraine, si elle était un acteur politique, autonome et réellement indépendant.
Sans être impertinents, rappelons que déjà en 2004, par une motion spécifique à la Chambre des députés, votée à la quasi-unanimité, nous avons demandé au gouvernement d'agir dans les enceintes internationales compétentes pour entreprendre "les initiatives nécessaires à la convocation d'une conférence au niveau des chefs d'État et de gouvernement, similaire à celle de Bretton Woods, pour définir globalement un nouveau système monétaire et financier plus juste".
En vérité, il devrait s'agir d'un nouvel ordre mondial, commençant par le système monétaire et financier et s'étendant à la réduction contrôlée des armes nucléaires, au commerce à rendre plus équitable, à la lutte contre les grandes pandémies, à la protection du travail, du climat et de l'environnement. Il ne s'agit donc pas seulement d'argent, ni d'armes, étant donné que "tout est tenu" pour assurer la paix et la viabilité dans les différentes parties de la planète.
16:54 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretton woods, actualité, économie, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le bâton américain est resté sans carotte
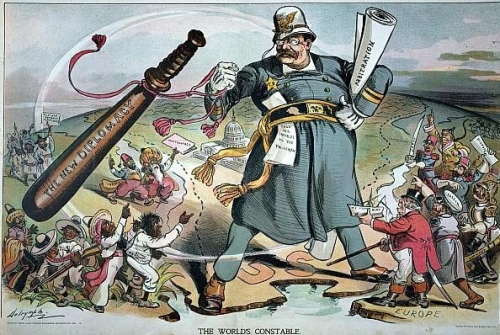
Le bâton américain est resté sans carotte
Leonid Savin
Source: https://katehon.com/en/article/american-stick-was-left-without-carrot
Les États-Unis exercent des pressions sur d'autres pays dans le cadre des relations avec la Russie, limitant de fait leur souveraineté!
Les États-Unis ont la capacité d'appliquer de vastes mesures pour exercer des pressions sur d'autres pays, non seulement dans le cadre de relations bilatérales, mais aussi par le biais d'organisations internationales contrôlées telles que le FMI et la Banque mondiale. Bien que ces mesures violent le droit international, elles sont devenues monnaie courante pour les praticiens de la diplomatie préventive, c'est-à-dire des menaces de sanctions ultérieures qui peuvent avoir un effet économique et politique à long terme.
En particulier, il a été noté précédemment que les pays qui votaient contre la position des Etats-Unis à l'ONU, étaient ensuite confrontés à des restrictions dans l'obtention de prêts ou de crédits auprès de ces organisations financières. Ce fut le cas lors du vote pendant l'opération Tempête du désert contre l'Irak. Les États-Unis ont appliqué une option similaire à la Russie. Cela explique la participation d'un si grand nombre de pays en développement à la liste des États qui ont voté contre la Russie à l'ONU.
Dans le même temps, afin d'éviter le coup de bâton américain, la Serbie amie a même voté contre Moscou ! Le président Aleksandr Vucic s'est défendu plus tard en disant que la décision a été prise sous la pression des pays occidentaux, mais la Serbie ne va pas imposer de sanctions contre la Russie. Compte tenu de l'occupation du Kosovo, la Serbie ne dispose pas de sa pleine souveraineté, même en théorie, et elle est donc obligée de trouver un équilibre entre le collectif occidental, au milieu duquel elle est encerclée, et la Russie.
Cependant, elle comprend que la restauration de sa souveraineté ne peut se faire que grâce à l'aide de la Russie, et non aux actions de l'Occident. Le temps le plus proche nous dira comment cette orientation se développera, surtout si l'on considère la récente fourniture d'armes par la Grande-Bretagne aux Kosovars, que Belgrade a considéré comme une action inamicale [i].
Le cas le plus évident d'ingérence américaine récente dans les affaires intérieures d'un autre pays en raison d'une position indépendante est le changement de gouvernement au Pakistan. Le Premier ministre était à Moscou lors du début de l'opération spéciale en Ukraine et a rencontré les dirigeants de notre pays [ii].
Le Pakistan n'a pas voté contre la Russie à l'ONU et a également refusé de condamner Moscou après un appel collectif des ambassadeurs de l'UE. De Washington, par l'intermédiaire de l'ambassadeur pakistanais aux États-Unis, on lui a dit qu'il devait démissionner, sinon ce serait pire pour le Pakistan. Imran Khan n'a pas eu peur de le dire ouvertement lors d'un rassemblement public, où il a déclaré qu'une ingérence évidente de l'extérieur avait eu lieu.
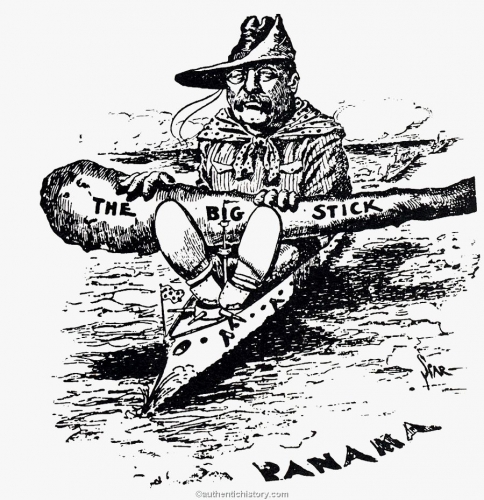
Mais le coup d'État parlementaire a quand même eu lieu, bien qu'il y ait eu des tentatives pour empêcher un vote de défiance. Il y a maintenant un gouvernement pro-américain au Pakistan, qui a commencé à changer les principaux ministres. Et le "Mouvement pour la solidarité" fait descendre des milliers de ses partisans dans les rues de différentes villes du pays. Des manifestations de masse sont prévues à Islamabad même, à la fin du mois sacré du Ramadan.
Aujourd'hui encore, le Pakistan connaît un niveau record de sentiment anti-américain. Imran Khan a juré de combattre à la fois l'ingérence américaine et le "gouvernement importé", par lequel il entend la coalition actuelle à l'Assemblée nationale de la Ligue musulmane-N et du Parti du peuple pakistanais.
Étant donné la situation fragile du Pakistan, ce "coup d'État" frappera en premier lieu le peuple pakistanais lui-même, qui souffre de turbulences à long terme et d'un manque de stabilité politique.
En Inde voisine, Washington a également tenté d'influencer les décisions relatives à l'interaction entre New Delhi et Moscou.
Lors du sommet 2+2 entre l'Inde et les États-Unis, qui s'est tenu le 12 avril dans la capitale indienne, les questions du conflit en Ukraine et d'éventuelles restrictions commerciales et économiques ont été abordées. Au cours de la conférence ministérielle conjointe, il y a eu une condamnation sans équivoque des morts civils et des appels à un cessez-le-feu immédiat, mais il n'a pas été possible d'obtenir que l'Inde cesse d'acheter des ressources énergétiques russes et même des armes aux États-Unis.
Bien que Blinken et le chef du Pentagone, Lloyd Austin, tentent d'attirer l'Inde dans leur orbite, New Delhi ne croit pas aux promesses et se montre pragmatique quant à l'élargissement de la coopération indo-américaine dans le domaine militaro-technique. La méthode du bâton n'est pas appliquée à l'Inde, même si les États-Unis n'ont pas vraiment de carotte.
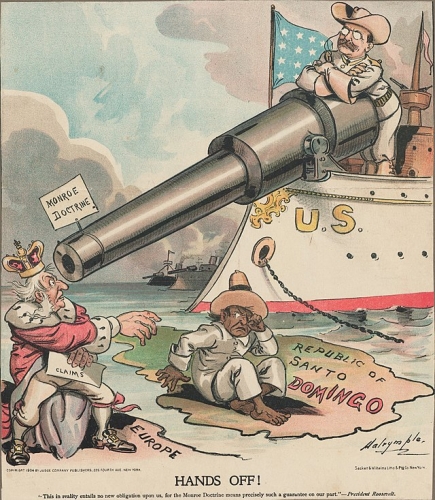
Mais la Turquie a clairement succombé à la pression américaine. La veille, Ankara a annoncé la fermeture du ciel turc aux avions russes se rendant en Syrie. Comme l'a expliqué le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, l'autorisation de vol des avions russes a été délivrée pour trois mois et a été prolongée à plusieurs reprises, et maintenant elle a pris fin. Les Turcs en ont informé Moscou à l'avance. Cela s'applique aussi bien aux avions civils que militaires.
Tout cela ne va évidemment pas sans l'intervention des États-Unis, qui tentent d'exercer une pression maximale sur la Turquie, puisqu'elle ne s'est pas jointe aux sanctions contre la Russie (ce qui affecterait grandement les intérêts de la Turquie elle-même).
En Amérique latine, la Maison Blanche tente également, sinon de mettre sur pied une coalition anti-russe, du moins de forcer certains pays à imposer des sanctions anti-russes. À cet égard, les États-Unis ont obtenu le plus grand succès en Colombie, où de nouvelles élections présidentielles pointent le bout de leur nez et où, dans un contexte d'instabilité sociale aiguë, des accusations se font de plus en plus entendre en direction du Venezuela, où se trouveraient des militaires russes susceptibles de causer quelques dégâts en Colombie.
En outre, le président colombien Ivan Duque a tenu des propos sévères à l'encontre de la Russie, soulignant que les militants des FARC pourraient avoir certains liens avec la Russie. Et en relation avec sa rhétorique, une déclaration spéciale a été faite par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Mariya Zakharova, notant la nécessité de préserver les relations amicales russo-colombiennes, malgré un tel ton ignorant du chef de la Colombie [iii].
Nous pouvons supposer que l'activité actuelle du département d'État américain, d'une manière ou d'une autre, est liée à la politique anti-russe. Si ce n'est pas directement, c'est au moins indirectement.
Vers le 20 avril, le secrétaire d'État américain Antony Blinken, accompagné du secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, s'est rendu au Panama pour discuter des questions de migration et des sanctions contre la Russie. Officiellement, Blinken a remercié les dirigeants panaméens pour leur position pro-américaine [iv].
Étant donné que pour le Panama, les États-Unis sont le principal partenaire économique et le principal investisseur direct (y compris l'exploitation du canal, où plus de 70 % des marchandises qui y transitent sont destinées aux États-Unis ou en proviennent), il est évident qu'ils suivront les instructions de Washington [v].
En outre, plus tôt, l'Ukraine, par l'intermédiaire de son ambassadeur dans ce pays, a essayé d'obtenir du Panama qu'il ferme le canal pour le passage des navires russes. Cependant, les autorités panaméennes ont refusé d'imposer de telles restrictions, invoquant le statut neutre du canal par rapport aux affaires internationales [vi].
Il est significatif qu'auparavant, l'affaire du dossier Panama contenant des données sur les comptes de divers oligarques ait été utilisée par les États-Unis contre la Russie pour imposer des sanctions supplémentaires [vi]. Il est probable qu'à l'avenir, le Panama imposera des restrictions sur l'utilisation de son pays pour les investissements russes ou un certain type de transactions financières. Mais les principaux acteurs d'Amérique latine résistent encore aux exigences anti-russes de Washington.
Le Mexique a refusé de se conformer aux sanctions contre la Russie, comme il l'a fait précédemment avec Cuba. Il ne faut pas oublier que le président Lopez Obrador est critique à l'égard des États-Unis, même s'il comprend la forte dépendance de son pays vis-à-vis de son voisin du nord [vii] - [viii].
Jusqu'à présent, l'Argentine fait face à cette pression avec succès - le ministre des affaires étrangères de ce pays, Santiago Cafiero, a déclaré que l'Argentine ne prendra pas de telles mesures [ix].
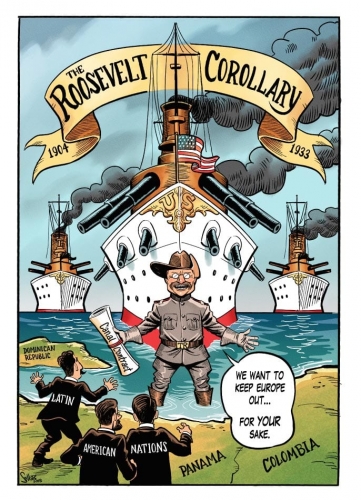
Le Brésil a généralement condamné les sanctions occidentales contre la Russie car elles exacerbent les conséquences économiques du conflit et nuisent aux peuples qui dépendent des ressources de base.
"[Ces sanctions] peuvent exacerber les conséquences économiques du conflit et affecter la principale chaîne d'approvisionnement", a déclaré début avril le ministre brésilien des Affaires étrangères, Carlos França, en référence à l'embargo imposé par l'Occident, dirigé par les États-Unis, contre la Russie.
Lors d'une audition devant la commission des relations étrangères du Sénat, le ministre brésilien des affaires étrangères a clairement indiqué que de telles mesures visent à réaliser les intérêts d'un petit groupe de gouvernements, tout en nuisant aux autres qui dépendent des ressources de base [x]. Il est nécessaire de prendre en compte la forte dépendance de ces deux pays à l'égard de la fourniture d'engrais russes, dont dépend le secteur agricole du Brésil et de l'Argentine.
Il existe encore de nombreux pays d'Afrique et d'Asie qui ont condamné extérieurement les actions de la Russie à l'ONU, mais qui continuent officiellement à coopérer. Tôt ou tard, Washington leur demandera de se joindre aux sanctions imposées ou d'établir des restrictions spéciales.
Évidemment, cela affectera leur propre souveraineté, et dans ce choix difficile, beaucoup dépend de la volonté politique des dirigeants. Toutefois, la diplomatie russe ne devrait pas attendre les nouvelles machinations du Département d'État, mais plutôt poursuivre activement sa politique étrangère et maximiser la coopération avec les États amis et neutres.
Notes:
[i] https://ria.ru/20220417/serbiya-1783965016.html
[ii] https://www.geopolitika.ru/article/chto-budet-s-pakistanom
[iii] https://mundo.sputniknews.com/20220421/rusia-lamenta-la-retorica-negativa-del-presidente-colombiano-en-su-contra-1124653073.html
[iv] https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-homeland-security-secretary-alejandro-mayorkas-panamanian-foreign-minister-erika-mouynes-and-panamanian-public-security-minister-juan-manuel-pino-forero-at-a-joint-pr/
[v] https://www.state.gov/secretary-blinkens-trip-to-panama-commitments-to-a-regional-approach-to-hemispheric-migration-and-to-anti-corruption-efforts/
[vi] https://mundo.sputniknews.com/20220420/el-canal-de-panama-el-arma-que-occidente-no-podra-usar-contra-rusia-1124605364.html
[vii] https://www.telesurtv.net/news/EE.UU.-usara-Panama-Papers-para-imponer-mas-sanciones-a-Rusia-20160407-0026.html
[viii] https://www.business-standard.com/article/international/mexico-declines-to-join-russia-sanctions-seeks-to-stay-on-peaceful-terms-122030200448_1.html
[ix] https://ria.ru/20220423/sanktsii-1785124287.html
[x] https://www.hispantv.com/noticias/brasil/540594/sanciones-rusia-conflicto-ucrania
15:45 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonid savin, géopolitique, politique internationale, actualité, sanctions, sanctions antirusses, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 mai 2022
Que faut-il attendre de l'élection présidentielle turque de 2023?

Que faut-il attendre de l'élection présidentielle turque de 2023?
Leonid Savin
Source: https://katehon.com/en/article/what-expect-2023-turkish-presidential-election
Pour la Russie, la défaite de Recep Erdogan peut être utile
Des élections présidentielles et législatives auront lieu en République de Turquie à l'automne 2023. Le pays ayant récemment connu une forme de gouvernement présidentiel (ce qui a donné lieu à des accusations d'usurpation du pouvoir par Erdogan de la part de l'opposition et des pays occidentaux), l'essentiel pour l'avenir de la Turquie n'est pas la répartition des sièges au parlement, mais le poste de chef d'État. L'orientation future de notre politique en dépend, tant dans la sphère extérieure que dans les affaires intérieures.
Le Parti de la justice et du développement de Recep T. Erdogan, au pouvoir, dispose aujourd'hui, selon les sondages, d'environ 33 % du soutien des électeurs. Les avoirs économiques créés sous le règne d'Erdogan sont orientés vers la Russie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie.
Mais la politique étrangère d'Erdogan elle-même est clairement expansionniste - sous lui, la Turquie a pris pied dans le nord de la Syrie et dans certaines parties de l'Irak, a participé aux batailles en Libye et a étendu sa zone économique en Méditerranée, bien que de manière unilatérale. Les méthodes de soft power de la Turquie sont activement utilisées en Asie centrale, en Afrique et dans les Balkans.


Bien que des mesures conservatrices aient été prises en politique intérieure, comme le retrait de la Convention d'Istanbul, qui rapproche les positions de la Turquie et de la Russie, et assimile aux yeux de l'Occident le président Vladimir Poutine et Erdogan à des dirigeants autocratiques.
Quelles sont les ambitions politiques de l'opposition turque actuelle et des autres forces qui prétendent participer à la construction de l'État ?
Le principal concurrent du parti d'Erdogan est le Parti républicain du peuple aux racines historiques, puisqu'il a été créé par le fondateur de la Turquie moderne, Atatürk Kemal. Selon les sondages de sortie des urnes, ils ont maintenant 28%. Le parti n'a pas de programme et d'idéologie clairement perceptibles. Ils sont un mélange hétéroclite de libéraux de gauche, d'anciens communistes, d'Alevis (c'est-à-dire de minorités religieuses), de groupes laïques, de partisans du mariage homosexuel et d'autres pro-occidentaux.
Ils ont une position pro-allemande prononcée (il faut rappeler qu'un grand nombre de Turcs vivent en Allemagne), d'où l'orientation extérieure vers l'UE. En ce qui concerne l'agenda politique intérieur, ils s'appuient sur une opposition ouverte à Erdogan.

Le chef du parti est un politicien plutôt âgé, Kemal Kılıçdaroğlu (photo), qui est complètement dépendant des sociétés occidentales et des oligarques turcs liés à l'Europe. Il a déjà annoncé qu'il participerait aux élections en tant que candidat à la présidence. Sur les questions internes du parti, Kılıçdaroğlu est une figure de compromis qui règle les désaccords internes du parti.
Il est assez significatif que l'actuel maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, soit plus charismatique et plus performant. Il a également manifesté son intérêt à participer aux élections, mais la direction du parti lui a interdit de se présenter, considérant qu'il valait mieux occuper le poste de chef de la métropole.
Il convient d'ajouter que le parti dispose d'un assez bon financement, et que l'ancienne élite kémaliste le soutient par solidarité. L'Union des industriels et des entrepreneurs de Turquie, qui a précédemment établi des liens avec des structures européennes, est un donateur du Parti républicain du peuple.
Un autre personnage clé du Parti républicain du peuple est Ünal Çeviköz, qui est responsable de la politique étrangère. Ancien employé du ministère turc des Affaires étrangères, il est membre d'une loge maçonnique et a participé en 2019 à une réunion du club Bilderberg.
Il y a aussi le relativement nouveau Parti du Bien (IYI) - ce sont des nationalistes occidentaux, et le parti lui-même a en fait été créé par les États-Unis et l'UE afin d'arracher une partie de l'électorat au parti de Recep Erdogan. Il est paradoxal que les dirigeants de l'IYI s'opposent à la Russie, alors que l'électorat ordinaire nous traite normalement (y compris au sujet de l'opération en Ukraine).

Le chef du parti est une femme - Meral Akşener (photo), et elle est pro-occidentale dans ses convictions. Ils sont maintenant dans une coalition avec le Parti républicain du peuple. On ne sait pas encore si Meral Akşener se présentera en tant que candidate indépendante à la présidence.
Le Parti démocratique des peuples, qui représentait les intérêts des Kurdes, ne pourra probablement pas se remettre des purges et arrestations massives. Le chef du parti, Selahattin Demirtaş, est un politicien expérimenté, et les représentants locaux ont remporté de nombreux sièges à la mairie lors des dernières élections, mais ils ont tous été arrêtés car soupçonnés d'être impliqués dans le terrorisme. Théoriquement, leurs chances sont bonnes, mais le gouvernement actuel ne leur permet tout simplement pas de consolider officiellement leur victoire et d'étendre leur influence.
Toutefois, les analystes occidentaux soulignent que ce sont les Kurdes qui constitueront un atout important lors des prochaines élections, car ils ont une démographie croissante et comptent de nombreux jeunes de dix-huit ans et plus parmi eux.
Il se murmure qu'un parti trouble-fête pourrait être formé, composé de partisans du clan Barzani du Kurdistan irakien, car ils entretiennent de bonnes relations officielles avec Ankara. Barzani admet le bombardement turc d'une partie du Kurdistan irakien, où se trouve le siège du Parti des travailleurs du Kurdistan.
La question est de savoir comment convaincre la jeunesse kurde de Turquie de rejoindre ce parti, et quelle sera la position concernant la nomination d'un candidat à la présidence. Bien que tout cela ne soit que des affabulations théoriques et qu'il soit tout à fait possible qu'Erdogan poursuive le cours de la répression des Kurdes turcs.
Selon les sondages d'opinion, le Parti démocratique des peuples est le plus russophobe et le plus pro-occidental.

Enfin, il y a le Parti du mouvement national (dirigé par Devlet Bahçeli - photo). En fait, ce sont les fameux "loups gris", c'est-à-dire les nationalistes religieux. Ils sont maintenant les alliés d'Erdogan. D'ailleurs, de toutes les organisations répertoriées, ce sont les meilleures en Russie.
Et le dernier facteur de la politique turque est l'armée. Mais après une tentative de coup d'État ratée en 2016, l'armée a été sévèrement purgée. Maintenant, ils sont complètement subordonnés à Erdogan, et il n'y a aucune ambition politique parmi les militaires, à moins qu'à un niveau secret profond, il y ait un petit groupe de conspirateurs.
Si l'on parle de chances réelles, compte tenu de la situation actuelle, alors Recep Erdogan a les meilleures positions à l'heure actuelle. Bien que le pays connaisse un niveau élevé d'inflation et que la livre turque se soit effondrée il y a quelques mois, le parti au pouvoir dispose d'une ressource administrative et utilise la situation de la politique étrangère à son avantage.

À titre d'exemple, nous pouvons citer l'équilibre actuel des relations avec la Russie et l'Ukraine. Pour organiser le flux touristique de la Russie vers la Turquie, une compagnie aérienne supplémentaire est créée. Tandis que des drones Bayraktar sont livrés à l'Ukraine et qu'un soutien diplomatique est apporté.
Et c'est dans ces relations et cet équilibre des forces que la Turquie a un intérêt géopolitique important à affaiblir la Russie. Ce n'est pas un hasard si les Turcs s'intéressent activement à la Crimée et ne la reconnaissent pas comme faisant partie de la Russie, ainsi qu'au Caucase et à la région de la Volga. La Turquie a besoin du projet du panturquisme pour servir de parapluie et de justification à une éventuelle ingérence dans les affaires intérieures de la Russie.
La chaîne de télévision russophone TRT adhère à un cours ouvertement russophobe, qui soutient Navalny et Khodorkovsky, sans parler de l'incitation au séparatisme à l'intérieur de la Russie en mettant l'accent sur l'identité musulmane et turque. Le projet de "génocide circassien" y est également lié, ainsi que divers éléments commémoratifs, tels que des noms de rues en l'honneur de Dzhokhar Dudayev.
Comme le Parti de la justice et du développement se concentre sur l'identité religieuse turque, le souvenir de l'ancienne grandeur de l'Empire ottoman est également très important pour la politique moderne. Et là aussi, il y a une place pour les aspirations anti-russes, car la Turquie rappelle le rôle de l'Empire russe dans la libération des Balkans de la domination turque et une série de guerres russo-turques.
Par conséquent, l'affaiblissement possible de la Russie dans cette région est considéré comme une nouvelle opportunité pour le retour du pouvoir perdu. Et si vous le regardez à travers un prisme religieux, l'expansion turque pour Ankara est aussi la propagation de l'Islam dans de nouveaux territoires. Dans le même temps, la version turque de l'Islam est clairement différente de la version arabe classique.
Par conséquent, il est peu probable que le maintien du pouvoir suprême pour Erdogan conduise à une amélioration des relations avec la Turquie. Au mieux, une coopération pragmatique se poursuivra, notamment en raison de la forte dépendance de la Turquie vis-à-vis des approvisionnements en pétrole et en gaz russes. Mais dans le pire des cas, Ankara se comportera de manière plus persistante et agressive à l'égard de Moscou, et elle devra alors envoyer des signaux explicites, tels qu'une interdiction d'importation de légumes ou une suspension du flux touristique.
Si la situation s'avèrera encore pire, il est difficile d'imaginer quel niveau la confrontation entre la Russie et la Turquie pourra atteindre. Encore une fois, il faut se rappeler que la Turquie est membre de l'OTAN et peut se joindre aux sanctions occidentales à tout moment.
Considérons maintenant la version qui se produirait si des forces pro-occidentales prenaient le pouvoir en Turquie. Par exemple, avec l'aide d'injections financières et d'autres moyens, le chef du Parti républicain du peuple prendra le poste de président.
Tout d'abord, ils commenceront à éliminer les réalisations d'Erdogan, tenteront de revenir au format de la république parlementaire et promouvront activement un système politique laïc. Bien sûr, étant donné leur position pro-occidentale, les Etats-Unis et l'UE les presseront pour qu'ils se dressent contre la Russie. Mais il est peu probable qu'ils renoncent au gaz et au pétrole russes, même s'ils peuvent soutenir certaines des sanctions et le feront très probablement.
En général, il y aura un grand conflit d'intérêts. Cependant, il y aura le chaos à l'intérieur du pays, et compte tenu de cela, il est peu probable que les pro-occidentaux poursuivent une politique étrangère expansionniste. Le plus probable est qu'ils essaieront d'améliorer les relations avec l'UE, et encore une fois, ils attendront naïvement de rejoindre cette association.
Il est certain que les pays musulmans seront sceptiques à l'égard du nouveau gouvernement, ce qui signifie une réduction ou un retrait du soutien des riches États du Golfe. Et un tel affaiblissement de la Turquie sera bénéfique pour la Russie, car avec une approche compétente, il sera possible non seulement de préserver les acquis nécessaires, mais aussi de montrer à la société turque tous les avantages de relations bilatérales véritablement de bon voisinage.
23:02 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonid savin, actualité, turquie, élections turques, erdogan, russie, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les Non-Alignés dans le conflit russo-ukrainien

Massimiliano Palladini:
Les Non-Alignés dans le conflit russo-ukrainien
Source: https://novaresistencia.org/2022/05/10/os-nao-alinhados-no-conflito-russo-ucraniano/
Le récit hégémonique prétend que la Russie est isolée et que la "communauté internationale" l'a condamnée ? Mais est-ce vrai ? Il est crucial d'analyser les positions concrètes des pays dans les forums internationaux et de lire entre les lignes des votes de l'Assemblée générale des Nations unies.
Depuis le début de l'opération russe en Ukraine, il est courant d'entendre que Moscou est isolé de la communauté internationale. Les partisans de cette thèse s'appuient sur la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 mars. Entre autres choses, le document non seulement "désapprouve dans les termes les plus forts l'agression de la Fédération de Russie" mais exige également qu'elle "retire immédiatement, complètement et inconditionnellement toutes ses forces militaires du territoire de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues" (donc également de la Crimée et des oblasts de Donetsk et de Lougansk) [1].
En fait, la résolution a été adoptée avec des chiffres qui semblent soutenir la thèse de l'isolement de la Russie de la société internationale: 141 pour, 35 abstentions et 5 contre, tandis que 12 États n'ont pas participé au vote [2].
Des pays très peuplés comme la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, l'Éthiopie, le Vietnam et l'Iran ont choisi de s'abstenir ou de ne pas participer au vote (cas de l'Éthiopie) tandis que l'Afrique accueille le plus grand nombre de pays s'abstenant ou ne participant pas au vote. Le vote à l'Assemblée générale a divisé le continent : 28 pour, 25 abstentions ou absences et un contre (Érythrée).
Ces dernières années, la Russie a fait des efforts pour projeter son influence en Afrique, principalement en tirant parti des fournitures militaires et en renforçant des relations remontant à l'époque de l'Union soviétique. En 2019, le président Vladimir Poutine a accueilli le sommet Russie-Afrique, auquel ont participé 43 chefs d'État et de gouvernement africains [3]. En novembre de cette année se tiendra la deuxième édition du sommet [4], qui sera un indicateur utile pour évaluer dans quelle mesure la guerre en Ukraine a affecté les relations entre Moscou et le continent africain.
En ce qui concerne la résolution du 2 mars, il y a au moins deux points importants à souligner: les pays qui s'abstiennent, s'opposent ou sont absents représentent au moins 40% de la population mondiale; la résolution non seulement n'a pas de conséquences contraignantes, mais ne fait pas non plus référence aux sanctions contre la Russie et à l'envoi d'armes et d'aide financière aux belligérants.
Les résolutions adoptées avec des numéros de plébiscite sont celles qui n'ont pas de conséquences contraignantes, comme celle du 2 mars. Le 7 avril, l'Assemblée générale a adopté une autre résolution suspendant la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ainsi, la résolution du 7 avril, contrairement à celle du 2 mars, a eu des conséquences contraignantes et, en fait, le nombre de ceux qui y étaient favorables a diminué de près de cinquante pourcents, bien qu'elle soit restée majoritaire.
La résolution du 7 avril a été adoptée avec le résultat suivant : 93 pour, 24 contre, 58 abstentions, 18 absences [5]. Les États qui s'opposent, s'abstiennent ou s'absentent représentent au moins 50 % de la population mondiale. Les abstentions ont été augmentées par le vote favorable de certains États le 2 mars. Il s'agit notamment de l'Arabie saoudite, du Brésil, de l'Égypte, du Ghana, de l'Indonésie, de la Jordanie, du Kenya, du Koweït, de la Malaisie, du Mexique, du Nigeria, d'Oman, du Qatar, de la Thaïlande et de la Tunisie.
Comme mentionné ci-dessus, la résolution du 2 mars ne fait aucune référence à des sanctions contre la Russie, ni à l'envoi d'armes aux parties belligérantes. Quels États ont sanctionné la Russie ? Lesquels ont décidé d'armer l'Ukraine ? Ces questions ne peuvent être ignorées si nous voulons évaluer pleinement la réaction de la société internationale à l'invasion russe.
Les États occidentaux ont adopté la position la plus sévère à l'encontre de la Russie. Il convient de noter que les pays appartenant à ce groupe n'ont pas tous réagi de la même manière, notamment en ce qui concerne la fourniture d'armes à l'Ukraine. Le type et la quantité d'armes envoyées varient d'un État à l'autre, mais les pays de l'OTAN ont sans aucun doute adopté la ligne la plus ferme.
L'aide militaire fournie par les membres de l'Alliance de l'Atlantique Nord ne vise pas seulement à renforcer les capacités défensives de l'Ukraine, mais aussi, sinon principalement, à affaiblir les capacités offensives de la Russie, la forçant ainsi à investir plus de ressources que prévu dans la campagne ukrainienne [6]. Le conflit russo-ukrainien a ainsi pris des connotations qui le font ressembler à une guerre par procuration: les pays de l'OTAN, menés par les États-Unis et le Royaume-Uni, financent et arment l'Ukraine dans l'intention explicite d'affaiblir la Russie. En pratique, en finançant et en armant Kiev, Washington poursuit son intérêt stratégique (affaiblir Moscou pour tenter de provoquer un changement de régime) sans avoir à supporter les coûts d'une confrontation directe.
Si l'on regarde au-delà de la sphère d'influence des États-Unis, on remarque immédiatement que le reste du monde a adopté une position très différente. Les présidents du Mexique et du Brésil, entre autres, ont proclamé leur neutralité, refusant de condamner ouvertement la Russie, tandis que le président de l'Afrique du Sud a déclaré que la guerre est également la responsabilité de l'OTAN et de son expansion continue vers l'est. Des considérations similaires ont également été exprimées par Luiz Inácio Lula da Silva, candidat aux élections présidentielles brésiliennes [7].
Le 2 mars, à l'occasion de l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale, l'ambassadeur brésilien aux Nations unies a exprimé son opposition aux "sanctions aveugles" car elles entravent le dialogue diplomatique [8].
L'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique se dissocient des sanctions et des ventes d'armes à l'Ukraine. Dire que la communauté internationale a condamné la Russie est donc faux. Ou plutôt, cela dépend de ce que l'on entend par condamnation. Si l'on entend par là le vote d'une résolution sans conséquences concrètes, alors oui, la Russie a été condamnée par une grande partie de la communauté internationale. Si, toutefois, nous considérons les décisions ayant des conséquences matérielles, la situation change radicalement.
Le reste du monde répond à la politique anti-russe des pays occidentaux par le non-alignement. Les accusations plus ou moins explicites contre la Russie n'ont pas été suivies de contre-mesures concrètes comparables à celles prises par les États-Unis et leurs alliés.
Notes:
[1] Pour le texte complet de la résolution, voir UN resolution against Ukraine invasion : Full text, aljazeera.com, 3 marzo 2022. Dernier accès le 8 mai 2022.
[2] Pour la carte du vote, voir Ivana Saric, Zachary Basu, 141 pays votent pour condamner la Russie à l'ONU, axios.com, 2 marzo 2022. Dernier accès le 8 mai 2022.
[3] Antonio Cascais, Russia's re-engagement with Africa pays off, dw.com, 9 marzo 2022. Dernier accès 8 maggio 2022.
[4] Kester Kenn Klomegah, Russia Chooses St. Petersburg for Second African Leaders Summit, indepthnews.net, 12 gennaio 2022. Dernier accès le 8 mai 2022.
[5] Pour le tableau des votes, voir Avec 93 "oui", dont l'Italie, l'AGNU suspend la Russie du Conseil des droits de l'homme, onuitalia.org, 7 avril 2022. Dernier accès le 8 mai 2022.
[6] Julian Borger, Pentagon chief's Russia remarks show shift in US's declared aims in Ukraine, theguardian.com, 25 aprile 2022. Dernier accès le 8 mai 2022.
[7] Dave Lawler, The world isn't lining up behind the West against Russia, axios.com, 6 maggio 2022. Dernier accès le 8 mai 2022.
[8] Le Brésil vote pour la résolution de l'ONU, mais critique les "sanctions indiscriminées" contre la Russie, reuters.com, 2 mars 2022. Dernier accès le 8 mai 2022.
Source : Eurasia Rivista
22:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, onu, guerre russo-ukrainienne, russie, ukraine, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 10 mai 2022
"Dans la nouvelle étape, les États-Unis seront un acteur important, mais ils ne seront pas une puissance hégémonique comme il y a quelques années"

"Dans la nouvelle étape, les États-Unis seront un acteur important, mais ils ne seront pas une puissance hégémonique comme il y a quelques années"
Entretien avec Andrés Berazategui
Propos recueillis par Santiago Asorey
Source: https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/en-la-nueva-etapa-estados-unidos-sera-un-actor-importante-pero-no-sera-una-potencia?fbclid=IwAR3jCX7vWjQV37h3rUow1Mp60ea7Uxj_azUWF5vURLH1ClWfc9BpeiJpKuY
Andrés Berazategui est titulaire d'un diplôme en relations internationales, d'un master en stratégie et géopolitique et d'un diplôme en analyse stratégique internationale. Il est également membre du groupe de réflexion et du projet d'édition Nomos. Dans une interview accordée à l'AGENCIA PACO URONDO, il a réfléchi au conflit géopolitique qui oppose les puissances atlantistes de l'OTAN et la Fédération de Russie en Ukraine.
APU : Commençons par le conflit lui-même, en Ukraine, et la rapidité avec laquelle le différend entre les puissances atlantistes et la Chine et la Russie a développé des tensions dans le monde entier, sur la base des pressions exercées par les États-Unis pour imposer une guerre économique à la Russie. Comment le nouvel ordre international émerge-t-il de ce nouveau scénario ?
AB : Deux aspects importants peuvent être soulignés, au-delà de ceux déclarés par la Russie en relation avec la région de Donbass. D'une part, les aspects strictement géopolitiques: la Russie en tant que puissance ne peut pas permettre (comme toute puissance qui se respecte) des voisins hostiles à sa périphérie. Les puissances sont mal à l'aise face aux menaces proches de leurs frontières. D'autant plus que l'Ukraine appartient à l'ancien espace soviétique, une zone que les Russes considèrent comme leur zone naturelle et immédiate de projection d'intérêts. Et ce d'autant plus que l'Ukraine est particulièrement sensible dans l'histoire de la Russie, tant pour des raisons historico-culturelles que militaires (c'est la zone classique d'empiètement de l'Ouest sur l'Est).
D'autre part, il existe un conflit d'une plus grande portée: le défi permanent lancé par Poutine à l'ordre libéral international. Poutine a remis en question à plusieurs reprises les politiques, les valeurs et les institutions de l'ordre dirigé par les États-Unis. Le président russe n'est pas d'accord avec le projet libéral et l'expansion de ce modèle d'ordre, mais cherche à faire reconnaître la nouvelle répartition mondiale du pouvoir et où la Russie doit être reconnue comme un acteur important. Ce point est particulièrement sensible, car il remet en cause l'ordre international né avec la fin de la guerre froide, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une question conjoncturelle. Il s'agit du désir de la Russie d'organiser un ordre dans lequel elle est plus favorisée, et le principal obstacle est un États-Unis qui cherche à étendre ses propres valeurs et institutions de manière compulsive. Cette situation est déjà de plus en plus remise en question, même à Washington, et il faut donc s'attendre à des changements importants dans l'ordre international.
Quant à la Chine, elle s'est tenue à distance prudente du conflit en Ukraine. D'après ce que l'on peut voir dans ses médias, il est largement admis que le PCC n'est pas d'accord avec l'intervention elle-même ; mais pour la Chine, elle a beaucoup plus à gagner de la Russie en tant que partenaire stratégique, elle ne s'opposera donc pas non plus activement au Kremlin.
APU : "Que se passe-t-il aujourd'hui ? C'est la destruction du système d'un monde unipolaire qui s'est formé après la chute de l'URSS", a déclaré Poutine il y a un mois. Voyez-vous un déclin de l'hégémonie atlantiste ?
AB : Il est certain qu'il y a un déclin des États-Unis et donc un relâchement du maintien des politiques de l'ordre libéral international. Il y a une Chine défiante qui se rapproche de plus en plus de l'équilibre des attributs du pouvoir dans tous les segments de la compétition avec les États-Unis. Il existe une Russie révisionniste qui cherche à déplacer davantage de frontières et qui a conclu un accord avec la Chine. Il y a des mouvements en Europe qui pourraient conduire à une autonomie croissante du vieux continent par rapport aux États-Unis. Dans notre Amérique, le drapeau de l'intégration a déjà été hissé et, bien que ralentie, elle reste un objectif... c'est un monde en transition : nous passons d'un ordre unipolaire à un ordre de grands espaces où le grand espace atlantique (Grossraum, en langage schmittien) sera un parmi d'autres. Les États-Unis seront un acteur important, mais en aucun cas une puissance hégémonique comme il y a quelques années.
APU : La hausse du coût de l'énergie pour les populations européennes dépendantes du gaz et des hydrocarbures russes constitue également un problème électoral pour les dirigeants européens qui tentent de défendre une position pour le moins discutable d'un point de vue national. Cependant, les États-Unis ont prévalu. Quelle explication trouvez-vous à cela ?
AB : Étant donné que les événements se déroulent toujours, il reste à voir dans quelle mesure les États-Unis ont fait prévaloir leurs vues. De plus, en Europe, les points de vue sur l'approvisionnement en énergie ne sont pas unanimes, aussi des mesures prudentes ont-elles été prises sur cette question. Je pense que les Allemands, en particulier, sont impatients de voir le conflit en Ukraine prendre fin dès que possible et de revenir à la normalité (au fait, qu'est-ce que la "normalité" aujourd'hui ?), au moins en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie. Cependant, en raison des enjeux que j'ai mentionnés plus haut, je pense que les questions énergétiques ne sont pas les plus importantes aujourd'hui. Je crois qu'en fin de compte, nous parlons des forces souterraines de l'histoire qui mettent à l'épreuve la force des cultures et des peuples dans une lutte où s'affrontent de grandes volontés collectives. Et les tensions générées par ces volontés seront utiles à ceux qui sauront en tirer parti, que ce soit par une intervention ouverte dans la lutte ou par la sagesse de ceux de "l'extérieur" dans la gestion de leurs intérêts.

L'Argentine dans le monde
APU : La deuxième partie de l'interview porte sur la position de l'Argentine, mais dans la perspective de la troisième position historique du péronisme.
AB : La troisième position est née comme une alternative qui promouvait l'épanouissement individuel en harmonie (et dans un rapport de subordination) avec le destin collectif. En politique étrangère, compte tenu du fait que la seconde après la Seconde Guerre mondiale divisait deux blocs, l'un mettant l'accent sur l'individualisme capitaliste et l'autre sur le collectivisme marxiste, la troisième position a marqué ses propres modes d'organisation de la vie sociale et politique et a établi une neutralité face au conflit Est-Ouest, évitant ainsi de s'aligner sur l'un des deux blocs. En même temps, cela laissait la voie ouverte pour tirer parti et maximiser les intérêts avec l'un ou l'autre lorsque cela était nécessaire, car il ne s'agissait pas d'une position d'opposition compulsive : en bref, sans nous aligner politiquement ou sur les questions de sécurité, nous avons commercé avec les deux blocs, par exemple. La troisième position a promu son propre modèle philosophique politique dans les affaires intérieures et a recherché la liberté d'action en politique étrangère. En ce qui concerne la confrontation entre l'Occident et la Russie au sujet du conflit actuel en Ukraine, je ne pense pas que la troisième position s'applique, notamment en raison de deux problèmes : D'une part, nous ne sommes pas dans un moment bipolaire analogue à celui de la guerre froide (il est possible que cela se produise à long terme entre les États-Unis et la Chine, mais il est encore prématuré de l'affirmer) ; en fait, nous sommes aujourd'hui en transit vers un monde multipolaire. D'autre part, nous évoluons également vers un monde plus pragmatique et moins idéologique qu'à l'époque. Dans la conjoncture actuelle, j'ai tendance à valoriser la validité de la troisième position - comme je l'ai fait dans un autre ouvrage - en tant que contrepoint à la dialectique entre l'individualisme libéral et le collectivisme des "nouvelles luttes" dans le style de Tony Negri, Holloway et d'autres. Une dialectique qui, par ailleurs, dans ses expressions politiques concrètes finit (du moins en Occident) par être légitimée par un discours libéral, tant de gauche que de droite, si ces concepts ont un sens aujourd'hui.
APU : Comment analysez-vous le vote argentin à l'ONU sur l'expulsion de la Russie du Conseil des droits de l'homme ?
AB : Je considère que c'est incorrect. Il y avait au moins la possibilité de s'abstenir. C'est une méfiance gratuite, sachant que les implications pratiques de l'appartenance à un tel organisme sont secondaires. Je considère qu'il s'agit d'un impact plus symbolique que matériel, ce qui explique qu'il n'affecte pas non plus la Russie de manière substantielle, mais il s'agit toujours d'une position prise par l'Argentine et ce n'est pas une position appropriée à prendre : il s'agit d'un conflit dans lequel nous devrions adopter la neutralité. Quel était l'avantage de l'expulser ? Que gagne l'Argentine ? En quoi ce vote nous positionne-t-il mieux ? Je ne vois rien de positif dans cette décision.
APU : L'Argentine est également confrontée à un défi lié aux conditions imposées par l'accord avec le FMI. La construction d'une centrale nucléaire à laquelle participe la China National Nuclear Corporation est menacée par la pression des Etats-Unis, quelle analyse proposez-vous sur ce point de conflit ?
AB : En ce qui concerne le FMI, il s'agit d'un passif absolu. Elle limite sérieusement nos options économiques, mais aussi nos options de politique étrangère, car la dette est une conditionnalité politique, même si nos politiciens veulent la formuler en termes strictement financiers. Cela devrait être compris par tous et faire l'objet d'un débat public : la dette et les organismes internationaux de prêt sont des instruments de projection de puissance par les pouvoirs en place. Le FMI ne demande pas seulement de faire fonctionner la politique fiscale ou telle ou telle variable macroéconomique. Et vous avez raison de faire le lien avec la centrale nucléaire. Si nous ne trempons pas nos barbes dans l'eau, cette initiative et d'autres seront bloquées par des États-Unis en pleine concurrence avec une Chine montante. La question que nous devons toujours nous poser est "qu'est-ce qui est dans notre meilleur intérêt". Et il n'est pas dans notre intérêt d'être liés à la dette, pas plus qu'il n'est dans notre intérêt de nous tourner vers les États-Unis pour qu'ils nous "aident" à résoudre nos problèmes. Il est vrai que lorsque vous négociez, vous devez céder quelque chose, mais quand avons-nous jamais bien négocié avec le FMI ? Les organisations internationales sont nées, façonnées et principalement financées par les grands acteurs internationaux et sont des plateformes de projection de leur pouvoir : il faut le comprendre une fois pour toutes.
22:06 Publié dans Actualité, Entretiens, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, andrés berazategui, argentine, russie, ukraine, entretien, politique internationale, amérique du sud, amérique ibérique, amérique latine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'Ukraine, le monde à la croisée des chemins

L'Ukraine, le monde à la croisée des chemins
par Giacomo Gabellini
Propos recueillis par Luigi Tedeschi
Source : Italicum & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/ucraina-il-mondo-...
Entretien avec Giacomo Gabellini auteur du livre "Ukraine, le monde à la croisée des chemins", Arianna Editrice 2022
1) Les frontières de l'Ukraine sont indéfinissables et son identité unitaire s'avère donc floue. L'Ukraine actuelle correspond à la République socialiste soviétique instituée par Staline à la fin de la 2e guerre mondiale. À l'intérieur des frontières ukrainiennes, il existe des populations ethniquement, culturellement, linguistiquement et même religieusement très diverses, telles que des Ukrainiens, des Russes, des Polonais, des Hongrois, des Tatars, etc. ... Par conséquent, avec la rupture définitive des liens politiques, culturels et économiques avec la Russie et la sécession des régions orientales et de la Crimée (territoires pro-russes), l'identité ukrainienne n'apparaît-elle pas comme celle d'un État créé artificiellement, c'est-à-dire sur la base des sphères d'influence russes ou américaines ? Les valeurs unificatrices ne sont-elles pas représentées uniquement par l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne, c'est-à-dire par l'occidentalisation américaniste et russophobe du pays ? N'assistons-nous pas à une énième reproduction de la logique de Versailles, qui s'est toujours révélée être un échec et un signe avant-coureur de nouveaux conflits potentiels ?
Il est difficile de prévoir avec un haut degré de certitude la configuration que prendra l'État ukrainien. Tout porte à croire, cependant, que le véritable ciment de ce qui restera de l'Ukraine sera un nationalisme aux traits russophobes marqués et un désir de vengeance contre le Kremlin. Beaucoup ont tendance à attribuer ce résultat uniquement à l'attaque déclenchée par la Russie, mais en réalité, la radicalisation du pays représente un phénomène qui était déjà largement observable avant même le déclenchement du Jevromajdan. Il ne faut pas oublier qu'en 2010, le président de l'époque, Viktor Juščenko, arrivé au pouvoir en pleine révolution orange, a décerné le titre de "héros de l'Ukraine" à Stepan Bandera, leader de l'aile maximaliste de l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), composée en grande partie de Novorusses catholiques de Galicie, vétérans des campagnes irrédentistes menées contre la Pologne dans les décennies précédant la "grande guerre". Le 21 juin 1941, à l'arrivée des troupes nazies, Bandera proclame l'indépendance de l'Ukraine et participe avec l'OUN et sa branche armée (UPA, l'Armée insurrectionnelle ukrainienne) à la fondation du bataillon Nachtigall, composé de volontaires ukrainiens et soumis à la chaîne de commandement de l'Abwehr (les services secrets militaires allemands). Travaillant aux côtés des envahisseurs et des divisions SS ukrainiennes comme celle de Galicia, l'Oun a activement contribué à l'extermination de dizaines de milliers de Juifs ukrainiens et à la campagne militaire allemande contre l'Union soviétique. L'association avec les envahisseurs a duré plusieurs mois, jusqu'à ce que l'échec de la reconnaissance allemande de l'indépendance ukrainienne, promise à l'Oun à la veille de l'opération Barbarossa, conduise Bandera et ses partisans à retourner leurs armes contre les Allemands. Le chef de l'Oun a ensuite été capturé par la Wehrmacht, puis libéré sur la base d'un accord avec l'Abwehr, qui prévoyait la formation d'une division ukrainienne du Schutz-Staffeln pour aider les troupes allemandes dans la déportation des Juifs et la répression des minorités polonaises. À leur tour, les Polonais ont riposté en s'alliant à l'Armée rouge et en brûlant des villages ukrainiens entiers, ce qui a donné lieu à une guerre civile prolongée et sanglante qui entraînera la mort de plus de 90.000 civils polonais et 20.000 civils ukrainiens. La guérilla antisoviétique menée par l'OUN sous la direction du chef militaire de l'UPA, Roman Šučevič, s'est poursuivie dans les années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais lorsque la perspective de la défaite a commencé à se profiler, un grand nombre de ses figures de proue ont fui à l'étranger. Bandera, son collaborateur de confiance Yaroslav Stetsko et Lev Rebet, ancien membre du gouvernement ukrainien collaborationniste, s'installent à Munich. Bandera et Rebet seront attrapés et assassinés par un tueur à gages du KGB entre 1957 et 1959, tandis que Stetsko a réussi à survivre et à entrer dans les bonnes grâces de certaines personnalités de la politique américaine telles que Ronald Reagan et George H.W. Bush. D'autres militants de l'OUN et de l'UPA profitent de l'intercession du directeur de la CIA, Allen Dulles, pour s'installer au Canada et aux États-Unis, où ils créeront des mouvements d'exil à vocation ultra-nationaliste marquée. Au lendemain de Jevromajdan, on assiste d'une part à un processus de "nationalisation des masses" par la prolifération de statues et de monuments portant le nom de personnalités telles que Bandera, Šučevič et Stetsko. D'autre part, l'inclusion de membres dirigeants de mouvements extrémistes tels que Azov, Aidar, Dnepr, Pravij Sektor, Natzionalnyj Korpus et C-14 dans les corps spéciaux et les rangs de la police, grâce à l'intercession du très puissant ministre de l'intérieur Arsen Avakov. C'est grâce aux efforts d'Avakov et aux ressources mises à disposition par des oligarques de la trempe d'Ihor Kolomojs'kyj - propriétaire de la chaîne de télévision qui a lancé la série Serviteur du peuple, qui a garanti à Zelens'kyj une grande popularité, et principal financier de la campagne électorale de l'ancien acteur - que l'Ukraine a pu devenir un centre de gravité de très haut niveau pour le monde de l'extrême droite, capable d'attirer de nouveaux militants de trois continents différents grâce à une utilisation particulièrement efficace des principaux réseaux sociaux. On se demande quels résultats l'Union européenne espère obtenir en accueillant dans ses rangs un pays constamment tenu en échec par des éléments de ce genre.
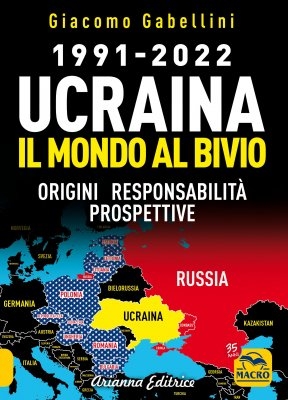
2) La guerre russo-ukrainienne revêt des significations géopolitiques qui vont au-delà des motivations spécifiques du conflit. La crise ukrainienne est, en fait, un conflit arbitré entre les États-Unis et la Russie, dont l'enjeu est l'existence même de deux grandes puissances. La Russie est un empire qui, depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine, est animé par la nécessité de survivre à l'effondrement de l'URSS. La perte de l'Ukraine impliquerait la dissolution de la Russie elle-même, étant donné les liens historiques et culturels et l'interconnexion économique qui existent depuis des siècles entre les deux pays. L'Ukraine serait donc une partie intégrante et une terre ancestrale de la Russie. Pour les États-Unis, leur rôle de puissance mondiale disparaîtrait si un nouvel hégémon eurasien (Europe ou Russie) s'affirmait. La fin du leadership américain en Europe signifierait également la fin de la stratégie d'endiguement de la Chine dans l'Indo-Pacifique. La perspective d'un conflit qui pourrait s'étendre à de nombreux foyers de guerre étendus à l'ensemble de l'Eurasie, donnant lieu à une troisième guerre mondiale, bien que de faible intensité, entre la Russie et les États-Unis de durée indéterminée, n'est-elle pas en train de se dessiner ?
Comme l'a souligné l'influent politologue russe Sergei Karaganov, l'importance de l'Ukraine pour la Russie devrait être fortement réduite. Ce n'est pas tant parce que les liens historiques et culturels incontestables qui unissent les deux pays pourraient également résister à la formidable épreuve de l'agression russe, mais parce que la Russie est une nation inattaquable à tous égards. Toute la campagne de sanctions imposée par les États-Unis et l'Union européenne était fondée sur la prédiction que la Russie ne serait pas en mesure de résister à une longue période de pression économique et financière extérieure, en vertu de la faiblesse structurelle, du retard et des déséquilibres qui caractérisent son système productif. Les principales catégories de produits des exportations russes (pétrole, gaz, matières premières, produits agricoles) dressent le tableau d'une économie relativement peu avancée, à l'exception de quelques éléments discordants (les machines et équipements représentent la quatrième source de revenus d'exportation) et de quelques pics d'excellence dans les domaines aérospatial, informatique et militaire. Les économies avancées d'aujourd'hui, structurées comme elles le sont sur la base des orientations stratégiques suivies depuis les années 1980, reposent avant tout sur des activités à haute valeur ajoutée imputables au secteur tertiaire, qui contribuent bien plus à la formation du PIB que les macro-secteurs inclus dans les secteurs primaire et secondaire. Dans les économies modernes, les services financiers et d'assurance, le conseil, les technologies de l'information, les nouveaux systèmes de communication et le design prédominent sur l'agriculture, l'industrie manufacturière et l'extraction d'énergie et de minéraux. De plus, le PIB de la Russie est encore bien inférieur à celui du Japon, de l'Allemagne, de la France et même de l'Italie, mais il repose sur une production absolument indispensable car non remplaçable pour satisfaire les besoins de base. Les hydrocarbures, les métaux, les céréales, les engrais et le fourrage sont des ressources essentielles pour garantir le chauffage et la sécurité alimentaire et énergétique. Ces conditions sont assurées en période de calme, mais deviennent soudainement chancelantes en présence de situations géopolitiques hautement conflictuelles, dans lesquelles on redécouvre la primauté du pétrole, du gaz, de l'aluminium, du nickel, du blé, des engrais, etc. sur tout le reste. En d'autres termes, la Russie joue un rôle (géo-)économique énormément plus incisif et "lourd" que ce que l'on peut déduire de l'analyse aseptique des données relatives à la taille et à la composition de son PIB, de sorte à lui assurer une capacité de résilience presque inconcevable pour tout autre Pays. Ainsi qu'un éventail d'options alternatives à celle consistant à s'entêter à se tailler un rôle de co-protagoniste dans le "concert occidental". Pour l'Ukraine, cependant, c'est le contraire qui est vrai. Penser que la survie d'un pays aux caractéristiques similaires peut faire abstraction du rétablissement d'une relation de collaboration avec un colosse de la trempe de la Russie, avec laquelle il partage 2 000 km de frontière, est une pieuse illusion.
3) Le régime de sanctions sévères imposé par l'Occident à la Russie vise à provoquer non seulement la défaillance de la Russie elle-même, mais aussi un changement de régime conduisant à la défenestration de Poutine. Selon les plans de Washington, la fin du régime de Poutine entraînerait une nouvelle expansion économique et politique de l'Occident en Eurasie. De tels horizons sont-ils crédibles ? Actuellement, les sanctions ont entraîné une réorientation de la Russie vers l'Asie, avec de nouveaux accords commerciaux avec la Chine et l'Inde, ainsi que le renforcement des relations avec les pays arabes et le Moyen-Orient, pour lesquels l'importation de céréales et d'engrais en provenance de Russie est d'une importance vitale. La création de nouvelles zones commerciales avec des monnaies hors de la zone dollar (notamment le yuan chinois) se profile donc à l'horizon, afin de contourner les sanctions. Verrons-nous une contraction significative de la zone dollar dans le monde entier à court terme ? Par le biais de sanctions, l'Occident veut imposer l'isolement de la Russie dans le contexte mondial. Mais l'espace atlantique, dominé par le dollar, ne va-t-il pas se retrouver isolé et marginalisé tant sur le plan économique que géopolitique ?
Les sanctions n'ont pas réussi à provoquer des changements de régime dans des pays bien moins équipés pour amortir le choc, comme l'Iran et le minuscule Cuba, sans parler de la Russie. Où, comme l'aurait prédit toute personne ayant un minimum de connaissance de l'esprit du peuple russe, un sondage réalisé par le Levada Center (qualifié d'agent étranger par Moscou), qui n'est même pas proche du Kremlin, a certifié que le taux d'approbation de Poutine parmi la population russe est supérieur à 80%. L'attaque contre l'Ukraine a donné une brusque accélération au processus de réorientation géopolitique et économique de la Russie vers l'Est et le Sud, fondé précisément sur l'incapacité structurelle de la Fédération à faire face au commerce international. Les corollaires de ce changement de registre sont l'exclusion du dollar dans le commerce bilatéral, le développement de systèmes de paiement alternatifs à Swift, et la création d'infrastructures de communication alternatives à celles hégémonisées par les Etats-Unis. En bref, la Russie lance une attaque simultanée contre les piliers de l'ordre international sur lesquels les États-Unis ont fondé leur domination. En perspective, le conflit et la campagne de sanctions qui s'ensuit pourraient conduire à une segmentation du scénario international "mondialisé" en blocs géo-économiques beaucoup moins communicants que ce que nous avons vu jusqu'à présent. La première ressemble à une sorte de G-7 élargi avec environ un milliard de personnes, fortement inégalitaire du point de vue des balances commerciales et caractérisé par une position financière nette agrégée profondément négative. Sur le plan politique et culturel, ce bloc - et en particulier son pays le plus puissant, les Etats-Unis - remet en cause avec de plus en plus de vigueur le principe d'égalité formelle des Etats établi par la Charte des Nations Unies afin de préconiser l'introduction d'éléments discriminatoires favorables aux démocraties, qui priveraient peut-être la Russie et la Chine de leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Le second tourne autour du "triangle stratégique" - pour reprendre une expression d'Evgenij Primakov - Russie-Chine-Inde, réunissant plus de 3,4 milliards de personnes, associant pour la plupart des pays aux balances commerciales positives et enregistrant une position financière nette globale largement positive. Le "triangle stratégique" Russie-Chine-Inde est un bloc de structures économiques largement complémentaires dont l'énergie, les matières premières, les terres arables, l'industrie, la capacité de consommation et le savoir-faire technologique connaissent une croissance rapide. Ses pays membres sont généralement très impatients face à la prétention des pays occidentaux à être les porte-parole de l'ensemble de la communauté internationale, ce qui exclut clairement toutes les nations qui ne répondent pas aux exigences politiques, économiques et culturelles fixées de manière totalement arbitraire et discrétionnaire par l'alliance euro-atlantique. L'Union européenne est dépendante des importations d'énergie de la Fédération de Russie et survit grâce à des excédents commerciaux toujours plus colossaux, principalement avec les États-Unis et la République populaire de Chine, qui se traduisent par la compression systématique de la demande intérieure par des politiques d'assainissement budgétaire catastrophiques. Les Etats-Unis, avec une dette commerciale stratosphérique (859 milliards de dollars en 2021) et une position financière nette terriblement négative (plus de 13 000 milliards de dollars en 2021), n'ont plus de tissu industriel digne de ce nom, ne produisent que des services et importent toutes sortes de produits grâce à l'impression continue de dollars. Pour les Etats-Unis, l'accélération du processus de détérioration de la position dominante occupée par le dollar depuis 1945 en raison de l'abus de sanctions et des gigantesques déséquilibres structurels qui pèsent sur l'économie nationale représente une menace capitale. Le rééquilibrage d'une situation aussi critique ne peut faire abstraction du "confinement" de l'Amérique du Nord et de l'Europe dans le périmètre d'un espace énergétique-technologique-commercial transatlantique qui garantirait d'abord la rupture des liens de dépendance entre le "vieux continent" et les deux ennemis jurés des Etats-Unis, à savoir la Russie et la Chine. Si le projet de Washington devait aboutir, l'Europe serait confrontée à un avenir de colonie barbare, peu sûre et appauvrie des États-Unis.

4) La dissolution de l'URSS a déterminé l'expansion de l'OTAN à l'Est. La crise ukrainienne elle-même est tout à fait cohérente avec la stratégie américaine de pénétration en Eurasie, qui impliquerait de déplacer indéfiniment vers l'est les frontières du nouveau rideau de fer. Le démembrement de l'ex-URSS a entraîné une diminution de la composante européenne au sein de la Russie, tant en termes de territoire que de population. La menace expansionniste de l'OTAN a conduit à une réorientation économique et géopolitique de la Russie vers l'Asie. Le développement de l'échange économique croissant et la nécessité d'une défense commune contre l'expansionnisme américain ont donné lieu à l'émergence d'un nouvel axe géopolitique composé de la Chine et de la Russie. Dans ce contexte, pour la Russie, les revenus tirés de la fourniture de gaz à l'Europe ne sont plus aussi cruciaux. La politique américaine de russophobie, déjà historiquement héritée de la Grande-Bretagne, n'est-elle pas responsable de cette conversion de la politique étrangère russe en une politique asiatique ? La mémoire historique devrait mettre en garde l'Occident. Si l'URSS et la Chine de Mao avaient été alliées pendant les années de la guerre froide, quel aurait été le sort de l'Occident ? Et ce n'est pas tout. La dissolution des liens historico-politiques entre la Russie et l'Europe ne signifierait-elle pas la disparition du rôle géopolitique séculaire joué par la Russie en tant que pont entre l'Europe et l'Asie et, en même temps, en tant qu'avant-poste pour défendre l'Europe contre la pénétration asiatique en Europe même ?
La dissolution de l'Union soviétique a été décrite à juste titre par Poutine comme la principale catastrophe géopolitique du 20e siècle, car elle a réduit quelque 25 millions de Russes ethniques vivant en Ukraine, dans les États baltes et en Asie centrale au rang d'étrangers chez eux, voire d'apatrides purs et simples. D'autre part, l'échec substantiel des pourparlers de Pratica di Mare en 2001 et le processus d'expansion de l'OTAN vers l'est ont privé le soi-disant "rideau de fer" d'une localisation géographique précise. Alors que pendant la guerre froide, elle allait "de Stettin à Trieste", pour reprendre une expression formulée par Churchill en 1946, elle va aujourd'hui de Mourmansk à Sébastopol, en passant par l'axe Saint-Pétersbourg-Rostov. La "ligne de front" s'est donc déplacée de 1 200 km vers l'est, à une distance du cœur historique, démographique et économique de la Russie qui n'a jamais été aussi dangereusement réduite depuis l'époque d'Ivan le Grand. La présence de l'Alliance atlantique à proximité des frontières russes prive le Kremlin de l'espace nécessaire à toute forme de repli, obligeant Moscou à réagir à chaque initiative de l'arsenal ennemi avec la dureté et l'imprévisibilité que l'on retrouve chez tout sujet qui se trouve dans les conditions de devoir faire face à des menaces existentielles. D'où la fermeté avec laquelle Poutine a indiqué le maintien de l'Ukraine dans un état de neutralité géopolitique et la permanence de la Biélorussie dans la sphère d'influence russe - avec ou sans Loukachenko - comme les deux "lignes rouges" dont la violation ne sera dorénavant tolérée en aucune manière. Le principal effet généré par la russophobie atlantiste fervente a été de recalibrer l'esprit d'initiative du Kremlin envers l'Est, et en particulier envers la République populaire de Chine. Les relations de coopération entre Moscou et Pékin ne cessent de s'intensifier, notamment dans les domaines sensibles de l'énergie, de la défense et des hautes technologies. Du point de vue américain, la relation de coexistence heureuse établie par le "couple étrange" en question n'est pas destinée à durer pour des raisons historiques, culturelles et géopolitiques qui sont déjà apparues pendant la guerre froide. Contrairement à l'époque où la "diplomatie triangulaire" de Nixon et Kissinger exacerbait les tensions sino-soviétiques, jetant ainsi les bases de l'enrôlement actif de la République populaire de Chine dans le front occidental et, à son tour, de l'isolement de Moscou, la Russie et la Chine poursuivent actuellement des objectifs qui, à bien des égards, coïncident ou sont du moins compatibles, et toutes deux sont ancrées dans la défense de ce droit international que les États-Unis n'hésitent pas à fouler aux pieds avec une systématique obstinée. En d'autres termes, ce sont des nations qui ont identifié - certaines par volonté délibérée (la Chine), d'autres comme un "choix obligatoire" (la Russie) - la trajectoire stratégique à suivre pour procéder au démantèlement de l'ordre mondial défini par la logique atlantiste, auquel l'Europe dans son ensemble reste encore tragiquement ancrée. Tant que le "vieux continent" ne cherchera pas à s'affranchir de la "tutelle" octogénaire des Etats-Unis pour établir une relation de collaboration concrète avec une envergure eurasienne qui redonne à la Russie le rôle fondamental de pont entre l'Est et l'Ouest, il y aura très peu de chances d'enrayer le déclin politique, économique et culturel qui touche l'Europe.

5) Il est encore largement admis que cette guerre est un piège tendu par l'Occident pour user la Russie et provoquer la chute de Poutine. Selon Poutine, l'invasion de l'Ukraine est "une question de vie ou de mort pour la Russie". Il est clair que cette guerre transcende la question ukrainienne. La détérioration progressive des relations entre la Russie et l'Occident aurait conduit Poutine à un tournant géopolitique historique pour la Russie, qui entraînerait une révision complète de la stratégie de la Russie vis-à-vis de l'Asie et la fin de la politique d'intégration modernisatrice de la Russie à l'Occident. Cette rupture définitive entre la Russie et l'Occident ne va-t-elle pas générer, dans un avenir proche, une transformation radicale des équilibres mondiaux, avec la configuration d'un monde multipolaire, avec la fin de l'unilatéralisme américain et la fin de la mondialisation imposée par le modèle économique néo-libéral made in USA, qui sera remplacée par de nombreuses mondialisations de dimensions continentales ?
À mon avis, les États-Unis ont dépensé des ressources considérables depuis au moins 2004 pour transformer l'Ukraine en un couteau pointé du côté de la Fédération de Russie. En témoignent le soutien non dissimulé à la Révolution orange, l'intensification des relations entre certains oligarques très puissants (Viktor Pinčuk in primis) et le clan Clinton, la pénétration progressive de l'OTAN dans l'appareil de sécurité de Kiev, le soutien manifeste aux forces radicales qui ont dirigé le Jevromajdan, le sabotage des faibles et contradictoires tentatives de médiation de l'Allemagne et de la France (emblématisées par le célèbre "Fuck the European Union ! ", prononcée en 2014 par la fonctionnaire du Département d'État Victoria Nuland à l'ambassadeur des États-Unis à Kiev Geoffrey Pyatt), le maintien artificiel de l'État ukrainien par des crédits non remboursables fournis par le FMI (en violation de ses statuts), la fourniture d'armes et de formations aux forces militaires et paramilitaires ukrainiennes. L'objectif stratégique poursuivi par Washington consistait à ouvrir un fossé irrémédiable entre l'Europe et la Fédération de Russie, car dans la logique des "appareils" américains qui ont toujours manœuvré la politique depuis les coulisses, le danger mortel, encore plus grand que celui incarné par l'avancée à grande échelle de la République populaire de Chine, reste la synergie entre les ressources naturelles et la puissance militaire russe d'une part, et la technologie et la puissance industrielle européennes - et particulièrement allemandes - d'autre part. Mais il y a plus. Le "nouveau rideau de fer" qui s'élève des rives de la mer Baltique à celles de la mer Noire pourrait probablement faire office de barrière contre l'initiative chinoise "Belt and Road", qui menace de transformer l'ancien Empire céleste en point d'appui d'un nouvel ordre international fondé sur le dépassement de la phase unipolaire menée par les États-Unis.
6) Actuellement, l'Ukraine est déjà reconnue comme une partie intégrante de l'Europe. Cependant, les protagonistes exclusifs du conflit russo-ukrainien sont les États-Unis et la Russie, l'Europe étant complètement marginalisée. Si l'Ukraine devait rejoindre l'UE, la politique de domination économique de l'Allemagne serait répétée. C'est-à-dire incorporer l'Ukraine dans l'Europe de l'Est en tant que pays subordonné à l'espace économique allemand. L'Ukraine deviendrait un important fournisseur de matières premières et de main-d'œuvre bon marché, ainsi qu'un territoire attrayant pour les délocalisations industrielles. Mais, je me demande si le modèle d'expansionnisme économique allemand, déjà expérimenté en Europe de l'Est, est reproductible aujourd'hui, compte tenu de l'état du conflit interne et externe en Ukraine, destiné à se prolonger également dans l'après-guerre et en considération du changement profond de la stratégie géopolitique globale américaine ? L'Allemagne n'a-t-elle pas pu se hisser au rang de puissance économique mondiale dans le cadre d'un alignement politique et militaire sur l'Alliance atlantique, c'est-à-dire sur l'OTAN, qui s'oppose désormais aux intérêts de l'Allemagne ?
Au cours des premiers mois de 2014, alors que les tensions internes en Ukraine étaient à leur comble, l'attitude de l'Allemagne était pour le moins ambiguë, mais clairement dictée par le désir de tirer le meilleur parti de cette situation extrêmement critique. Plus précisément, l'ambition de Berlin n'était pas seulement de recruter l'Ukraine en tant que fournisseur direct de matières premières pour l'industrie allemande, mais de l'incorporer dans le bloc manufacturier étroitement soudé que l'Allemagne avait méticuleusement construit depuis la réunification. L'objectif, en d'autres termes, était d'intégrer l'Ukraine dans la périphérie fordiste du pôle industriel allemand, qui comprenait déjà la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et la Roumanie. Sous le prétexte fallacieux d'une pénurie de travailleurs hautement qualifiés dans leur pays, les entreprises manufacturières allemandes voulaient obtenir le feu vert pour étendre à l'Ukraine le phénomène, déjà systématiquement appliqué au reste de l'Europe centrale et orientale, des maquiladoras inversées, en référence aux usines mexicaines où sont assemblés des produits américains à haute valeur ajoutée. Dans ce contexte, l'industrie allemande a gardé son cerveau opérationnel chez elle, transplantant certaines de ses productions phares de l'autre côté de la frontière afin de recomposer cette Europe centrale plus "attractive", pour des raisons culturelles et de proximité géographique, que les usines italiennes, espagnoles et nord-africaines sur lesquelles elle s'était concentrée pendant la guerre froide. L'ambitieux projet expansionniste poursuivi par Berlin s'est soldé par un échec substantiel en raison de l'hostilité non pas tant de la Russie que des États-Unis. En 1990, Berlin avait obtenu de Washington l'autorisation de reconstruire son "arrière-cour" en Europe centrale et orientale - et donc de poursuivre ses propres intérêts économiques - en échange de l'adhésion du pays réunifié au camp occidental, conformément au fameux accord verbal conclu à l'époque par le président Mikhaïl Gorbačëv et le secrétaire d'État James Baker, selon lequel l'Alliance atlantique incorporerait l'Allemagne dans son giron sans s'étendre "d'un pouce" à l'est de l'Elbe. L'accord, dont l'existence a été niée par le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, mais confirmée à la fois par l'ancien ambassadeur américain à Moscou, M. Jack Matlock, et par un document récemment découvert dans les archives nationales britanniques par l'hebdomadaire "Der Spiegel", a été violé depuis 1997, lorsque la Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont rejoint l'Alliance atlantique. Le fait est que, de par ses lourdes implications commerciales et géopolitiques, le modèle mercantiliste allemand est entré dans le collimateur de Washington dès l'administration Obama, avec le fameux - et très instrumental - scandale du Dieselgate et les sanctions imposées à la Deutsche Bank, mais c'est sans doute sous Trump que la véritable escalade a eu lieu. Combinée à l'adoption d'une série de mesures protectionnistes, la redéfinition de l'ALENA selon une logique visant manifestement à frapper les exportations allemandes a infligé un coup dur à l'économie allemande, exposée comme nulle autre aux dynamiques extérieures. La position des États-Unis à l'égard de l'Allemagne n'a pas changé de manière significative, même après l'entrée en fonction de l'administration Biden, comme en témoigne la forte pression économique et politique exercée par les États-Unis pour bloquer la construction du gazoduc Nord Stream-2. Une continuité substantielle, prouvant que le mercantilisme teuton pouvait être toléré comme un "mal nécessaire" à l'époque de la guerre froide, certainement pas dans l'ordre géopolitique actuel tendant vers la multipolarité.

7) Cette guerre pèsera lourdement sur le sort de l'Europe. Incapable de jouer un rôle géopolitique autonome, qui aurait pu éviter cette guerre entre peuples européens, puisqu'une telle stratégie neutraliste aurait impliqué une rupture avec l'OTAN, l'Europe est condamnée à en subir les conséquences économiques et politiques, en tant que zone géopolitique subordonnée aux États-Unis. Surtout, n'y aura-t-il pas un déclassement de la puissance économique allemande, compte tenu de la perte de son importance politique et stratégique en Europe de l'Est, de ses liens énergétiques forts avec la Russie et des perspectives potentielles d'expansion économique dans le commerce avec la Chine ? De plus, avec le réarmement de l'Allemagne dans le contexte atlantique, la perspective d'une transformation de l'Allemagne elle-même, de leader économique incontesté en Europe à puissance géopolitique continentale ayant pour fonction de contenir la Russie en Europe de l'Est et de sauvegarder le leadership américain en Europe, est-elle crédible ?
La dynamique déclenchée par l'attaque russe contre l'Ukraine a entraîné une nette modification des objectifs initiaux poursuivis par les États-Unis à travers leur manipulation de l'Ukraine, qui consistaient essentiellement à séparer l'Europe de la Russie. La guerre et la campagne de sanctions qui a suivi risquent de faire de l'Europe une colonie, y compris économique, des États-Unis, car elles privent le "vieux continent" des approvisionnements à bas prix en matières premières, en énergie et en produits agricoles sur lesquels repose la compétitivité de son industrie, tout en ouvrant le marché européen aux armes, au gaz de schiste et aux produits agricoles américains. Un renversement des relations commerciales transatlantiques traditionnelles se profile à l'horizon, caractérisé par l'accumulation d'excédents commerciaux structurels avec l'Europe, que les États-Unis - pays débiteur par excellence à tous égards - entendent utiliser pour prolonger leur tendance à l'importation massive de marchandises chinoises, malgré le déclin constant du dollar en tant que monnaie de référence internationale. Dans ce contexte, il est illusoire de penser que par le réarmement, l'Allemagne peut se libérer de la relation de vassalité qui la lie aux États-Unis depuis 1945. Surtout dans la situation actuelle où le parti vert ultra-atlantiste - qui doit son succès à la campagne de propagande incarnée par Greta Thunberg, qui a ponctuellement disparu du radar maintenant qu'il est question d'importer du gaz de schiste américain, avec son impact environnemental littéralement dévastateur - exerce une influence décisive sur la politique du gouvernement dirigé par le chancelier Olaf Scholz. Dans la pratique, l'Europe ne peut même pas imaginer un avenir caractérisé par la reconstruction de sa relation avec les États-Unis sur une base non pas tant de parité, mais au moins de subordination moins marquée que ce n'est encore le cas aujourd'hui.
21:04 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, ukraine, russie, affaires européennes, géopolitique, entretiens, histoire, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 09 mai 2022
L'Occident : le non-être de l'Europe

L'Occident : le non-être de l'Europe
par Luigi Tedeschi
Source : Italicum & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/occidente-il-non-essere-dell-europa
Une Europe toujours identique à elle-même
L'Europe s'est-elle retrouvée dans son unité, c'est-à-dire dans l'OTAN ? L'Europe, déjà embaumée et amorphe, s'est-elle transformée en un sujet géopolitique avec le choix atlantiste du terrain ? Non, la subordination soumise et consensuelle de l'Europe à l'OTAN est la manifestation claire et évidente de son aptitude génétique au non-choix. L'Europe reste en hibernation dans son non-être, en tant que territoire continental enchâssé dans l'Ouest atlantique. L'Europe reste subordonnée à la puissance américaine et, qui plus est, éloignée d'un contexte géopolitique mondial qui subit de profondes transformations.
L'UE, désormais en parfaite symbiose avec l'OTAN, ne veut que se préserver, avec sa structure technocratico-financière, son modèle économique néo-libéral, et sa stratification sociale éminemment fondée sur les classes. L'UE est en fait une entité supranationale immobile, qui s'est révélée irréformable dans ses équilibres oligarchiques. L'Europe est, et reste, toujours la même ; ni la crise pandémique ni la guerre en son sein n'ont affecté son manque d'identité. Les urgences récurrentes n'ont pas non plus amené les peuples d'Europe à se repenser et à repenser le rôle de l'Europe dans le monde.
La crise énergétique, déjà présente pendant la phase post-pandémique, a été encore aggravée par le conflit russo-ukrainien. Les propositions d'un accord entre les membres de l'UE sur les achats et les stocks communs d'énergie et l'établissement d'un plafond sur les prix de l'énergie se sont heurtées à un mur d'hostilité de la part des pays frugaux. Les prix de l'énergie sont négociés à la bourse d'Amsterdam. En fait, les prix de l'énergie sont le résultat de la spéculation financière, pas de la guerre. Ont également été rejetés les appels à un nouveau PNR pour faire face à la récession économique naissante et les propositions de partage de la dette contractée par les États pendant la crise de la pandémie. Il convient également de noter la rigidité dont font preuve les pays économes à l'égard d'une éventuelle réforme du pacte de stabilité, dont les faucons de l'austérité réclament le rétablissement en 2023. Ni la pandémie ni la guerre n'ont détourné les élites européennes des projets liés à la révolution numérique et à la transition environnementale. Avec quelles ressources de telles transformations structurelles à grande échelle peuvent être réalisées, nous ne le savons pas. Enfin, la question se pose de savoir quelle part des fonds du PNR sera détournée des investissements structurels pour être utilisée pour l'armement en soutien à la guerre américaine en Ukraine !
L'expansion de l'OTAN à l'est aurait signifié l'exportation vers l'Ukraine du modèle occidental, américaniste dans sa culture et néo-libéral dans son économie. Une Ukraine déracinée de son identité historico-culturelle et intégrée dans la zone d'influence russe, aurait l'américanisme comme seule valeur unificatrice, conformément à sa fonction géopolitique d'avant-poste de l'OTAN en Eurasie. L'Europe de l'OTAN a ainsi été transformée en un terrain intermédiaire fonctionnel pour l'expansion vers l'est du modèle d'entreprise néolibéral. Avec la propagande assourdissante de la guerre médiatique, le courant dominant induit les masses à croire qu'elles vivent dans le meilleur des mondes possibles, à concevoir l'Occident comme une civilisation supérieure, identifiable aux valeurs de la démocratie libérale, de l'égalité et du bien-être généralisé. Mais sans tenir compte du fait que le modèle libéral-démocratique se trouve aujourd'hui à un stade avancé de décomposition en Occident même, puisque l'avènement du néolibéralisme économique a généré une société de plus en plus élitiste et technocratique, avec la disparition progressive de l'aide sociale et du bien-être généralisé.
L'Europe du bien-être consumériste ne pouvait en aucun cas se transformer en une puissance géopolitique. Une puissance mondiale place ses propres objectifs politiques et stratégiques avant la croissance économique et le bien-être de ses citoyens. Cette confrontation/clash entre l'Occident et la Russie entraînera de profonds traumatismes pour l'Europe. L'occidentalisation économique a depuis longtemps conduit l'Europe à sortir de l'histoire. La Russie, quant à elle, affirme son rôle de puissance mondiale en s'appuyant sur des valeurs identitaires. Cette fracture irrémédiable entre l'Occident et la Russie est bien décrite par Pierangelo Buttafuoco dans une récente interview : "Pour l'Occident, la Russie est un ennemi plus hostile même que l'Union soviétique, car des décennies de matérialisme scientifique n'ont pas réussi à égratigner son identité et son esprit. La Russie est la première puissance chrétienne du continent européen, elle a de solides traditions, les Russes croient vraiment en Dieu. Tout ceci est inquiétant et détestable pour ceux qui regardent le monde à travers les yeux de la laïcité et du scientisme occidental.
L'UE : un échec qui se fait attendre
La guerre russo-ukrainienne se déroule depuis 2014 et a connu diverses évolutions. Dans un premier temps, la Russie a occupé la Crimée et le Donbass, suite au coup d'État pro-occidental de la place Maidan en Ukraine. Puis, dans une deuxième phase, l'invasion russe a eu lieu, contrée par la résistance ukrainienne. Une troisième phase est en cours, dans laquelle les États-Unis et la Russie sont indirectement montés l'un contre l'autre par le biais du soutien de l'OTAN à l'Ukraine.
Au-delà de l'unité monolithique actuelle entre l'UE et l'OTAN, compte tenu de la crise économique et énergétique qui va frapper l'Europe et de l'évidente divergence d'objectifs entre les Etats-Unis et l'Europe (éviction de Poutine et déstabilisation de la Russie pour les Américains - négociation avec la Russie et fin du conflit du côté européen), il ne peut y avoir que de profondes dissensions entre l'OTAN et l'Europe et au sein même de l'UE. Cette guerre a conduit à la mobilisation de l'Europe par les États-Unis, qui veulent protéger leurs intérêts stratégiques par l'action de l'OTAN. Cependant, les charges résultant de la guerre, des représailles russes aux sanctions économiques, ainsi que les coûts de la diversification énergétique, les dépenses d'armement et les conséquences de la crise économique, retombent sur les Européens. La stratégie américaine d'étranglement de la Russie, par le biais de sanctions et d'usure de la guerre, ne peut que conduire à la rupture des relations entre l'UE et la Russie et, par la suite, à l'inclusion (ou l'emprisonnement ?) de l'Europe dans l'espace géopolitique anglo-saxon-atlantique.
En fait, une réorientation géopolitique au sein de l'Europe est en cours. Le centre de gravité de l'Europe s'est déplacé vers l'est. Il faut dire que l'adhésion des pays d'Europe de l'Est à l'UE était conditionnée à leur adhésion à l'OTAN dans une fonction anti-russe. Ce n'est pas une coïncidence si aujourd'hui les pays d'Europe de l'Est, ainsi que les pays du Nord et les pays baltes, avec le soutien de la Grande-Bretagne, sont de fervents partisans d'une confrontation directe entre les États-Unis et la Russie (contrairement aux autres pays européens). Et comme le théâtre du conflit est l'Europe, il est clair que les USA veulent, en exacerbant leur politique de sanctions et leur conflit avec la Russie, provoquer l'éclatement de l'Europe. Si Poutine n'a pas réussi à diviser l'Europe, Biden réussira à la déstabiliser.
L'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est est la cause profonde du conflit russo-ukrainien. Poutine a exigé des garanties écrites que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN. Mais Biden a refusé toute négociation avec Poutine. Il convient également de noter que l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est s'est faite en violation ouverte du Traité atlantique et de la Charte des Nations Unies. En effet, le Traité de l'Atlantique prévoit le règlement pacifique des différends internationaux (Art. 1), la défense mutuelle des Etats membres (Art. 5/6), - mais l'Ukraine ne l'est pas - et surtout (Art. 7), que le Traité ne peut affecter les droits et obligations établis par le Statut de l'ONU à l'égard des Etats membres de l'ONU. Il est donc clair que l'expansion de l'OTAN vers l'est constitue une violation ouverte du traité de l'Atlantique et du statut de l'ONU, car elle empiète sur le droit de la Russie à la sécurité, c'est-à-dire celui d'un État membre. L'action de l'OTAN constitue donc une violation flagrante du droit international, comme le souligne Fabio Mini dans un article publié dans Limes n° 2/2022 intitulé "La route du désastre" : "La Russie fait partie des Nations unies et la politique de l'OTAN a porté atteinte à ses droits, compromettant la paix et la sécurité dans le monde entier. La réaction russe est basée sur cette blessure et il est surprenant qu'elle n'ait pas été déclenchée plus tôt.
L'article 10 stipule que les parties <peuvent>, par accord unanime, inviter tout autre État européen capable de favoriser le développement des principes du traité et <contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique Nord> à adhérer au traité. Lors du sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, le président américain G.W. Bush, malgré l'avis contraire de ses propres services de renseignement, a parlé explicitement de l'admission de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'OTAN. Des pays qui ne pourraient pas contribuer à la sécurité de l'Alliance, voire l'aggraver".
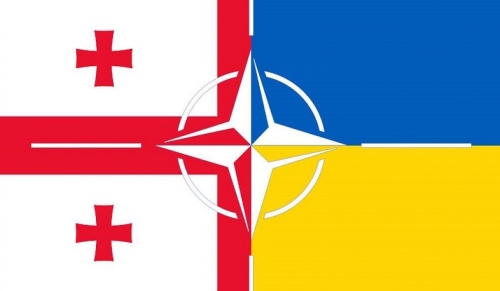
Les effets de la politique de sanctions de Biden contre la Russie seront dévastateurs pour l'Europe, dont le rôle économique dans le monde sera considérablement réduit. Les sanctions n'entraîneront pas le défaut de paiement de la Russie, et encore moins l'implosion du système politique russe, qui s'en trouvera renforcé. Ils n'affecteront pas l'économie américaine, mais l'économie européenne sera détruite. La perte des capitaux européens investis en Russie s'élève à 310 milliards de dollars, tandis que les capitaux américains ne représentent que 14 milliards de dollars. Mais surtout, la hausse des prix de l'énergie provoquera une inflation et une récession économique en Europe, alors que les États-Unis sont autosuffisants en énergie. Les États-Unis visent à remplacer la dépendance énergétique européenne vis-à-vis de la Russie par une dépendance énergétique américaine. La diversification énergétique européenne impliquera l'importation de gaz de schiste américain et la nécessité d'importants investissements dans des usines de regazéification. Le coût du gaz de schiste importé des États-Unis (dont l'impact environnemental est dévastateur) est environ deux fois plus élevé que celui du gaz russe. Sur le sujet des sanctions contre la Russie, cependant, il existe un clivage important entre les pays européens. Giacomo Gabellini déclare dans son livre "Ukraine : le monde à la croisée des chemins" : "Au sein du camp euro-atlantique, cependant, une scission manifeste est apparue, séparant le groupe "extrémiste" formé par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Pologne et les pays baltes, du groupe aspirant à la mise en œuvre d'une désescalade, qui comprend la France, l'Allemagne et - dans une position plus éloignée - l'Italie. Pour eux, au-delà des proclamations grandiloquentes et des déclarations solennelles d'engagement, le rétablissement d'une relation moins conflictuelle avec la Russie est une nécessité économique vitale. En témoignent les déclarations retentissantes du PDG de Basf, l'une des plus grandes entreprises chimiques du monde, qui affirme que l'interruption de l'approvisionnement en gaz russe mettrait en péril la survie des petites et moyennes entreprises allemandes et provoquerait "la pire crise économique en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, capable de détruire notre prospérité".
L'impact décisif sur l'économie européenne de l'arrêt des importations de grains et céréales russes et ukrainiens est également noté. Entre autres choses, les importations alimentaires américaines vont-elles ouvrir les portes de l'Europe aux OGM ? Ainsi, les sanctions contre la Russie ouvriront de nouveaux marchés aux États-Unis, mais, dans le même temps, elles entraîneront la déconstruction de l'économie européenne. En outre, si le conflit devait se poursuivre, il y aurait une fuite inévitable des capitaux de la zone euro instable vers la zone dollar. Un phénomène qui s'est déjà produit plusieurs fois dans le passé se répéterait ainsi : les États-Unis ont souvent stimulé leur propre économie au détriment des pays en crise.
L'UE est un organisme construit sur la base d'un projet d'ingénierie financière totalement artificiel et révèle son incapacité à faire face aux crises récurrentes de la géopolitique mondiale. Pour survivre, l'Europe devra donc, au prix d'affronter des crises et des conflits, se réintégrer dans le contexte historico-politique contemporain, étant donné que cette crise représente pour l'UE un échec annoncé depuis trop longtemps. Gennaro Scala, à propos de la genèse de l'UE, a effectivement déclaré : "On ne peut pas penser à créer artificiellement ce que l'histoire n'a pas créé".
L'Allemagne, entre déclassement économique et réarmement
Cette guerre aura pour effet de bouleverser l'équilibre interne de l'Europe. En effet, outre la déstabilisation de la Russie, les objectifs américains incluent la rupture du lien historique entre Berlin et Moscou. En d'autres termes, les États-Unis visent à détruire la zone d'influence de la puissance économique allemande en Eurasie en mettant sous embargo le gaz et le pétrole russes et en faisant la guerre. Une attaque conjointe des États-Unis et de la Grande-Bretagne contre la suprématie économique de l'Allemagne au nom de la domination européenne est en cours. Les États-Unis veulent frapper le modèle économique allemand, qui s'est construit pendant 20 ans grâce à des relations privilégiées avec la Russie, à l'accès à des approvisionnements bon marché en matières premières et en énergie, et à la délocalisation industrielle vers les pays d'Europe de l'Est. Mais ce sont surtout les exportations allemandes et l'excédent commercial allemand, obtenu grâce à l'adoption de l'euro comme monnaie sous-évaluée par rapport au mark, un facteur qui a largement contribué à accroître la compétitivité des exportations allemandes sur les marchés américains, qui sont attaqués par les États-Unis. Avec cette guerre, Biden entend compléter la stratégie d'affaiblissement de l'économie européenne déjà initiée par Trump avec sa politique tarifaire.
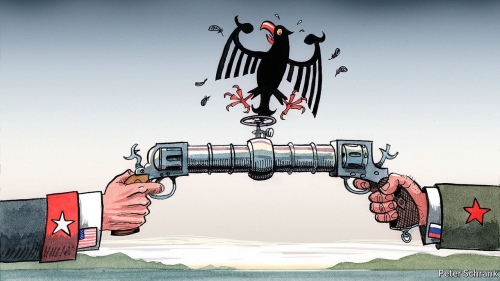
Cette guerre entraînera le déclassement de la puissance allemande et européenne dans le monde. Le rôle géopolitique central joué par l'Allemagne en Europe dans le contexte de l'évolution de la stratégie géopolitique de l'Amérique va disparaître. Le rideau de fer a été déplacé vers l'est avec le renforcement de la présence de l'OTAN dans les pays baltes et dans les pays du Trimarium (une zone s'étendant de la Pologne à la mer Noire). La stratégie d'endiguement de l'OTAN à l'est de la Russie implique donc la dissolution de la sphère d'influence allemande en Europe orientale, la fin de l'interdépendance énergétique russo-allemande et la fracture des liens géopolitiques entre l'Allemagne et l'Eurasie. Dans le cadre de ce nouvel expansionnisme de l'OTAN, toute aspiration à l'autonomie européenne est écrasée.
Dans cette phase de transformation de la géopolitique européenne, les perspectives du réarmement allemand sont particulièrement importantes. Scholz a annoncé que 100 milliards d'euros, soit plus de 2% du PIB allemand, seront investis dans l'armement au cours des prochaines années. Le réarmement allemand représente-t-il donc un tournant décisif ? L'Allemagne passera-t-elle du statut de puissance économique mercantile à celui de puissance géopolitique ? Dans tous les cas, il s'agit d'un changement politique qui a eu lieu sur une base nationale, et donc certainement pas en vue de créer une armée européenne commune. Le réarmement allemand n'a pas été conçu pour répondre aux besoins de sécurité de l'Allemagne, mais plutôt dans le cadre de la stratégie de l'OTAN visant à contenir la Russie. La nouvelle Allemagne armée devient une puissance continentale, mais dans le cadre de la stratégie américaine de dévolution à l'Europe des coûts de défense du nouveau rideau de fer érigé par l'OTAN à la frontière avec la Russie.
La perspective du réarmement allemand est pleine d'inconnues. L'Allemagne est au bord d'une grave crise économique causée par la hausse des prix de l'énergie, les difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs pour la production industrielle et l'inefficacité de la chaîne de production suite à la pandémie. En outre, le spectre de l'inflation est réapparu, ce qui pourrait avoir un impact traumatisant sur la population allemande, compte tenu de son contexte historique. Dans ce contexte, comment le peuple allemand réagira-t-il à un gouvernement qui décide de consacrer des ressources importantes à l'armement, qui seraient autrement utilisées pour soutenir l'économie et les dépenses sociales afin de faire face à la crise post-pandémique ? Le réarmement allemand s'accompagne d'un déclassement économique et politique de l'Allemagne. Quel impact aura la perspective d'un réarmement allemand en termes anti-russes sur une population qui a vécu pendant des générations dans un climat de pacifisme post-historique et qui comprend des secteurs significatifs de l'opinion publique pro-russe, notamment dans les Länder de l'Est ? Quelqu'un a ironiquement dit, à propos de l'atlantisme servile du gouvernement Draghi, que l'Italie est le Belarus de l'Occident. Mais alors, l'Allemagne du réarmement ne deviendra-t-elle pas la DDR des USA ?
L'Occident : le non-être de l'Europe
La guerre russo-ukrainienne marque la fin de l'ère de la domination américaine globale et unilatérale qui a commencé avec la dissolution de l'URSS. L'échec de l'Union européenne, ainsi que les perspectives d'une future désintégration de l'UE, étaient déjà implicites dans sa genèse même, en tant qu'organe économique et financier supranational enchâssé dans le contexte atlantiste de l'OTAN.
L'Europe n'est pas un sujet géopolitique en tant que partie intégrante de l'Occident atlantique. L'identification entre l'Europe et l'Occident s'est avérée être une contradiction irrémédiable. L'affiliation de l'Europe à l'Occident a signifié une occupation militaire américaine et une souveraineté limitée pour l'Europe. L'Occident représente aujourd'hui le non-être de l'Europe. Toute perspective de souveraineté géopolitique européenne implique la séparation de l'Europe de la zone atlantique occidentale. Il est donc nécessaire d'identifier d'abord l'Occident comme l'ennemi irréductible de l'Europe. Franco Cardini déclare dans son essai "La guerre en Ukraine et l'Europe contre l'Eurasie" : "Ce qui est certain, c'est que les anciennes oppositions sociopolitiques et socioculturelles n'existent plus. Le processus de mondialisation, qui a commencé il y a un demi-millénaire, est presque terminé"... "Face à tout cela, un choix doit être fait : pas immédiatement peut-être, progressivement et sagement sans doute, mais avec une rigueur qui n'est pas encore claire pour tout le monde mais qui le deviendra. Maintenant que l'unanimité artificielle et forcée "pro-Ukraine" (c'est-à-dire pro-OTAN) commence à montrer des signes de métabolisation, alors qu'il devient de plus en plus clair que nous, Européens, paierons une grande partie du fardeau des sanctions insensées contre la Russie, qui sont directement ou indirectement dirigées contre nous aussi, et de celles du réarmement d'une armée qui est "la nôtre" et que nous ne commandons pas et qui n'agit pas sous nos ordres, la décision fondamentale reste la nôtre et uniquement la nôtre : si nous acceptons en tant qu'Européens d'être désormais "ameuropéens" (rappelez-vous l'Amérique amère d'Emmanuel Emmanuel) ou si nous acceptons d'être "ameuropéens" (rappelez-vous l'Amérique amère d'Emmanuel). (vous souvenez-vous de l'America amara d'Emilio Cecchi ?) ou reprendre une voie millénaire qui est la nôtre depuis l'Antiquité et, avec une conscience de plus en plus sévère, se dire "eurasien"... "Aujourd'hui, chacun de nous, Européens, est appelé à choisir s'il préfère vivre dans la périphérie occidentale de l'Eurasie ou dans la périphérie orientale de l'AmEurope. Le soleil s'est toujours levé à l'Est, il est toujours mort à l'Ouest. Laissez-nous décider."
Il y a une guerre en cours entre les États-Unis et la Russie qui transcende la crise ukrainienne. Nous assistons à un affrontement entre deux modèles géopolitiques alternatifs, dont l'issue déterminera des transformations importantes dans le cours de l'histoire des décennies à venir. On oppose la mondialisation néolibérale aux États et aux identités des peuples. Ce n'est pas une coïncidence si les États opposés à la domination américaine sont définis comme des "États voyous". A l'universalisme unilatéraliste américain s'oppose le pluriversalisme multilatéraliste des différentes cultures continentales. Comme le dit Pierangelo Buttafuoco, "D'un côté, il y a l''imperium', les puissances impériales, y compris les États-Unis : comme le dit Dario Fabbri, ce sont les peuples qui ne prennent pas d'apéritifs, qui ont un esprit combatif et des identités plurielles. D'autre part, il y a le "dominium" des Européens, la tentative de réunifier le monde avec une seule identité, un seul projet. Au lieu de perdre du temps avec la propagande, nous devrions réfléchir à une guerre qui défie la mondialisation. Nous, les Occidentaux, sommes convaincus d'avoir le dernier mot sur les événements de l'histoire, mais il existe un dessein mondial où des puissances spirituellement fortes se sont réunies : la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan". L'horizon immanentiste de la post-histoire de l'idéologie libérale est contré par le retour de l'histoire comme dimension naturelle de la vie de l'homme et des peuples.
Ces contrastes réapparaîtront au-delà du conflit actuel. Les conflits entre parties opposées font partie intégrante de la dialectique de l'histoire. Les régimes, les idéologies et les doctrines politiques sont destinés à se dissoudre au cours de l'histoire. Mais les peuples et leurs identités demeurent. Il est donc nécessaire de prendre parti sur la base de ses propres motivations idéales et géopolitiques, indépendamment de l'orientation politique et idéologique des classes dirigeantes des deux puissances en conflit. On ne peut pas être un fan de Poutine ou de Biden. Il est nécessaire de prendre parti parce que la transformation de l'ordre géopolitique mondial est en cours, parce que notre être dans l'histoire est en jeu. Parce que non seulement Poutine est tombé dans le "piège atlantique", mais surtout l'Europe. Nous devons prendre parti, car sinon les États-Unis prendront parti pour nous, en tant que sujets de l'empire mondial atlantique.
Quelle pourrait être la valeur unificatrice d'une alliance entre les peuples d'Europe ? Le rejet de l'américanisme, entendu comme matérialisme consumériste, économisme totalisant, infection mortelle de l'esprit, destruction de l'éthique des communautés humaines, expansionnisme armé de guerres sans fin. Il faut mettre en place un front européen du refus, c'est-à-dire une coalition transversale des peuples, transcendant les États et même les continents. De nouvelles identités et de nouveaux mouvements politiques émergeront de ce rejet, issus de la lutte pour la souveraineté des peuples et des États européens.
L'histoire a subi une accélération soudaine, ce qui implique des choix existentiels avant les choix politiques. L'éloignement de l'histoire conduirait à la dissolution fatale de l'Europe dans le nihilisme de la post-histoire.
21:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, politique internationale, géopolitique, occident |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 mai 2022
Le président du Parlement hongrois : une confrontation géostratégique a lieu en Ukraine

Le président du Parlement hongrois: une confrontation géostratégique a lieu en Ukraine
Source: https://zuerst.de/2022/05/06/ungarischer-parlamentspraesident-in-der-ukraine-findet-eine-geostrategische-konfrontation-statt/
Budapest - Le président du Parlement hongrois, László Kövér, ne mâche pas ses mots. Dans une interview accordée à la chaîne "Inforadio Arena", il a souligné que le conflit actuel en Ukraine ne se résumait pas à un affrontement entre Kiev et Moscou.
"En réalité, la guerre en Ukraine est une guerre russo-américaine, annonciatrice d'une confrontation géostratégique entre les Etats-Unis et la Chine. L'objectif est de "séparer" l'Europe économiquement et politiquement de la Russie et de l'Asie afin d'empêcher la création d'un espace politique et économique unifié de l'Atlantique au Pacifique, a déclaré M. Kövér. L'énorme potentiel économique d'un espace économique aussi vaste entraînerait le risque pour les Etats-Unis de se faire distancer.
Pour la Hongrie, le plus important est de "préserver les acquis des 12 dernières années [depuis l'arrivée au pouvoir de Viktor Orbán, ndlr], notamment la sécurité de l'existence nationale, le soutien aux familles", a-t-il déclaré. C'est pourquoi "beaucoup de choses seront accomplies si nous ne nous joignons pas au chœur des bellicistes, afin de mettre fin à cette guerre avec le moins de victimes possible et le plus rapidement possible", a souligné M. Kövér.
Sur le plan politique, il n'y a jamais eu autant de chaos dans l'UE. Mais rares sont ceux qui osent évoquer ouvertement l'objectif final de Bruxelles: l'élimination des États-nations. Autrefois, le monde et l'Europe étaient dirigés par des personnes qui étaient des hommes politiques talentueux, de grande envergure, et des visionnaires. "Ceux qui dirigent l'Europe aujourd'hui, et le monde occidental, sont des caricatures monstrueuses de cette génération", a-t-il déclaré.
Certains d'entre eux n'ont aucune compréhension des défis à relever, d'autres ont été détournés, achetés, corrompus ou sont des "personnages sans caractère". D'autres encore sont bénéficiaires des élites mondiales, dont le scénario est la soi-disant "fédéralisation" de l'Europe. En résumé, "il y a très peu de gens qui comprennent ce qui se passe, et encore moins qui sont assez courageux pour l'exprimer et s'allier à des personnes partageant les mêmes idées", a résumé Kövér (mü).
Demandez ici un exemplaire gratuit du magazine d'information allemand ZUERST ! ou abonnez-vous ici dès aujourd'hui à la voix des intérêts allemands : https://zuerst.de/abo/ !
Suivez également ZUERST ! sur Telegram : https://t.me/s/deutschesnachrichtenmagazin
22:40 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lazlo kövér, hongrie, europe, affaireseuropéennes, politique internationale, ukraine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
En limitant les mouvements de Moscou, Erdogan joue à la roulette russe

En limitant les mouvements de Moscou, Erdogan joue à la roulette russe
par Abdel Bari Atwan
Source: https://www.ideeazione.com/limitando-le-mosse-di-mosca-erdogan-sta-giocando-alla-roulette-russa/
La décision de la Turquie de fermer son espace aérien aux avions militaires et civils russes à destination du nord de la Syrie a surpris de nombreux observateurs. L'annonce de cette décision par le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu aux journalistes turcs lors de sa tournée en Amérique latine a soulevé de nombreuses questions sur ses implications futures pour les relations russo-turques.
Il est peu probable que cette décision ait pu être l'un des résultats d'un accord turco-américain suite à des contacts discrets entre le président Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Joe Biden pour sévir contre la Russie. Contrairement à son prédécesseur Donald Trump, M. Biden estime qu'il est difficile d'assurer la sécurité régionale sans la Turquie, qui est un membre originel de l'OTAN. L'accord entre les deux pays prévoyait donc d'étendre la coopération économique et de répondre aux besoins de la Turquie en matière de défense, notamment en ce qui concerne les systèmes de missiles avancés F-35, Patriot et THAAD.
Il y a plusieurs explications à la décision d'Ankara. La première est que les États-Unis ont fait pression sur la Turquie après qu'il soit apparu que les Russes dirigeaient la bataille de Marioupol et d'autres zones du sud-est de l'Ukraine depuis la base aérienne russe de Hemeimim, dans le nord de la Syrie - d'où étaient menées des attaques stratégiques contre les forces ukrainiennes.
Une deuxième explication possible est qu'Erdogan a réussi à améliorer les relations de son pays avec Washington en profitant du besoin désespéré des États-Unis d'avoir des alliés régionaux dans la guerre par procuration de l'OTAN en Ukraine.
Mais là où l'un perd, un autre gagne. À la suite de la décision surprise de la Turquie, Téhéran a astucieusement proposé d'autoriser les avions russes à utiliser l'espace aérien iranien pour atteindre les bases navales et aériennes du nord de la Syrie. Bien que ces temps de vol puissent être plus longs, il y a des avantages immédiats pour les deux pays, en particulier pour l'Iran, qui a maintenant renforcé davantage sa relation stratégique avec l'axe Russie-Chine. L'Iran n'a pas été ambigu: depuis le début de la crise militaire ukrainienne, il n'a pas condamné les actions de Moscou et est resté tranquillement parmi les alliés tacites de la Russie.
Le président russe Vladimir Poutine s'est montré généreux envers son homologue turc. Il a pardonné à Erdogan son erreur de 2015, lorsque les défenses aériennes turques avaient abattu un avion russe Sukhoi qui avait pénétré pendant quelques secondes dans l'espace aérien de la Turquie, près de la frontière turco-syrienne. Il a fallu une série de sanctions russes de bonne envergure pour que le président turc s'excuse dans toutes les langues, y compris le russe, pour cette mésaventure.
Poutine a fait preuve de compréhension, voire de patience, à l'égard de l'occupation par la Turquie de zones dans le nord de la Syrie, contrairement aux souhaits de ses fidèles alliés à Damas. Toutefois, la dernière décision d'Ankara d'établir une zone d'exclusion aérienne russe ne sera pas si facile à pardonner, surtout si elle est suivie d'autres mesures telles que l'interdiction du passage des navires de guerre russes par les détroits du Bosphore et des Dardanelles vers la Méditerranée, conformément à l'accord de Montreux.
Cela reste une option à la lumière de l'amélioration rapide - bien que furtive - des relations turco-américaines; mais choisir de s'aligner sur Washington au sujet de l'Ukraine risque également d'accroître les coûts militaires, politiques et économiques de la Turquie, un an avant les élections cruciales du pays.
S'aligner davantage sur les États-Unis signifie également qu'Erdogan ne pourra pas continuer à jouer son rôle soigneusement élaboré de médiateur "neutre" dans cette crise, et accueillir la prochaine réunion au sommet entre les présidents turc et ukrainien.

Les aspirations turques à étendre la coopération commerciale avec la Russie à 100 milliards de dollars par an seront également touchées, et la vente de systèmes de défense antimissile russes S-400 supplémentaires à la Turquie sera peu probable. Plus sérieusement, la Russie pourrait réagir en développant ou en élargissant ses relations avec le parti séparatiste des travailleurs du Kurdistan (PKK) et en soutenant ses opérations en Turquie.
Politiquement parlant, l'opération militaire russe en Ukraine est une question de vie ou de mort pour Poutine. Par conséquent, sa réponse aux mouvements inamicaux d'Ankara sera probablement décisive et pourrait se jouer sur plusieurs fronts :
- Le front syrien : afin de maintenir l'équilibre dans les relations russes avec la Turquie, Poutine s'est fortement opposé au désir des dirigeants syriens d'envahir Idlib pour éliminer les groupes terroristes djihadistes qui y sont basés et rendre le contrôle de ce territoire à Damas. Même si la position de Moscou ne change pas encore, la reprise et l'intensité des opérations militaires russes à Idlib entraîneront la fuite d'un plus grand nombre de Syriens vers le territoire turc, qui accueille déjà plus de 3 millions de réfugiés syriens.
- Renforcement des relations russo-iraniennes : cela aura un impact négatif sur les ambitions régionales d'Erdogan - notamment en Asie occidentale et centrale - en tenant compte du fait que la Chine, qui constitue le troisième bras, et plus fort, dans cette alliance naissante, est un membre à part entière de cette troïka.
- Le front arabe : Le désir de la Turquie d'améliorer ses relations avec l'Arabie saoudite, l'Égypte et d'autres États du golfe Persique et du monde arabe pourrait être entravé par le rapprochement de ces pays avec la Russie et la Chine, qui coïncide avec la rupture de leurs relations avec leur allié américain traditionnel. L'alliance Russie-Iran-Chine (RIC) peut faire beaucoup en Asie occidentale pour perturber les relations d'Ankara dans la région. Il convient de noter que Riyad n'a pas encore répondu aux ouvertures diplomatiques turques, notamment en ce qui concerne la fermeture du dossier étatique sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
Ces derniers mois, le leadership d'Erdogan a été caractérisé par la confusion et la volatilité. Parmi les récents développements politiques, citons le renforcement impopulaire des liens d'Ankara avec Israël, son implication progressive dans la crise ukrainienne et le réchauffement des relations avec Washington. Celles-ci interviennent à un moment critique, non seulement en pleine crise économique nationale, mais aussi un an avant les élections présidentielles et législatives qui menacent sérieusement le pouvoir détenu par Erdogan.
Le président Poutine a peut-être décidé dans un premier temps de fermer les yeux sur la vente par la Turquie des drones Bayraktar qui ont probablement contribué à la mort de quelque 2000 soldats russes en Ukraine, et a accepté à contrecœur le rôle d'intermédiaire joué par la Turquie dans la crise. Au niveau stratégique, cependant, il lui sera difficile de tolérer l'accélération des nouveaux rapports de la Turquie avec l'Occident américanisé.
Il est vrai que la Turquie est une puissance régionale, et qu'elle est militairement forte, mais il est également vrai que le camp dirigé par les États-Unis vers lequel elle penche est en déclin, déchiré par les divisions, et échoue dramatiquement dans son régime de sanctions économiques contre la Russie. De plus, ce camp est confronté à l'alliance de deux superpuissances, d'une troisième nucléaire (l'Inde) et d'une quatrième en devenir (l'Iran), qui représentent ensemble plus de la moitié de la population mondiale.
Le nouveau pari du président Erdogan relatif à la Russie est risqué et pourrait se retourner contre lui au mauvais moment.
4 mai 2022
22:02 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, turquie, russie, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 mai 2022
Changement "du" système ou changement "dans" le système?

Guerre régionale ou guerre générale?
Irnerio Seminatore
Sources:
Clausewitz et ses enseignements
"Si l'un des deux belligérants est décidé à s'engager sur la voie des grandes décisions par les armes, ses chances de succès sont considérables, pour peu qu'il soit certain que l'autre ne désire pas s'y engager" (Clausewitz). Cette proposition s'applique parfaitement à la Russie et à l'Ukraine. Les deux belligérants y étaient engagés depuis longtemps et leur dialogue, diplomatique et militaire, était soutenu, en sous mains, par des co-belligérants occultes, américains, britanniques, allemands, français, polonais, baltes et autres, qui armaient et entrainaient les Ukrainiens de Zelenski. Ainsi le réveil européen pour la guerre n'a été qu'une "fake news". "La bulle" de la grande hypocrisie occidentale, qu'on avait ignoré. La primauté de la politique n'est point une proposition théorique. L'Occident et la Russie étaient déjà en guerre, mais ils ne le savaient pas encore officiellement, ou ils feignaient plutôt de l'ignorer. Sinistre Illusion ! Les Européens de l'Ouest ont mis dans les armoires de leurs chimères du passé, amnésiques, les livres trompeurs de Kant, Alain, Russell et autres munichois et humanistes.
Par ailleurs les institutions européennes, en antennes éminentes du cartel international de la morphine historique, dont la Commission s'est voulue l'outil "géopolitique”, sont passées à la livraison d'armements pour prolonger le carnage des peuples. Les plus lucides n'ont pas découvert aujourd'hui la guerre ou sa barbarie, mais le visage et la perversion d'eux-mêmes, sous le masque d'un agitateur de théâtre. C'était la violence des Yankees, le cynisme d’Albion, la logique déraisonnable et non rationnelle des Français et l'échine paralysée des Allemands. Tous croupis, au fond d'eux-mêmes, par la peur et par le manque de lucidité et de courage. Paix et Guerre, une intimité antique !
Révisons ensemble la dialectique de l'antagonisme historique et considérons les issues possibles de chaque type de paix et de chaque type de guerre. Une lecture qui sera conduite à la lumière de la politique étrangère, comportant l'unité du verbe diplomatique et de l'action militaire, unité qui, au sein de l'alliance atlantique, exclut la solidarité totale de tous les alliés. Or, puisque la subordination de la guerre à la politique dépend d'un ensemble d'intérêts, de facteurs et de circonstances, laquelle des politiques pratiquées les Européens suivront-ils, en calquant le chemin de Zelenski, de la Commission européenne et de l'Alliance Atlantique ? Pour quels enjeux et jusqu’où ? Clausewitz nous en rappelle les issues possibles: "Si la politique est grandiose et puissante, la guerre le sera aussi et pourra même atteindre les sommets, où elle prend sa forme absolue". Or l'inégalité des buts de guerre et l'inégalité de force et de résolution, subordonnera la montée aux extrêmes de la guerre à la réaction de l'autre et cela suite au principe de polarité.

La Macht-Welt-Politik et ses revers
Si nous assumons le principe que le "type de paix" souhaitée détermine en large partie le "type de guerre" à mener, dans le but de parvenir à une "paix de satisfaction", une classification ternaire des paix (d'équilibre, d'hégémonie ou d'empire), nous indique que la violence des conflits est imputable à la géométrie des rapports de force. C'est la grandeur des enjeux qui accroit la détermination politique et l'ardeur des combats. Dans le cas du conflit ukrainien l'enjeu pour les deux parties c'est le passage d'une configuration du système international à un autre (bipolaire à multipolaire). Cela signifie pour l'Ukraine sa disparition en tant qu'Etat de la scène inter-étatique et son passage d'une zone impériale (atlantique) à une autre (russe).
Pour la Russie l'enjeu existentiel, serait, en cas d'échec, un déclassement de puissance à long terme et un tremblement géopolitique inacceptable, interne et extérieur, qui serait tectonique et fatale pour l'Europe, la Russie et l'Eurasie. Par son étendue il concernerait une turbulence élargie à l'ensemble des relations systémiques, multipolaires, intercontinentales et inter-étatiques. Dans la perception de la Russie et des autres acteurs de la communauté internationale le glissement inévitable de la guerre vers un conflit d'ampleur, amènerait à la restauration d'une zone impériale, qui rivaliserait avec la puissance hégémonique déclinante. Dans cette hypothèse une guerre de grande ampleur serait inévitable car elle mettrait en cause le pivot dominant du système (les Etats-Unis), les poussant prématurément à agir.
La signification historique et systémique de la crise Ukrainienne
Entrer dans la crise ukrainienne ou s'y laisser entraîner revêt une signification plus générale et plus abstraite. En effet il s'agit d'une "crise d'équilibres" régionale qui déplace le centre de gravité du système, la fameuse "Balance of Power" vers l'Est et montre la vanité de la résistance d'une zone de jonction géopolitique (l'Ukraine de Zelenski), rendant évidente l'incapacité des Etats européens de l'Ouest à influer sur les autres et tous ensemble sur la Russie. Celle-ci, contrairement à l'Ouest du continent doit son existence et sa sécurité à elle-même, tandis que les Etats européens, derrière l'encadrement de l'alliance atlantique doivent leur existence et leur sécurité à un acteur extérieur au continent, l'Amérique.
C'est l'Amérique qui choisit son ennemi principal, son théâtre décisif et le centre de gravité de son empire futur, ailleurs (Asie- Pacifique), que dans une zone d'influence disputée. Gagner ici (théâtre régional européen), c'est perdre dans l'Indo-Pacifique (théâtre systémique), au profit de la puissance chinoise. Or la "Paix d'équilibre" qui conviendrait à l'Europe, dictée par "the anxiety with to the the balance of power is apparent..(David Hume) et se situe entre la puissance extérieure dominante (Etats-Unis) et la puissance extérieure révisionniste (Fédération de Russie).
Selon David Hume et selon "le common sens and obvious reasoning", jamais un Etat (en l'espèce la Russie? ou la Novorossyia? ou un nouvel Empire?), ne doit posséder des forces telles que les Etats voisins soient incapables de défendre leurs droits et leurs libertés contre lui (argument invoqué par la Pologne, les pays baltes, la Finlande et la Suède). Cet argument est à l'image du cas de l'empire romain, qui fut capable de soumettre l'un après l'autre ses adversaires et ses ennemis, avant qu'ils fussent en mesure de préserver les alliances qui auraient dû préserver leur indépendance. Cependant, puisque dans les relations internationales la réussite des grandes épreuves est fondée sur la légitimité, bien qu'hétérogène et sur les rapports de force, bien que variables, il est à supposer que l'unité des Etats européens de l'Ouest se réalisera davantage par la coordination des pays qui disposent d'un vrai noyau de force (France et Allemagne) et qui, par la perte de légitimité de l'Union, fera de celle-ci une expérience marginale, non prioritaire et non décisive du processus de rapprochement des Etats du continent. En réalité l'hétérogénéité du principe de légitimité de l'Union (cas de la Pologne et de la Hongrie) est à la base de sa fissuration politique et l’asymétrie de son "noyau dur", est à la base de sa différente conception de la souveraineté et de sa géopolitique mondiale, dont la crise ukrainienne est l'une des manifestations.
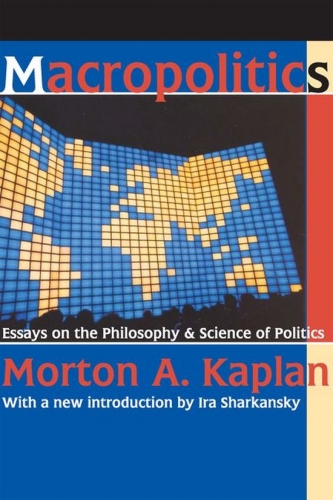
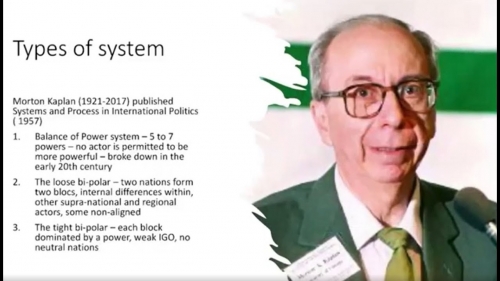
David Hume, Morton Kaplan et la théorie de l'équilibre
Que la politique de l'équilibre continental ou son statu-quo antérieur au conflit, plus favorable au camp de l'alliance atlantique, serve à préserver le système et justifie les puissances insulaires (Grand Bretagne et Etats-Unis), dans leur rôle de pourvoyeuses d'armements, est apparu immédiatement, comme l'un des objectifs de la coalition des puissances globalistes et de leur intervention indirecte, limitée et tardive. De ce point de vue il faut empêcher à tout prix l'unification des terres slaves par la Russie, -ont elles pensé- après l'élimination historique de l'Allemagne avec la IIème guerre mondiale, comme acteur principal du continent et porteur de la possibilité d'une soudure de la terre centrale (le Heartland) en fonction anti-hégémonique. La Russie sait pertinemment qu'elle est tenue pour un Etat perturbateur, soupçonné de vouloir reconstituer un ensemble politique impérial et dominateur dans son pourtour d’Etats indépendants.
Dans de pareilles conditions, après l'effondrement de l'Union soviétique elle s'attend à être tenue comme une menace pour l'hégémonie et, par les Etats-Unis, comme la réémergence d'un rival. Or, si en fonction du "système européen" du XIXème David Hume avait défini la formule la plus simple de l'équilibre, analysant en particulier la rivalité de la France et de l'Allemagne, la politique de " l'équilibre multipolaire" du XXIème, définie de façon générale comme "Balance of Power" a été formulée dans les années cinquante par Morton Kaplan, qui repère six règles abstraites, auxquelles doivent s'attendre les unités politiques si un Etat aspire à l'Hégémonie en perturbateur du système, suscitant l'hostilité de tous les Etats conservateurs. C'est exactement ce qui arrive à la Russie aujourd'hui, qui a pris l'initiative des hostilités, dans l'acharnement des sanctions économiques et financières et dans la tentative d'isolement international et d'affaiblissement politique et militaire, dont témoigne l'envoi d'armements lourds à l'Ukraine de Zelenski.
"Paix d'équilibre" ou "paix d'empire" ? Changement "du" système, ou changement "dans" le système ?
"Entre la "paix d'équilibre" et la "paix d'empire", s'intercale "la paix d'hégémonie" dit Raymond Aron, mais, il ajoute, "l'hégémonie est une modalité précaire de l'équilibre", assurée par une volonté marquée d'indépendance, car les amitiés et les inimitiés sont historiquement temporaires. La "paix d'équilibre" de l'Europe du XIXème avait un caractère conjoncturel et se limitait à la "prépondérance" de l'Allemagne de Bismarck, que la Grande Bretagne empêchera de se transformer en hégémonie continentale. Aujourd'hui, en cas de victoire de la Russie poutinienne, les occidentaux pourront-ils l'empêcher de devenir une puissance hégémonique à l'échelle multipolaire et globale (Russie, Chine, Inde, Iran, tiers non engagés), de puissance prépondérante qu'elle était à l'échelle continentale (Europe orientale et sud orientale) ?
Cette perspective historique est rendue plausible par le fait que le modèle "parfait" de guerre, selon la typologie classique, est la "guerre inter-étatique" ou nationale, qui met aux prises des unités politiques de même nature et de même zone de civilisation, dans le but de préserver l'existence du pays, tandis que les "guerres impériales" visent l'élimination d'un belligérant et la constitution d'une unité politique supérieure, composée de plusieurs unités hétérogènes.
La guerre qui caractérise l'issue entreprise par la Russie, serait pour ses adversaires le début d'une entreprise sans fin, une confrontation imparfaite et hétérogène qui met aux prises des relations inter-étatiques, trans-nationales et sociétales, qu'il faut stopper au plus vite et par tous les moyens. Il s'agirait d'un type de conflit qui ne peut donner lieu à une "paix de satisfaction", mais à des conflits prolongés, à des armistices précaires et belliqueux, asymétriques, terroristes et hybrides, dus à la coexistence d'intérêts contradictoires, dépourvus d'une perspective commune. Bien que né de la revendication d'un principe de légitimité, le principe de souveraineté étatique, revendiqué par l'Ukraine cet amalgame d'intérêts attisera des rivalités perpétuellement renaissantes surtout en Europe et conduirait qu'à une paix belliqueuse et, plus probablement, à un guerre civile permanente.
Dans le cas de la crise ukrainienne, dirigée de l'extérieur par les Etats-Unis et en subordre, par les Européens, le but de guerre et l'issue finale, changeront-ils "le" système international ou bien produiront-ils une modification des rapports de force "dans" le système ? On pourrait opiner avec Joe Biden que la "bonne" hypothèse est dans la première réponse et donc dans l'option d'une guerre limitée et dans la préservation de l'hégémonie américaine et avec Vladimir Poutine dans la deuxième, autrement dit dans le double désir de sécurité et de gloire (ou de prestige), car changeraient alors les deux éléments qui commandent à tout système international, le rapport de force, qui deviendrait plus favorable aux puissances de la terre (Russie, Chine, Inde, Iran, non-Alignés) et le principe de légitimité (oligarchique, autocratique ou despotique), renversant le cours de l'histoire, qui est allée jusqu'ici de l'Occident vers l'Orient.
Bruxelles le 23 avril 2022
20:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, relations internationales, ukraine, russie, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le Nouvel Ordre Mondial dans le contexte des théories des relations internationales
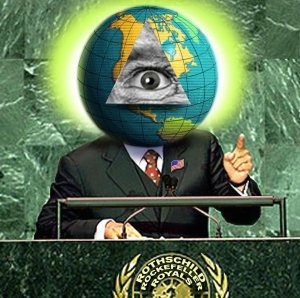
Le Nouvel Ordre Mondial dans le contexte des théories des relations internationales
Alexandre Douguine
Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/nwo-context-international-relations-theories
Nous devons comprendre ce qui se passe pour nous et autour de nous. Pour ce faire, le bon sens ne suffit pas, il faut des méthodologies. Considérons donc l'OMS (Opération militaire spéciale) dans le contexte d'une discipline comme les relations internationales (RI).
Il existe deux grandes écoles de pensée en relations internationales: le réalisme et le libéralisme. Nous allons discuter de celles-ci, bien qu'il en existe d'autres, mais ces deux-là sont les principales. Si vous n'êtes pas familier avec ces théories, n'essayez pas de deviner ce que l'on entend ici par "réalisme" et "libéralisme", la signification des termes serait tirée du contexte.
Ainsi, le réalisme en RI repose sur la reconnaissance de la souveraineté absolue de l'État-nation; cela correspond au système westphalien de relations internationales qui a émergé en Europe à la suite de la guerre de 30 ans qui s'est terminée en 1648. Depuis lors, le principe de souveraineté est resté fondamental dans le système du droit international.

Les réalistes RI sont ceux qui tirent les conclusions les plus radicales du principe de souveraineté et pensent que les États-nations souverains existeront toujours. Cela se justifie par la compréhension que les réalistes ont de la nature humaine: ils sont convaincus que l'homme, dans son état naturel, est enclin au chaos et à la violence contre les plus faibles, et qu'un État est donc nécessaire pour empêcher cela; en outre, il ne devrait y avoir aucune autorité au-dessus de l'État pour limiter la souveraineté. Le paysage de la politique internationale consiste donc en un équilibre des forces en constante évolution entre les États souverains. Le fort attaque le faible, mais le faible peut toujours se tourner vers le fort pour obtenir de l'aide. Des coalitions, des pactes et des alliances se forment. Chaque État souverain défend ses intérêts nationaux sur la base d'un froid calcul rationnel.
Le principe de souveraineté rend les guerres entre États possibles (personne ne peut interdire à quelqu'un d'en haut de faire la guerre, car il n'y a rien de plus élevé qu'un État), mais en même temps la paix est également possible, si elle est avantageuse pour les États, ou si dans une guerre il n'y a pas d'issue univoque.
C'est ainsi que les réalistes voient le monde. En Occident, cette école a toujours été assez forte et a même prévalu, aux États-Unis, elle reste assez influente aujourd'hui: environ la moitié des politiciens américains et des experts en RI suivent cette approche, qui a dominé pendant la présidence Trump, la plupart des républicains (sauf les néocons) et certains démocrates y penchent.
Considérons maintenant le libéralisme en RI. Ici, le concept est très différent. L'histoire est vue comme un progrès social continu, l'État n'est qu'une étape sur la route du progrès, et tôt ou tard, il est appelé à disparaître. Puisque la souveraineté est entachée d'une possibilité de guerre, il faut essayer de la surmonter et de créer des structures supranationales qui la limitent d'abord, puis l'abolissent complètement.
Les libéraux de la RI sont convaincus qu'un gouvernement mondial doit être établi et que l'humanité doit être unie sous l'impulsion des forces les plus "progressistes", c'est-à-dire les libéraux eux-mêmes. Pour les libéraux de la RI, la nature humaine n'est pas une constante (comme c'est le cas pour les réalistes) mais peut et doit être changée. L'éducation, l'endoctrinement, les médias, la propagande des valeurs libérales et d'autres formes de contrôle des esprits sont utilisés à cette fin. L'humanité dans son ensemble doit devenir libérale et tout ce qui est illibéral doit être exterminé et banni. Car ce sont là les "ennemis de la société ouverte", les "illibéraux". Après la destruction des "illibéraux", il y aura une paix mondiale - et personne ne sera en guerre contre personne. Pour l'instant, la guerre est nécessaire, mais uniquement contre les "illibéraux" qui "entravent le progrès", défient le pouvoir des élites mondiales libérales et ne sont donc pas "humains", en aucune façon, et peuvent donc être traités de n'importe quelle manière - jusqu'à l'extermination totale (y compris l'utilisation de pandémies artificielles et d'armes biologiques).
Dans un avenir proche, selon ce concept, les États seront abolis et tous les humains se mélangeront, créant une société civile planétaire, un seul monde. C'est ce que l'on appelle le "globalisme". Le globalisme est la théorie et la pratique du libéralisme dans les RI.
La nouvelle version du libéralisme comporte un élément complémentaire aujourd'hui: l'intelligence artificielle dominera l'humanité, les gens deviendront d'abord sans sexe, puis "immortels", ils vivront dans le cyberespace et leur conscience et leur mémoire seront stockées sur des serveurs en nuage, les nouvelles générations seront créées dans une éprouvette ou imprimées par une imprimante 3D.
Tout cela se reflète dans le projet Great Reset du fondateur du Forum de Davos, Klaus Schwab.
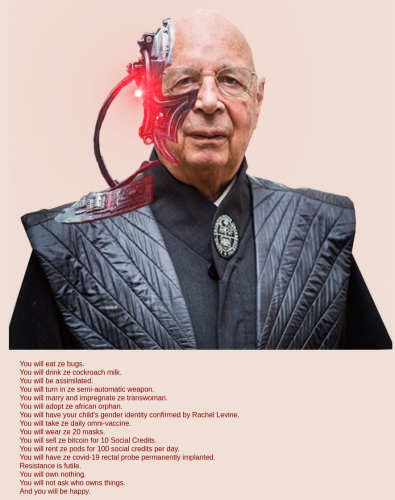
Les libéraux constituent l'autre moitié des politiciens et des experts en relations internationales en Occident. Leur influence augmente progressivement et dépasse parfois celle des réalistes en matière de RI. L'actuelle administration Biden et la majorité du parti démocrate américain sont des libéraux qui poussent dans ce sens. Les libéraux sont également dominants dans l'UE, qui est la mise en œuvre d'un tel projet, puisqu'elle vise à construire une structure supranationale. Ce sont les libéraux en matière de RI qui ont conçu et créé la Société des Nations, puis l'ONU, le Tribunal de La Haye, la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que le FMI, la Banque mondiale, l'OMS, le système éducatif de Bologne, la numérisation et tous les projets et réseaux mondialistes, sont tous l'œuvre des libéraux. Les libéraux russes font partie intégrante de cette secte mondiale, qui a toutes les caractéristiques d'une secte totalitaire.
Appliquons maintenant ces définitions au NOM (Nouvel Ordre Mondial). Après l'effondrement de l'URSS, l'Ukraine est devenue un outil des libéraux et des réalistes au sein des RI - précisément un outil de l'Occident. Les libéraux du MdD ont encouragé l'intégration de l'Ukraine dans le monde global et ont soutenu ses aspirations à rejoindre l'Union européenne et l'OTAN (l'aile militaire du globalisme); les réalistes du MdD ont utilisé l'Ukraine dans leurs intérêts contre la Russie; pour ce faire, il était nécessaire de faire de l'Ukraine un État-nation, ce qui contredisait l'agenda purement libéral. C'est ainsi que s'est formée la synthèse du libéralisme ukrainien et du nazisme contre laquelle l'Opération Militaire Spéciale se bat. Le nazisme en acte en Ukraine (l'Extrême droite, le Bataillon Azov et d'autres structures interdites en Russie) était nécessaire pour construire une nation et un État souverain le plus rapidement possible. L'intégration dans l'Union européenne exigeait une image ludique et comiquement pacifiste (ce fut le choix de Zelenski). Le dénominateur commun était l'OTAN. C'est ainsi que les libéraux et les réalistes IR ont obtenu un consensus russophobe en Ukraine. Lorsque cela était nécessaire, ils ont fermé les yeux sur le nazisme, les valeurs libérales et les parades de la gay pride.
Venons-en maintenant à la Russie. En Russie, depuis le début des années 1990, sous Eltsine, Tchoubais et Gaidar, le libéralisme a fermement dominé les RI. La Russie d'alors, comme l'Ukraine d'aujourd'hui, rêvait de rejoindre l'Europe et d'adhérer à l'OTAN. Si cela avait exigé une plus grande désintégration, les libéraux du Kremlin auraient été prêts à le faire aussi; mais à un moment donné, Eltsine lui-même et son ministre des affaires étrangères Evgueni Primakov ont légèrement ajusté l'agenda: Eltsine n'appréciait pas le séparatisme en Tchétchénie, Primakov a déployé un avion au-dessus de l'Atlantique pendant le bombardement de la Yougoslavie par l'OTAN. Il s'agissait de faibles signes de réalisme. La souveraineté et les intérêts nationaux étaient invoqués, mais de manière hésitante, timide.
Le vrai réalisme a commencé lorsque Poutine est arrivé au pouvoir. Il a vu que ses prédécesseurs avaient affaibli la souveraineté à l'extrême, happés qu'ils étaient par la mondialisation, et que le pays était par conséquent sous contrôle étranger. Poutine a commencé à restaurer la souveraineté. Tout d'abord, dans la Fédération de Russie elle-même - la deuxième campagne de Tchétchénie, la suppression des clauses de souveraineté de la Constitution, etc., puis il a commencé à s'occuper de l'espace post-soviétique - ce furent les événements d'août 2008 dans le Caucase du Sud, puis la Crimée et le Donbass en 2014. Dans le même temps, il est révélateur que la communauté internationale des experts (SWOP, RIAC, etc.) et le MGIMO ont continué à être complètement dominés par la ligne du libéralisme. Le réalisme n'a jamais été mentionné. Les élites sont restées libérales - tant celles qui s'opposaient ouvertement à Poutine que celles qui acceptaient à contrecœur de se soumettre à lui.
L'Opération Militaire Spéciale a, comme un flash-back, éclairé la situation au sein du ministère russe de la Défense. Derrière l'Ukraine, il y a une alliance de libéraux et, en partie, de réalistes au sein du ministère de la Défense, c'est-à-dire les forces du mondialisme qui se sont retournées contre la Russie. Pour les libéraux (et Biden et son administration (Blinken and Co.), comme Clinton et Obama avant lui, appartiennent précisément à cette école), la Russie est l'ennemi absolu, car elle constitue un obstacle sérieux à la mondialisation, à l'instauration d'un gouvernement mondial et d'un monde unipolaire. Pour les réalistes américains (et en Europe les réalistes sont très faibles et à peine représentés) la Russie est un concurrent pour le contrôle de l'espace de la planète. Ils sont généralement hostiles, mais pour eux, soutenir l'Ukraine contre la Russie n'est pas une question de vie ou de mort: les intérêts fondamentaux des Etats-Unis ne sont pas affectés par ce conflit. Il est possible de trouver un terrain d'entente avec eux, pas avec les libéraux.
Pour les libéraux de la RI, cependant, c'est une question de principe. L'issue de l'Opération Militaire Spéciale déterminera s'il y aura ou non un gouvernement mondial. La victoire de la Russie signifierait la création d'un monde entièrement multipolaire dans lequel la Russie (et la Chine et, dans un avenir proche, l'Inde) jouirait d'une souveraineté réelle et forte, tandis que les positions des entités alliées de l'Occident libéral, qui acceptent la mondialisation et sont prêtes à compromettre leur souveraineté, seraient dramatiquement affaiblies.
En conclusion, le libéralisme dans les RI vise à imposer la politique du genre, la guerre de l'information et la guerre hybride, l'intelligence artificielle et le post-humanisme, mais le réalisme évolue également de son côté: confirmant la logique de S. Huntington (incidemment, un partisan du réalisme dans les RI), qui parlait du "choc des civilisations", les principaux acteurs ne sont pas des États mais des civilisations, ce qu'il appelle les Grands Espaces. Ainsi, le réalisme glisse progressivement vers la théorie du monde multipolaire, où les pôles ne sont plus les États-nations, mais les États-continents, les empires. Ceci est également clairement visible dans le déroulement de l'Opération Militaire Spéciale.
En termes de diverses théories des relations internationales, l'Opération lancée par la Russie en Ukraine a simultanément inauguré un conflit entre :
- l'unipolarité et la multipolarité,
- le réalisme et le libéralisme dans les RI,
- la petite identité (nazisme ukrainien artificiel) et la grande identité (fraternité eurasienne de la Russie),
- la civilisation de la terre (Land Power) contre la civilisation de la mer (Sea Power) dans la bataille pour la zone côtière (Rimland), qu'a toujours explicité la géopolitique,
- l'État défaillant et l'empire résurgent.
Sous nos yeux et avec nos mains et notre sang, maintenant - en ce moment même - la grande histoire des idées est en train de se faire.
19:18 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, alexandre douguine, relations internationales, école réaliste, réalisme ri |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 mai 2022
Les dangers d'une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie

Les dangers d'une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2022/04/28/yhdysvaltojen-ja-venajan-sijaissodan-vaarat/
À stade où nous en sommes, il est probablement clair pour beaucoup d'observateurs que les États-Unis et la Russie mènent une guerre par procuration en Ukraine, tout comme ils l'ont fait en Syrie. C'est une façon de faire le tri dans les relations enflammées et les futures politiques de pouvoir dans le nouvel ordre post-libéral.
Alors que tout ceci n'est peut-être rien de plus qu'un sinistre théâtre du capitalisme destructeur scénarisé par les banquiers centraux, sans aucun égard pour les dommages collatéraux et les vies humaines, un autre point de vue est soulevé par les analystes classiques qui appellent à une "gouvernance responsable".
"Des déclarations récentes suggèrent que l'administration Biden est de plus en plus déterminée à utiliser le conflit en Ukraine pour mener une guerre contre la Russie visant à affaiblir, voire à détruire l'État russe", écrit l'analyste et historien britannique Anatol Lieven.
L'administration "kaganiste" de Biden semble prête à adopter une stratégie que les administrations américaines de la guerre froide se sont efforcées d'éviter. Le soutien à la guerre en Europe pourrait dégénérer en une confrontation militaire directe entre la Russie et l'OTAN.
Lieven estime que si l'affaire ukrainienne suscite bel et bien un sentiment anti-guerre critique chez les Russes, "la guerre contre les tentatives américaines d'endommager et d'assujettir la Russie séduira beaucoup plus fortement le public".

Lors de sa visite à Kiev, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a ouvertement déclaré que les États-Unis souhaitaient voir "la Russie affaiblie au point qu'elle ne puisse plus faire les choses qu'elle a faites en Ukraine".
Le même jour, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré à la télévision russe qu'en fournissant des armes lourdes à l'Ukraine, l'OTAN est déjà "fondamentalement" engagée dans une guerre par procuration contre la Russie.
Beaucoup ont comparé la situation à la crise des missiles cubains. Selon Lieven, "les gens ont oublié à quel point nous sommes passés près de la destruction nucléaire à l'automne 1962". On dit qu'"à un moment donné, le sort du monde a dépendu de la sagesse et de la prudence d'un seul officier de la marine soviétique, Vasily Arhipov, à bord d'un sous-marin nucléaire".
Affaiblir la Russie n'est pas "nécessaire", sauf pour renforcer la propre position des États-Unis. Selon Lieven, "rien n'indique que la Russie veuille ou même puisse attaquer d'autres pays". Selon lui, l'armée russe n'est pas en état d'attaquer les pays de l'OTAN.
Quant à la Géorgie, la Moldavie et le Belarus, la Russie dispose déjà des "positions nécessaires" dans ces pays. Mais lorsqu'il s'agit de combattre les mouvements extrémistes islamistes en Asie centrale et ailleurs, "les intérêts de la Russie et de l'Occident sont en fait alignés", convient Lieven.
Les États-Unis semblent toujours croire que l'Ukraine peut miraculeusement "gagner" la guerre contre la Russie avec le bon équipement et le soutien occidental. Dans ce contexte, Lieven se demande ce que signifie réellement cette "victoire".
L'Ukraine ne peut pas facilement reconquérir tout le territoire qu'elle a perdu au profit de la Russie et des séparatistes pro-russes du Donbass depuis 2014, même avec l'aide de l'Occident. Cela ne serait qu'une "recette pour une guerre continue et des pertes et souffrances massives pour les Ukrainiens".
Même après l'administration de Poutine, aucun futur gouvernement russe ne pourrait accepter d'abandonner, par exemple, la Crimée, que la plupart des Russes considèrent comme un "territoire national" de la fédération. Ainsi, la seule façon de "gagner" le conflit actuel du point de vue des Américains et des Ukrainiens serait de détruire l'État russe.
L'effondrement de la Russie est prédit depuis des décennies, mais le conflit en Ukraine et la politique de sanctions ont peu de chances de le provoquer. Il convient également de rappeler que si la Chine a jusqu'à présent été réticente à soutenir la Russie en Ukraine, Pékin ne peut tolérer une stratégie américaine consistant à renverser le régime russe pour ensuite isoler la Chine.
Un état de guerre ne peut se terminer que par la défaite d'une des parties ou par une paix négociée. Si Moscou propose un cessez-le-feu comme base des pourparlers de paix après la libération du Donbass, les Occidentaux seront confrontés à un choix : accepteront-ils cette proposition ou continueront-ils à inciter l'Ukraine à riposter et à l'armer?
Lieven se demande à juste titre "combien de temps la Russie accepterait une telle stratégie occidentale avant de décider d'envenimer la situation et d'essayer d'intimider les Européens en particulier pour qu'ils se détachent de l'Amérique et recherchent un accord de paix".
Compte tenu de la dégradation de la situation économique, qui ne fera qu'accroître la polarisation entre les citoyens et les détenteurs du pouvoir, dans quelle mesure l'"unité de l'Occident", telle que vantée dans les médias, sera-t-elle maintenue dans ces circonstances? Par exemple, l'impopulaire président français Macron, qui s'est vu accorder un délai supplémentaire, devrait remercier sa bonne étoile d'avoir été bombardé de tomates il y a quelques jours seulement.
Les pays les plus arrogants de l'UE seront sans doute encore durement touchés. Les robinets de gaz russe ont maintenant été fermés à la Pologne et à la Bulgarie. Pendant ce temps, de nombreuses entreprises européennes et même certains pays commercent en roubles avec la Russie. À cet égard, le front commun États-Unis-UE a déjà commencé à se fissurer, bien que l'Occident puisse avoir d'autres plans pour affaiblir l'économie russe.
Lieven compare comment "pendant la guerre froide, aucun président américain n'a oublié que Washington et Moscou avaient la capacité de détruire la civilisation et de mettre fin à l'existence de l'humanité". La dissuasion nucléaire était suffisante pour maintenir l'équilibre dans un environnement autrement instable.
Les dirigeants d'aujourd'hui devraient également se rappeler que "lorsque les deux parties se sont engagées dans des guerres par procuration en dehors de l'Europe, les conséquences ont été désastreuses pour elles-mêmes et encore plus pour les peuples qui sont devenus les pions de ces superpuissances". Lieven demande : "N'avons-nous vraiment rien appris de l'histoire ?"
21:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, otan, russie, ukraine, politique internationale, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


